.
Comme si le monde était soudain devenu trop grand et trop rapide pour l’art, même pour celui dont les expressions sont les plus avancées. Comme si le monde s’était déployé plus vite que l’art. Ou que le monde, à l’époque des réseaux et du marché planétaire, avait condamné l’art à l’insignifiance en l’enfermant dans les logiques paresseuses de la marchandise, du divertissement et du luxe.
Il faudrait évidemment nuancer selon les artistes, les pratiques, les œuvres et la vitalité des différentes scènes artistiques. Mais par delà les distinctions, les conditions d’exercice d’un art critique sont, en Occident, en train de se dégrader dramatiquement. Le désengagement des collectivités publiques et la spéculation effrénée à l’échelle internationale (voir éditorial, n° 243) convergent pour créer au sein du champ de l’art une fracture profonde entre une minorité accrochée au firmament du marché, et une immense étendue de vide, de découragement, d’impuissance, de paupérisation artistiques.
Une minorité surexposée fait face à une masse anonyme d’artistes privés de visibilité et de possibilités de produire. Soit deux groupes, deux conditions d’aveuglement.
D’un côté la surexposition — celle des œuvres sur les cimaises les plus prestigieuses du monde, et celle des artistes starifiés —, met les œuvres et les artistes à distance et à l’écart du monde, dans le petit monde de l’art, du luxe, de l’argent. Non pas dans un écart et une distance qui seraient propices à une vision large et ouverte, mais qui éloignent du monde jusqu’à le rendre insaisissable esthétiquement.
D’un autre côté, les difficultés croissantes à produire, à diffuser, à vendre, et tout simplement à vivre, sont autant d’obstacles, de conditions d’impossibilités à créer. Faute de faire, les artistes sont ainsi soumis à un mutisme artistique forcé, qui se transforme vite en incapacité à résonner avec le monde, à le capturer esthétiquement.
La nouveauté réside dans le fait que les positions intermédiaires, qui ont longtemps joué le rôle de tremplins pour les artistes, de relais ouverts vers une série de possibles, ont aujourd’hui disparu en raison d’une défection des pouvoirs publics. En raison d’un état du monde marqué par une tension croissante entre les extrêmes, les pauvres de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. En raison, également, de la politique que conduit délibérément l’actuel ministère français de la Culture en sacrifiant les budgets, et en privilégiant la diffusion au détriment de la production de l’art et de la culture. On se souvient à cet égard de la très programmatique formule présidentielle fixant l’objectif de la «démocratisation culturelle» à rebours des précédentes orientations de la «politique culturelle qui s’était [selon lui] davantage attachée à augmenter l’offre qu’à élargir les publics» (Lettre de mission à la ministre de la Culture, 1er août 2007).
Il existerait donc, au moins en intention, une politique délibérée en faveur de la diffusion (les publics), au détriment de la production (l’offre). Ce que confirme caricaturalement le récent rapport de Martin Bethenod qui, pour stimuler le marché de l’art en France, ne prend en compte que les intérêts des collectionneurs en ignorant totalement l’impérieuse nécessité de dynamiser la création, faiblissante faute de conditions favorables.
Assurément caractéristique de l’époque, cette indifférence vis-à -vis de la production conduit, en art, à l’extinction d’un regard critique et libre, parce qu’autonome, sur le monde.
La marchandisation et la spéculation effrénée, dont l’art est la cible, sont responsables de cette cécité qui le gagne. Parce qu’elles rompent son lien avec le monde ; parce qu’elles l’assujettissent aux intérêts (financiers, fiscaux, politiques, ou communicationnels) d’un petit cénacle de privilégiés ; parce qu’elles soumettent sans vergogne l’art au funeste paradoxe de l’économie mondialisée qui sacrifie la production au profit de la diffusion.
Acheter, vendre, spéculer, diffuser sans égards pour la production, c’est-à -dire agir dans le présent des valeurs avérées sans même envisager leur nécessaire renouvellement, cela conduit le marché à se polariser sur des œuvres-choses : des œuvres matérielles, abouties et fixées dans leurs formes, facilement identifiables et échangeables, adaptées aux conditions somme toute traditionnelles de ce marché — l’essor de la peinture et le fétichisme du tableau se situent dans cet horizon.
Comme de fastueux supermarchés d’œuvres-choses, les foires, biennales et salles de ventes internationales illuminent ainsi la planète de leurs splendeurs, de leurs extravagances, voire de leur indécence (financière). Mais leurs excès sont à la mesure de leur déconnexion d’avec la réalité sociale du monde, et traduisent leur façon d’aller à contre sens du monde dans lequel les processus prévalent désormais sur les choses.
L’enjeu est aujourd’hui pour l’art de résister, de recouvrer ses capacités à capturer esthétiquement quelque chose de ce monde à la troublante impétuosité. Car la cécité de l’art est aussi la nôtre.
André Rouillé.
.

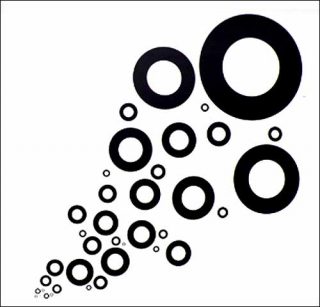
 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram