Voilà bien une façon douce de terminer la saison culturelle. Un titre plein de promesses, «Summertime Love», et une dizaine d’artistes que Michel Rein a choisi d’inviter pour traiter du thème des sentiments amoureux.
«Summertime Love» sonne comme une invite en forme de contre-pied à la marche du monde. Ce qui n’est pas, précisément pour cette raison, en dehors des préoccupations de l’art contemporain.
Mine de rien, le politique s’en est aussi emparé. La « société du care », remise en branle par Tony Blair au milieu des années 90, forme aujourd’hui le projet socialiste de Martine Aubry et le nouveau modèle d’une société fondée sur le bien-être. Avec Franck Scurti, le fait politique fertilise même la terre d’un paradis perdu qui ferait pousser des fleurs aux pétales littéralement floquées des drapeaux des Nations Unies (I Love You = UNO).
Une universalité bon teint à la naïveté touchante qui tranche avec la piquante installation de Jean-Pierre Bertrand. Acid Juice, écrit en lettres de néons, traduit en impression et en sentiment l’effet visuel que procure cette apparition subreptice, oubliée dans l’angle d’un mur mais terriblement stimulante lorsqu’elle nous saisit. Une façon de rester à vif, de ne pas travestir la parole amoureuse par excès d’empathie.
Le care chez Orlan passe par une reconnaissance identitaire de la femme. Depuisquelques années, elle s’est même décidée à investir le champ de l’histoire de l’art pour reprendre pied dans l’iconographie féminine. Par l’entremise de l’autofiction et de mises en scène à la fois burlesques et consciemment référencées, l’artiste s’imagine des liens de proximité génétique avec ses soeurs précolombiennes ou africaines, en y adoptant le profil ou les attitudes. Dans la série de photographies Skaï and Sky and Video, elle mime l’extase d’une nonne, étrangement dévêtue et consciente du plaisir qu’elle s’accorde.
Combien d’autres repères de l’histoire de l’art servent à sublimer l’érotisme et la sensualité du corps féminin? Jusqu’à parfois le recouvrir de la plus grande banalité. Hans-Peter Feldmann en fait l’expérience dans son petit bas-relief en plâtre, vague copie des Trois-grâces de Raphaël, dont il repeint les corps en couleur chair criard (Three Gracies).
Plus qu’un réflexe sarcastique, il y a chez lui la volonté d’archiver l’iconographie du quotidien. Ce qu’il fait par ailleurs en enregistrant d’immenses collections de photographies glanées ici ou là .
Chez Sylvie Fleury, la représentation de la sensualité porte d’autres canons, ceux issus de la société de consommation. Avec Alaïa Shoes, elle montre une élégante paire de chaussures coulée dans le bronze et installée sous cloche au centre de l’espace d’exposition.
L’objet, rendu atemporel par l’utilisation d’un matériau fixe héritier lui aussi de l’histoire de l’art, inspire l’idée d’une fétichisation d’un « emblème » économique fort. Il renvoie en outre à une certaine forme de vacuité, celle d’une mécanique capitaliste qui mise sur le paraître et l’image discriminante de la femme. Ce qui, à bien des égards, n’est pas pour déplaire à Sylvie Fleury.
Le duo franco-serbe Tursic et Mille affiche des intentions similaires: brouiller les pistes entre une certaine forme de vulgarité et une indéniable sensualité du corps. La peinture de Tursic et Mille met en scène de belles jeunes femmes aux visages recouverts de sperme (Facial Abstract 4). Beauté souillée ou réalité piégée dans l’étau d’un acte intime rendu public: où se place la morale dans ce type de représentation? A-t-on le droit de ressentir de l’attirance pour un standard féminin typiquement construit sur le genre pornographique?
D’autres interventions, plus discrètes et plus secrètes attestent de l’empressement des artistes à aborder la question du désir. Raphaël Zarka le fait par des voies détournées. Trois bilboquets posés sur une étagère, référence à peine voilée à la filiation « magnétisme de la terre » et « magnétisme des corps » (Ptolémaïques 2). Didier Fiuza Faustino prolonge cette confusion des sens à travers l’installation de deux pièces. Heaven, (littéralement « paradis ») une planche de bois sur laquelle peut se lire l’inscription éponyme, celle-ci se détachant de la surface uniquement grâce aux ombres et aux reliefs laissés par les fissures des lettres. Et Naked Lunch, un objet en porcelaine hésitant entre le sextoy et la déco, cette double interprétation générant justement tout le trouble. Didier Marcel se sert d’un arbre déraciné, recouvert d’une poudre artificielle et de son tatouage de coupe pour évoquer la question de l’appartenance « à la vie à la mort », ressource quasi-mystique qui permet au couple de tenir (Sans titre).
Zarka, Faustino et Marcel déplacent la symbolique sexuelle du côté de l’objet, comme si celui-ci exprimait ce que le corps ne sait pas dire ou plus dire. Dans le film de Jean-Charles Hue, l’homme et la femme ne dialoguent pas. Le premier, le dos entre les jambes de sa partenaire, discute au téléphone le commerce d’armes pendant que la jeune femme manipule avec délice son rouge à lèvres. Chacun ses attributs sexuels, chacun met en place son stratagème amoureux, préliminaires solitaires avant le déclenchement du tourbillon passionnel.
L’objet est bien ce prétexte pour aborder la passion amoureuse et pour figer l’explosion du désir. La pièce de Delphine Coindet en est un bon exemple. Sa sculpture (Fontaine), une fontaine stylisée dont l’eau serait suspendue en l’air, exprime au plus près cette sensation de bien-être, cette fraîcheur du présent et des premières fois que l’on voudrait ne jamais oublier.
Belle conclusion pour fermer le banc de la galerie. Sans pour autant faire oeuvre de manifeste, «Summertime Love» sait mettre l’ensemble de ces pièces dans le même mouvement et le même esprit, en totale adéquation avec l’étrange mécanique du désir et l’aube des grands spectacles amoureux.


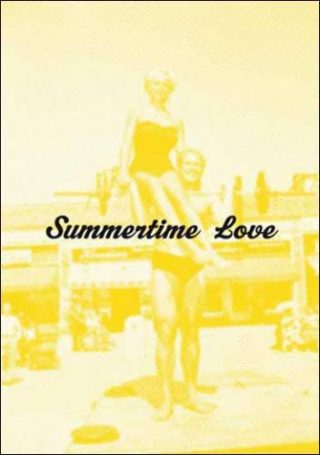


 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram