Telles des passages ou des frontières, les maquettes, les objets et les installations de Sandra Aubry et SĂ©bastien Bourg mettent Ă jour l’insaisissable, les limites du perceptible.
Bettie Nin. Vous travaillez ensemble depuis 2006. Le principe du duo est toujours intrigant: on se demande qui fait quoi, si les tâches sont rĂ©parties ou si vous concevez et rĂ©alisez vos oeuvres Ă quatre mains. Qu’est-ce que le duo vous apporte?
Sandra Aubry. Il n’y a pas de paternitĂ©. On travaille comme un collectif, Ă©normĂ©ment dans l’Ă©change. L’un apporte une idĂ©e, on en discute et parfois on en arrive Ă quelque chose de complètement diffĂ©rent.
SĂ©bastien Bourg. En terme de rĂ©alisation et de mise en forme de ce qui a Ă©tĂ© dĂ©fini, Sandra est plus Ă l’aise dans l’espace et dans le dessin, et moi dans l’objet. Mais il n’y a pas de rĂ´le figĂ©.
Sandra Aubry. La discussion est la phase la plus longue. Et paradoxalement, plus les objets sont gros et le temps de la discussion long, plus la phase de rĂ©alisation est rapide. A l’inverse, plus c’est petit, plus il y a d’expĂ©rimentations.
SĂ©bastien Bourg. Nos projets sont hybrides car teintĂ©s de nos deux visions. Si un projet est rejetĂ© par l’autre, on le met de cĂ´tĂ©.
Comment se déclenche chez vous le processus de création?
SĂ©bastien Bourg. Tout peut partir d’une idĂ©e, d’une phrase. Nous travaillons beaucoup avec les mots Ă la source de nos projets. Nos titres sont importants, ils apportent des clĂ©s ou au contraire les brouillent.
Sandra Aubry. C’est une question assez difficile, car comme nous sommes deux, chacun apportant ses idĂ©es, il y a un certain nombre de projets qui sont mis en attente. C’est donc assez difficile de revenir Ă la source, Ă l’essence mĂŞme de l’idĂ©e… Il y a toujours des restes dans lesquels on puise, un embryon qui se trouve quelque part et que l’on va aller chercher.
SĂ©bastien Bourg. Nous travaillons beaucoup de projets en parallèle. Ils se contaminent l’un l’autre et trouvent l’ordre de leurs formulations les uns par rapport aux autres. Notre travail tient souvent du principe de la rĂ©pĂ©tition, de la variation, de l’idĂ©e de la reprise.
Vous dĂ©veloppez une pensĂ©e qui intègre la dĂ©construction et la reconstruction de signes et d’objets Ă travers le filtre de votre propre fantasmagorie. Quels sont ces objets qui vous interpellent?
Sandra Aubry. Nous ne sommes pas bloquĂ©s dans un registre particulier, mais pour donner une direction, ce serait les objets qui Ă©voquent ce qu’on dĂ©finit comme l’espace transitionnel: des objets qui ont une symbolique assez forte et qui, en mĂŞme temps, peuvent avoir diffĂ©rents sens de lecture, qui sont hybrides dans l’essence mĂŞme de ce qu’ils reprĂ©sentent. Ce sont des objets qui gĂ©nèrent diffĂ©rents positionnements et c’est avec les diffĂ©rents points de vue qu’ils suscitent que nous essayons de jouer.
SĂ©bastien Bourg. C’est rĂ©ellement moins les objets qui nous intĂ©ressent que la manière de les dĂ©tourner, en travaillant ces objets ou ces espaces comme des signes.
La majoritĂ© de nos pièces ont un effet visuel assez immĂ©diat et sont en apparence assez simples. Nous les traitons pour qu’elles deviennent complexes et proposent des perceptions contraires Ă la première impression que l’on a pu avoir. Nous voulons saisir leur potentiel de transformation en les figeant dans un instant de ce processus. Nous dirigeons donc naturellement notre travail vers les notions d’absence, de frustration, ou comment remplir ces objets de manque pour en dire le plus avec le moins possible. C’est pourquoi bien souvent nos pièces rĂ©clament un aspect assez minimal.
Vous participez souvent Ă des rĂ©sidences, Ă la Galerie L MD Ă Paris, Ă l’H du Siège Ă Valenciennes, au Centre hospitalier Vauclaire de Montpon-MĂ©nestĂ©rol, aux anciennes Forges de Belleville, Ă la RĂ©sidence est-nord-est de Saint-Jean Port-Joli, au Canada … Les abordez-vous comme une exposition classique, ou bien le travail in situ fait-il Ă©merger de nouveaux questionnements?
SĂ©bastien Bourg. C’est rare que nous fassions du «pur» in situ. Nous amenons toujours des bribes d’idĂ©es qui deviendront ensuite par compromis et adaptation des pièces liĂ©es aux lieux qui les accueillent.
Changer souvent de lieu de travail implique une gymnastique Ă travers toutes les Ă©tapes qui mèneront de la dĂ©stabilisation Ă l’adaptation. La question des habitudes, la limite entre l’Ă©tranger et le trop familier, fait d’ailleurs partie de nos thèmes. Certains de nos travaux abordent cette question de l’habitude dans la manière de se constituer des repères.
Sandra Aubry. Il y a tout de mĂŞme des pièces qui naissent du contexte. Par exemple au Canada, certaines sont nĂ©es de cette expĂ©rience du pays, du fait de l’Ă©loignement vis-Ă -vis de nos vies respectives… En France, les rĂ©sidences ont tendance Ă se ressembler, ne serait-ce que dans l’isolement qu’elles proposent, volontairement ou non. Mais de manière gĂ©nĂ©rale, nous restons ciblĂ©s sur nos lignes directrices et c’est assez rare que nous fassions des pièces exclusivement pour le lieu d’accueil.
SĂ©bastien Bourg. La rĂ©sidence est un compromis entre l’artiste et la structure. Nous tenons toujours Ă ce que les pièces issues d’un espace particulier conservent leur indĂ©pendance dans la lecture que nous en aurons lors de leur rĂ©-exposition dans le lieu suivant.
Lors de la rĂ©sidence au centre hospitalier spĂ©cialisĂ© en psychiatrie Vauclaire, Montpon-MĂ©nĂ©strol, vous avez conçu le Cyclope, une sculpture en granit noir munie d’un oeilleton. Parlez-nous de cette oeuvre et du rapport qu’elle entretient avec un lieu aussi atypique?
Sandra Aubry. Cette forme est une schĂ©matisation du crâne. Pas dans un contexte de vanitĂ© mais bien dans l’image du crâne et ce Ă quoi il renvoit. C’est une enveloppe, un contenant, qui nous permet grâce Ă l’œilleton de voir le contenu. Il y a une dualitĂ© d’ĂŞtre en mĂŞme temps Ă l’intĂ©rieur et Ă l’extĂ©rieur.
SĂ©bastien Bourg. Le petit granit belge est le rĂ©sultat d’un amalgame de boue et de mollusques Ă un âge très ancien. Ici l’intĂ©rieur est l’extĂ©rieur, puisque ce qui le constitue est visible sur ses faces. Le lieu de l’hĂ´pital est bien sĂ»r un lieu de portes, de seuils, d’ouvertures, de fermetures et d’isolement, mais cette idĂ©e d’intĂ©rieur et d’extĂ©rieur se trouvait dĂ©jĂ dans notre rĂ©flexion sur les limites. C’Ă©tait intĂ©ressant de compulser cela avec la figure de l’oeilleton, du judas…
Sandra Aubry. … Qui est bien sĂ»r extrĂŞmement prĂ©sent dans l’hĂ´pital. Cet objet porte une signification lourde et n’a pas la mĂŞme portĂ©e suivant le lieu dans lequel il est installĂ©.
SĂ©bastien Bourg. La relation intĂ©rieur / extĂ©rieur que l’œilleton Ă©tablit est totalement inversĂ©e Ă l’hĂ´pital. C’est le rĂ©sident qui est Ă©piĂ©. Ce retournement pose le spectateur dans une position de voyeur, souvent avec amusement. Or dans le contexte de l’exposition Ă l’hĂ´pital, cet amusement s‘effaçait au profit d’un engagement de la part du visiteur beaucoup plus lourd de significations.
En regardant dans l’œilleton, on s’attend Ă voir quelque chose de merveilleux, un petit mystère, le coeur mĂŞme de cette pierre prĂ©cieuse. Mais il n’y a rien Ă voir, juste le noir. Le coeur est justement sur sa membrane, sur ses faces, lĂ oĂą sont visibles ces mollusques et l’âge de la pierre. C’est l’idĂ©e d’un retournement comme une peau. L’œilleton devient un objet de dĂ©tournement qui invite Ă voir dedans et frustre le regard pour mieux le ramener ensuite sur sa surface extĂ©rieure.
Vous avez participĂ© Ă l’exposition «Imaginez maintenant» au Centre Pompidou-Metz. Comment s’est passĂ©e la collaboration avec ce musĂ©e prestigieux?
Sandra Aubry. Le festival «Imaginez maintenant» intervenait juste après l’inauguration et avait lieu en face du Centre Pompidou-Metz, dans une ZAC complètement vierge, en terre battue, sur laquelle est prĂ©vue la construction d’une «ville du futur», un quartier mixte oĂą se cĂ´toient commerçants, entreprises, habitations, etc… Un nouvel urbanisme. La thĂ©matique Ă©tait basĂ©e sur le passĂ©, le prĂ©sent et le futur de cet espace en friche. En fait, sous le sol de la ZAC, se trouvent les vestiges d’un vieil amphithéâtre gallo-romain. Sur les bases de ce passĂ© enterrĂ©, il y avait cette idĂ©e du prĂ©sent avec le nouveau musĂ©e, crĂ©ant le lien avec le futur quartier.
Il Ă©tait important de s’appuyer sur ce contexte patrimonial existant et Ă venir. Nous avons donc prĂ©sentĂ© That’s all, folks, un carton gĂ©ant retournĂ© posĂ© face au nouveau musĂ©e. La sculpture Ă©tait ouverte sur deux faces opposĂ©es et les visiteurs la traversaient en passant sous une grotte blanche stylisĂ©e. Il y avait un petit clin d’oeil Ă l’inauguration, un musĂ©e Ă peine dĂ©ballĂ©. La grotte incarne le premier lieu d’exposition, les prĂ©mices de l’art, la première galerie. Grotte et carton compulsent deux univers dans une image d’un musĂ©e potentiellement mobile. L’esthĂ©tique «parc d’attraction» de cette sculpture-installation et son titre se prĂŞtaient bien aussi Ă ce type d’Ă©vènement, entre exposition et manifestation ludique.
Pour votre résidence actuelle à la galerie L MD, vous avez choisi de repenser des oeuvres antérieures. Pourquoi et quelles oeuvres en particulier?
Sandra Aubry. L’idĂ©e Ă©tait de travailler sur deux pièces existantes, le Cyclope et les puzzles No signal et More no signal, comme les bases d’un essai de reprises et de variations sur notre travail. Nous avons une pratique du dessin que nous ne montrons jamais et qui nous sert dans la phase prĂ©paratoire de nos projets.
Nous voulions mettre en place un procĂ©dĂ© inversĂ© en retravaillant en 2D des volumes dĂ©jĂ rĂ©alisĂ©s. Il ne s’agit pas de montrer le temps des croquis mais de revisiter en 2D — sous forme de dessins, de collages — les notions fortes de ces deux pièces.
Sébastien Bourg. Le projet prétexte de cette résidence a par conséquent un peu évolué et les dessins ont pris de plus en plus leur autonomie. Nous allons réaliser deux séries de dessins et de collages, toujours dans cette idée de revisiter des oeuvres antérieures, mais en confrontant assez librement des images et des thèmes récurrents.
Vous Ă©voquez souvent «l’espace transitionnel». Est-ce pour vous une topologie, c’est-Ă -dire un lieu physique, ou plutĂ´t un concept?
SĂ©bastien Bourg. C’est un espace au sens large. On utilise ce terme car il a une forte connotation dans diffĂ©rents domaines.
Sandra Aubry. Il vient de la psychanalyse et du terme «objet transitionnel». On l’a adaptĂ©, en parlant d’«espace transitionnel», dans notre pratique du volume, de la perspective et de l’espace. On le transpose dans une notion qui est Ă la fois tridimensionnelle et temporelle.
SĂ©bastien Bourg. Nous avons nommĂ© très tĂ´t cette notion car elle dĂ©finit assez bien nos directions. L’espace transitionnel est un terme gĂ©nĂ©rique qui nomme les Ă©carts, ce qu’il y a entre les choses, les transformations et les absences entre deux Ă©tats, entre deux opposĂ©s.
Sandra Aubry. C’est tout le cĂ´tĂ© insaisissable et infime qui se situe Ă la frontière des contradictions, qu’elles soient plastiques, conceptuelles, spatiales, identitaires,…
SĂ©bastien Bourg. Nos travaux sont des symptĂ´mes de l’espace transitionnel, dans le sens oĂą ils essayent de l’incarner le plus possible.
Vous concevez des maquettes de micro-architectures: la Scène, Couloir 1 Euclide, Mise en abĂ®me… Quel rapport entretenez-vous avec l’architecture et avec l’installation?
Sandra Aubry. L’Ă©cart entre la maquette et l’installation est Ă lui-mĂŞme un espace transitionnel. C’est le rapport de l’Ă©cart entre l’Ă©chelle 1 Ă l’Ă©chelle de la main. On passe d’une projection mentale dans la maquette Ă une dĂ©ambulation physique, une immersion dans l’installation. Il nous arrive d’exposer Ă la fois des maquettes et des rĂ©alisations Ă l’Ă©chelle 1 en jouant sur ce double positionnement.
SĂ©bastien Bourg. Nos maquettes sont parfois des objets de travail, de recherches, mais pas forcement de futures rĂ©alisations Ă l’Ă©chelle 1. Elles fonctionnent alors très bien comme objets de projection. La maquette crĂ©e du lien tout de suite, il y a un cĂ´tĂ© enfantin, fascinant, un rapport au jouet, au petit espace que l’on domine et dans lequel on peut facilement se projeter.
Sandra Aubry. MĂŞme si l’architecture, c’est du dessin, de la construction, de la projection, des squelettes, des revĂŞtements, des espaces ouverts, fermĂ©s, etc… ce qui nous intĂ©resse n’est pas tant l’architecture que l’espace construit constituĂ© de seuils et de passages, qu‘il soit physique ou mental.
Sébastien, avant tes études aux Beaux-arts de Rennes, tu as obtenu une Maîtrise de Lettres Modernes. Vos détournements de signes procèdent souvent de la métaphore. La littérature, la poésie, la philosophie vous influencent-elles?
SĂ©bastien Bourg. J’y suis sensible. Moins pour la question poĂ©tique, mais j’ai appris Ă manier diverses sciences humaines comme des outils menant Ă l’analyse. Cela offre un jeu de filtres qui permet d’aborder un mĂŞme thème sous diffĂ©rents angles.
La notion de signe nous intĂ©resse en tant que verbe matĂ©rialisĂ©, Ă qui on donne une chair. Nous avons souvent un lien au langage verbal Ă travers nos titres qui sont mĂŞme parfois bavards, mais il s’agit plus de slogans que d’un vĂ©ritable langage poĂ©tique.
Le langage est un système utilitaire avant que d’ĂŞtre poĂ©tique. Le parallèle avec notre travail plastique se situe peut-ĂŞtre dans le dĂ©tournement que nous opĂ©rons souvent sur des objets/espaces existants qui ont une utilitĂ© propre. C’est le potentiel de cette utilitĂ©. Le rapport que nous entretenons avec, Ă travers des apprentissages et des automatismes, devient un espace qui peut se complexifier et se troubler. La mĂ©taphore quant Ă elle est un des outils d’une palette bien plus grande.
Vous exposez dans des lieux qui ne sont pas toujours institutionnels: des hĂ´pitaux, des Ă©coles, des jardins, etc… Dans votre travail, les frontières entre les arts deviennent floues: graphisme, architecture, design, littĂ©rature, tout se mĂŞle. Fluxus vous inspire-t-il?
Sandra Aubry. On ne se rattache Ă aucun mouvement particulier. Certains artistes revendiquent une appropriation ou un lien très fort Ă tel courant ou Ă tel regard. Ce n’est pas notre manière d’envisager les choses. Notre travail est une forme d’hybridation, on le nourrit de tout… Ă l’image de notre Ă©poque oĂą tout se brasse et se mĂŞle.
Et l’humour?
Sandra Aubry. L’humour participe du dĂ©calage: il y a souvent plusieurs degrĂ©s de lecture et une facture ludique mais qui vient soulever un propos plus lourd, voire plombant. Nous jouons de cette contradiction.
SĂ©bastien Bourg. Le risque dans ce genre de dĂ©marche — et ce que l’on essaie d’Ă©viter Ă tout prix — est de tomber dans la blague et l’anecdotique.
Que pensez-vous de la place de la Culture en France et des moyens mis en oeuvre pour l’Ă©mergence des jeunes artistes?
Sandra Aubry. C’est assez contradictoire. Il y a parfois des budgets Ă©normes dĂ©ployĂ©s pour les jeunes artistes, en dĂ©pit du reste. Il y a une volontĂ© de montrer sans pour autant en retour rĂ©munĂ©rer convenablement les plasticiens. On peut parfois avoir l’impression d’ĂŞtre lĂ seulement pour animer, pour faire vivre un lieu ou une institution, le rĂ©sultat semblant importer moins que ses acteurs.
Sachant bien sĂ»r que beaucoup de jeunes artistes sont au RSA, alors qu’ils travaillent quotidiennement… Les sommes engagĂ©es dans les productions et la rĂ©munĂ©ration des autres corps de mĂ©tier sonnent un peu en dĂ©calĂ©.



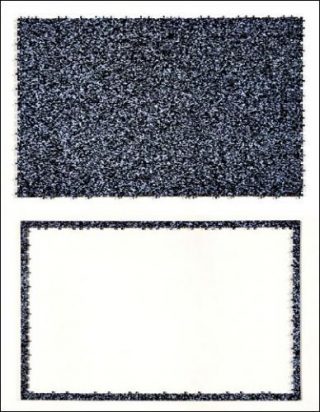



 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram