Ce qu’on remarque d’abord, c’est ce qui manque, ostensiblement: une exposition sans titre, sans communiqué de presse, sans cartel explicatif, où s’égrènent sans logique apparente des œuvres aux formes incertaines. C’est donc à la fois affranchi de tout bavardage et privé de repères que l’on déambule dans l’espace élargi de la galerie, parcours erratique qui voudrait dégager un sens, du moins des résonnances, une combinaison possible au sein de cet ensemble hétéroclite de vidéos, de photographies, de dessins à peine individualisés.
Ici l’exposition se renie comme media entre l’objet et le spectateur; elle délaisse du moins son rôle principal, celui de machine à communiquer: les mots ne viendront pas parasiter les choses. Créer des «vacuoles de non communication» (Deleuze), l’acte est politique à n’en pas douter. En outre, en évacuant de l’espace de l’exposition les effets de mise en scène, Trisha Donnelly réplique de manière assez réjouissante à une tendance lourde de l’art contemporain, où la figure ambiguë du curateur semble supplanter celle de l’artiste proprement dit et s’arroger ainsi le monopole d’une créativité souvent réduite à un art de la belle vitrine.
Ceci dit, ce parti pris est à double tranchant: un refus aussi explicite des signes habituels de l’exposition focalise paradoxalement l’attention sur ce dispositif même d’exposition, de sorte que l’on reste perplexe devant un choix dont on ne sait pas très bien s’il dénonce ou s’il extrémise les dérives de l’art contemporain.
A l’égard de la théorie, la radicalité de Trisha Donnelly est moins tabula rasa que mise en évidence d’impasses conceptuelles.
Dans les faits, la suppression de ces conventions tacites ne nous ramène pas en tout cas à la pureté idéale d’une exposition où les objets seraient simplement… exposés. Un coup d’œil suffit pour comprendre que le corpus d’œuvres présenté ne bénéficie pas vraiment de la disparition de tout élément contextuel: ce n’est pas une mise en valeur.
Sans formes mais pourtant pas informes, pas plus abstraits que figuratifs, à la fois immatériels et triviaux, ces objets trop anodins pour être étranges échappent aux catégories de l’histoire de l’art. De même pour les considérations techniques: le traitement minimal et non spécifique du médium abolit ses qualités propres, ajoutant ainsi à l’indétermination.
Le dessin perd ses contours, la photographie se trouble, et la vidéo projette moins des images que d’abstraites taches colorées. Un symbole peut-être: un montage vidéo où une sculpture de chérubin se voit progressivement couverte de plages lumineuses sans couleur ni consistance, comme si l’indistinction gagnait peu à peu ce que l’art a de plus conventionnel.
Ce n’est pas abscons, c’est atone. En débarrassant son travail des marques distinctives de l’Art, Trisha Donnelly donne à voir une série de signes indéchiffrables: sans contexte, pas d’identité. Ses œuvres ne produisent aucun effet, sinon peut-être une suspension du temps inhabituelle, comme si l’on butait sur une création tout juste embryonnaire, au devenir figé.
Pas de flamboyance ici, pas de spectacle, ni de démonstration: l’art est un avorton. Le spectateur plisse les yeux et fronce les sourcils, il a beau faire, rien n’advient; l’objet reste au stade de la chose.
Que subsiste-t-il alors ? Un art sans qualités, en deçà des mots, au-delà des images. D’où un sentiment final équivoque: la radicalité de Trisha Donnelly débouche sur un art si ténu, à l’équilibre si précaire, qu’elle ne saurait tenir lieu de modèle; ce n’est pas une proposition, c’est un point limite.



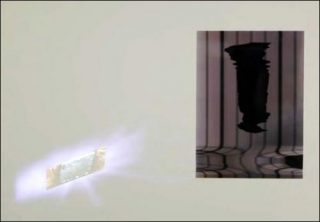

 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram