Elisa Fedeli. Vos prédécesseurs, Jérôme Sans et Nicolas Bourriaud, ont fondé le Palais de Tokyo en 2002. Vous en êtes le nouveau directeur depuis 2006. Dans quelle mesure cet établissement est-il empreint de la personnalité de ses directeurs?
Marc-Olivier Wahler. Mes prédécesseurs ont défendu le Palais de Tokyo dans un contexte assez difficile, où tous les six mois on remettait en jeu son existence. Leur tâche a d’abord consisté à le pérenniser. Il y a quelques années, l’art contemporain était beaucoup moins populaire qu’aujourd’hui. Ils ont néanmoins réussi, en peu de temps, à imposer ce site extraordinaire sur la scène internationale. Ce qui a fait leur succès était, je crois, une programmation basée sur l’événement.
Je suis arrivé dans un contexte tout à fait différent, le Palais de Tokyo commençant à être consolidé. Par conséquent, j’ai pu davantage orienter la programmation vers des expositions.
Selon moi, un lieu doit vivre au rythme des visions de ses directeurs. De plus en plus, les lieux d’art se développent en «auberge espagnole» car il faut faire plaisir aux politiques, aux sponsors, au public, etc. Au lieu de l’art, on finit par faire de la culture. Au contraire, au Palais de Tokyo, il est possible de développer une identité artistique forte. C’est un lieu pour les artistes, orienté vers la production et la recherche.
Vous évoquez la médiatisation récente de l’art contemporain. Que pensez-vous d’une manifestation comme la Nuit Blanche?
Marc-Olivier Wahler. Elle est typique du devenir actuel de l’art contemporain. On le connaît aujourd’hui à travers des événements-vernissages, qui ne durent pas, comme les foires, les biennales, la Nuit Blanche… Tout y est concentré pour un feu d’artifice. Cela rassure les gens car il y a un effet de consommation immédiate.
Mais ce ne doit pas être une priorité. Les artistes ne travaillent pas seulement pour un objet fini, ils s’investissent dans un processus. Il faut donc des lieux, comme le Palais de Tokyo, pour les suivre dans la durée et soutenir leurs productions.
Il y a donc aujourd’hui deux facettes: d’une part l’art orienté «événements», d’autre part l’art orienté «expositions». La seconde est moins médiatique, plus compliquée car tournée vers la recherche. Mais elle est, à mon sens, plus proche de ce que les artistes développent.
Régulièrement, les politiques remettent en question la destination actuelle du Palais de Tokyo, envisageant tantôt le partage de ses locaux avec le Centre Pompidou, tantôt son ouverture au design et à la mode. Est-il réellement pérennisé dans sa configuration actuelle?
Marc-Olivier Wahler. Oui, le Palais de Tokyo est aujourd’hui pérennisé et il bénéficie du soutien des structures publiques. Pour être fort, il doit montrer une offre artistique la plus variée possible. Le grand danger serait de créer des catégories, comme on aime tant le faire en France! Quand un lieu d’art vieillit, il a de toute façon tendance à construire des frontières. Or, les artistes s’intéressent à tous les domaines. Je pense que le Palais de Tokyo doit montrer l’exemple en faisant de tout, mais avec une identité artistique très forte. C’est pourquoi on y expose l’art du Moyen-Age à nos jours, en passant par la peinture des années 1960.
Parmi la scène émergente, est-il possible de déceler des tendances?
Marc-Olivier Wahler. Oui. Depuis le début des années 2000, on voit dans les écoles d’art une passion nouvelle pour une peinture «romantico-post-conceptuelle», où l’on redécouvre la pâte et le réalisme, tout en la teintant d’un certain conceptualisme.
Il y a eu aussi un regain très fort pour le dessin en 2002-2003.
Autre exemple, le mouvement originaire du Lower East Side à New York est né en réaction à cette peinture. Il se caractérise par le choix de matériaux pauvres (toile, papier, carton) et par un retour au minimalisme dans sa forme matérielle.
Ce ne sont là que trois exemples parmi une multitude de tendances.
On parle depuis plusieurs années d’un manque de visibilité de la scène française à l’étranger. Qu’en est-il aujourd’hui?
Marc-Olivier Wahler. A New-York où je vivais en 2002-2004, j’accueillais beaucoup d’artistes français pour les mettre en relation avec des galeristes et des critiques d’art. Je me suis aperçu qu’à l’étranger, prévalait l’équation artiste français = artiste officiel, en raison des nombreuses opérations nationales organisées par la France à l’extérieur.
Une autre légende urbaine circulait: on pensait que les galeristes français n’avaient pas besoin de vendre car ce sont les FRAC qui achètent. C’est en réalité totalement faux!
Aujourd’hui, la situation a complètement changé. On ne voit plus du tout les artistes français comme des artistes officiels. C’est très important car l’image qui les handicapait à l’époque a été battue en brèche. Les artistes français de la nouvelle génération ont davantage envie de travailler avec l’étranger. Ils réfléchissent différemment, avec d’autres références que leurs aînés. Ils savent qu’ils ne doivent compter que sur eux-mêmes.
Vous avez travaillé dans des institutions culturelles en Suisse et aux Etats-Unis. En comparaison, que pensez-vous de la politique culturelle française en matière d’art contemporain? Quels en sont les points forts et les points à améliorer?
Marc-Olivier Wahler. En Suisse, la situation est différente car la tradition de l’art contemporain remonte au XIXe siècle. La plupart des structures culturelles sont privées. Le public a l’habitude de les soutenir par des Sociétés d’amis, des ventes aux enchères, etc.
La France met souvent du temps à s’adapter aux conjonctures internationales mais, quand elle se lance, elle ne fait pas dans la demi-mesure et sait se rendre efficace immédiatement. Aujourd’hui, elle est un pays leader en matière d’encouragement au mécénat. Elle produit des manifestations absolument inédites, elle encourage l’accès à la culture, elle aide les artistes, elle est le garant de la pérennité des structures. La synergie entre le public et le privé y est plus efficace qu’ailleurs. C’est épatant!
Le Palais de Tokyo est financé à 50% par le domaine privé. Quels sont les avantages et les dangers d’un tel système?
Marc-Olivier Wahler. Je pense que la bonne formule est une variation la plus grande possible dans les apporteurs de fonds, ce qui empêche de créer une majorité.
On est obligé de privatiser les espaces du Palais de Tokyo entre deux expositions, notamment pour la Fashion Week. Tout est possible, à certaines conditions. Les frontières doivent rester très strictes, pour que le public puisse faire la différence.
Notre effort principal consiste à défendre un programme artistique sans concession.
De plus, tout ce qui se fait au Palais de Tokyo doit se faire avec les artistes, c’est notre règle numéro 1. Dans ce cas, les contraintes peuvent aussi devenir sources de création.
Selon vous, une œuvre doit-elle répondre à certaines exigences?
Marc-Olivier Wahler. Non, il n’y a pas de critères. C’est totalement subjectif. Mon critère personnel, absolument pataphysique, c’est le «quotient schizophrénique d’une œuvre». Plus le quotient schizophrénique d’une œuvre est élevé, plus elle permet l’apport de couches d’interprétation différentes et successives, plus elle gagne en efficacité. Pour moi, une œuvre qui n’accueille qu’une seule interprétation, c’est du design!
Y a-t-il des médiums et des problématiques qui vous attirent plus que d’autres?
Marc-Olivier Wahler. Non, pas du tout. Je ne pense pas qu’une œuvre doive traiter d’un sujet. Une bonne œuvre traite de politique, de philosophie, de tout en même temps. Si elle se veut uniquement politique, elle ne m’intéresse pas car elle empêche le «quotient schizophrénique» de se développer.
Votre voisin, le Musée d’art moderne de la ville de Paris, a interdit aux mineurs l’exposition du photographe américain Larry Clark, provoquant une polémique assez virulente. Celle-ci vous paraît-elle justifiée?
Marc-Olivier Wahler. C’est une très bonne idée, quand on voit la foule! En terme de stratégie publicitaire, le Vatican ne ferait pas mieux!



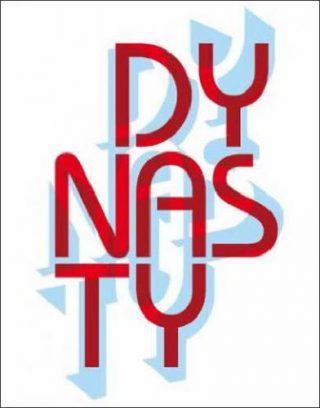
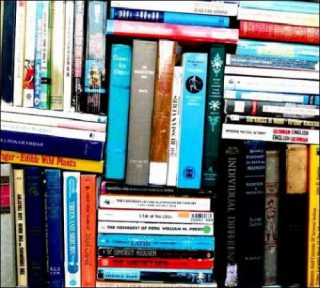

 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram