Avec Pompéi, Caterina Sagna ne s’attaque plus à un texte, à un auteur (comme elle l’a fait avec Genet, Cocteau, Kafka, Rilke, Valéry ou Loyola), mais à ce qui reste d’humain au-delà des mots, quand les sources testimoniales manquent, et que le regard seul cherche à comprendre ce qui a été mis au jour. La ville de Pompéi mais surtout ses habitants, figés par la lave et la poussière, puis le plâtre, et enfin la mémoire collective, constituent donc le point de départ d’une pièce qui prend pour sujet le corps et sa représentation, et par-là même problématise le mouvement face à l’immobilité.
Le programme est alléchant, ambitieux, et l’on attend avec impatience de voir la chorégraphe mener sa fouille : comment la danse va-t-elle pouvoir révéler un savoir jusqu’ici illisible ? Au-delà d’une étude de l’habitus, qui éclaire les techniques de corps et parle immédiatement de notre histoire personnelle et collective, on ne sait trop quoi imaginer.
C’est pourtant autre chose dont il est question. Car Pompéi est une exception, un des rares sites où l’humanité s’est trouvé figée pour l’éternité dans sa forme, en une image, presque un instantané, au lieu de simplement laisser des traces de son passage : au mieux un corps savamment disposé dans une tombe, le plus souvent des restes, scories d’une activité technique, d’un savoir et d’une pensée humaine.
Ici, ce qui fait sujet, c’est le vivant escamoté par l’image et ce faisant rendu immortel. Double mouvement, paradoxe, traduit par une scénographie épurée : trois danseurs affrontent trois images projetées, trois vidéos de femmes en noir et blanc, qui les dominent par leur taille, leur frontalité triomphante, mais surtout leur extraction du temps. Deux régimes d’images cohabitent, deux temporalités qui, le spectacle avançant, condamnent les danseurs à affronter la cruauté de leur devenir mortel.
Caterina Sagna nous expose « le mystère fondamental de la forme, son scandale le plus secret ». Face à la représentation, « moment fécond » choisi parmi une continuité temporelle, le flux de la danse semble vain. Confrontées aux trois corps vivants sur scène, les femmes filmées en noir et blanc, même si elles conservent leur mouvement, accèdent tout naturellement au statut de figure. On songe aux Parques, qui mettent justement en scène la fragile temporalité de la vie humaine. Sur scène un drap blanc figure la lave ou la mer, milieu indéfini d’où surgissent les danseurs, grand voile animé justement par des fils et qui servira d’écran aux projections. Ce voile blanc, semblable à celui de Loïe Fuller, permet dans Pompéi, non pas la transformation des corps, mais leur anéantissement progressif. D’une entrée triomphale, accompagnée de danses espiègles, vivantes, les danseurs s’acheminent vers l’immobilité, l’écroulement au sol en un tas informe, un magma inerte.
Des images fortes dominent ce spectacle, qui souvent égare le spectateur, perdu entre les deux régimes de représentation et un surplus de texte. Difficile de prendre du plaisir à voir les trois magnifiques interprètes faillir dans cette lutte, à ne pas pouvoir embrasser la vidéo en même temps que le vivant, et donc à expérimenter, nous aussi, l’échec et la perte.
— Chorégraphie : Caterina Sagna
— Dramaturgie : Roberto Fratini Serafide
— Scénographie et costumes : Tobia Ercolino
— Conseiller musical : Luca Berni
— Lumière : Philippe Gladieux
— Réalisation et montage vidéo : Daniele Riccioni
— Interprétation : Alessandro Bernadeschi, Antonio Montanille, Maura Paccagnella
— Interprètes vidéo : Viviane De Muynck, Maria Fossati, Elena Paccagnella

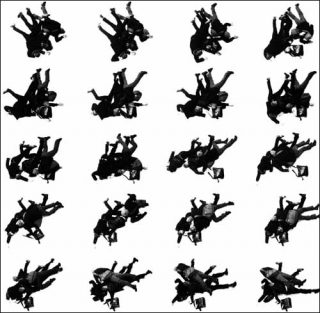

 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram