— Éditeur : Cercle d’art, Paris
— Collection : Pérégrines
— Année : 2003
— Format : 23 x 16 cm
— Illustrations : nombreuses, en couleurs et en noir et blanc
— Pages : 143
— Langue : français
— ISBN : 2-7022-0693-X
— Prix : 38 €
Un arbre n’est pas un arbre
par Maryline Desbiolles
(extrait, pp. 20-21)
Pour Pagès un arbre n’est pas un arbre, un arbre n’est jamais seulement un arbre. Sa vision n’est pas une vision pieuse. Ni pieuse, ni sentimentale. Même dans le dessin au crayon de 1965 (ne rêvons-nous pas notre vie ?), l’arbre n’a plus rien du figuier qu’il représente (Figuier (Coaraze)), il n’évoque pas la plénitude de l’automne lorsque cet arbre-là est en majesté, il est dépourvu de tout fruit et de toute feuille, c’est son squelette qui apparaît, ses entrelacs de branches qui pourraient tout aussi bien être de métal, ses courbes aberrantes comme forcées, l’équilibre trop tendu de sa charpente, sur le point dirait-on de s’effondrer au premier coup de vent.
À l’opposé des artistes de l’Arte Povera (pour parler d’artistes de la même génération) qui extraient l’arbre de la forêt, l’ornent, l’enchantent, le dorent (l’adorent) jusqu’à rendre sa mise à mort présentable (on dit aussi « poétique »), à l’opposé de l’icône de l’arbre, de l’arbre qui cache la forêt, puissante mais aussi hostile, dangereuse, Pagès brûle l’arbre, l’entaille, le hérisse de pointes, l’enveloppe de fil de fer, jusqu’à le rendre méconnaissable ou plutôt jusqu’à lui faire rendre gorge, jusqu’à ce qu’il délivre tout ce que l’habile homme peut tirer de lui, Pagès conjure la forêt qui gagne du terrain si on n’y prend pas garde, il conjure l’obscurité qu’il a en horreur (je pense à la trouée de lumière rose qu’il peint en 78 sur les troncs de la sombre forêt de Neuenkirchen en Allemagne). On a pu dire de lui qu’il torturait les matériaux, que cela avait quelque chose de prédateur. C’est dire combien notre aveuglement est grand, combien nous avons oublié nos efforts démesurés pour nous protéger du naturel de la nature, de l’hostilité naturelle de la nature que nous avons transformée pour devenir ce que nous sommes. Il n’y a qu’au prix de ce savoir dépoussiéré de toute mièvrerie qu’on peut goûter au chant de l’oiseau.
En vérité l’œuvre de Bernard Pagès est plus difficile à avaler qu’on croit au premier coup d’œil séduit par les couleurs et les tournures jubilantes, car elle ne propose pas une rêverie champêtre, elle ne nous propose pas une mise en boîte de la nature à l’usage du citadin, elle nous parle de notre histoire. Elle nous parle de la lutte que nous menons contre nous-mêmes et contre l’arbre pour reprendre ce fil, lutte émouvante, tourmentée, magnifique. Et en les écrivant je sens combien ces mots sont périlleux eux aussi, avec « magnifique » surtout, le tente le diable.
Or il y a dans le projet de Pagès l’idée de faire quelque chose de beau. Étrangement beau, violemment beau, parfois même péniblement beau mais beau. Voilà qui est très singulier, voilà une œuvre qui ne se défile pas devant le chaotique, le cahoteux, les soubresauts, les contradictions de notre monde et qui affiche, malgré tout, son désir de faire quelque chose de beau. Est-ce à cause de ce mot trop gros, de cette histoire dans laquelle je m’engage (d’abord du bout du pied, un jeu, une esquisse, puis tout le corps immergé là -dedans, la sculpture vous requiert en entier), j’ai du découragement, l’envie de tout laisser tomber.
(Texte publié avec l’aimable autorisation des éditions du Cercle d’art)
L’artiste
Bernard PagГЁs est nГ© en 1940 Г Cahors, France.
L’auteur
Maryline Desbiolles a publiГ© depuis 1980 de nombreux romans, les plus rГ©cents parus aux Г©ditions du Seuil : La Seiche (1998), Anchise (Prix Femina, 1999), Le Petit Col des loups (2001), Amanscale (2002).

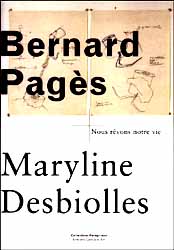

 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram