Interview
Par Samantha Longhi
Beaucoup souhaitent que le Palais de Tokyo devienne une sorte de Whitney Museum Ă la française. Finalement, ne croyez-vous pas que le public attendait cette exposition depuis l’ouverture du Palais de Tokyo?
Nicolas Bourriaud. Je ne crois pas, car la majoritĂ© des artistes reprĂ©sentĂ©s ont dĂ©jĂ fait l’objet d’expositions ici mĂŞme. D’autre part, le Palais de Tokyo est l’institution parisienne qui a le plus soutenu l’art français ces quatre dernières annĂ©es. Par ailleurs, nous pensons que cette exposition n’aurait pas eu le mĂŞme impact, le mĂŞme poids, la mĂŞme ampleur internationale, si elle avait eu lieu plus tĂ´t ou il y a quatre ans. C’est aussi toute la stratĂ©gie du Palais de Tokyo autour de la recrĂ©dibilisation de la scène française qui fait qu’on va pouvoir regarder d’une autre manière les artistes qui la composent. Cela ne pouvait se faire qu’Ă la fin et certainement pas au dĂ©but.
JĂ©rĂ´me Sans. On pourrait dire aussi que lorsque l’on a conçu le Palais de Tokyo en 2002, on l’a fait Ă un moment prĂ©cis dans l’histoire française. Et notre dĂ©sir Ă©tait d’ĂŞtre une sorte de caisse de rĂ©sonance de l’ensemble des Ă©nergies qui composaient Ă ce moment prĂ©cis une nouvelle pliure culturelle française, Ă travers des galeries, des critiques, des magazines, web ou autres, l’apparition d’une nouvelle gĂ©nĂ©ration de personnes que nous avons montrĂ©e et soutenue Ă travers des prĂ©sences: la revue 02 par exemple, des collectifs, des projets interstitiels, etc.
Nous n’avons eu de cesse depuis l’ouverture de penser Ă la scène française Ă travers notre programmation, mais pas comme un Whitney car nous refusons d’ĂŞtre un Whitney. Et c’est l’erreur des français, ĂŞtre un Whitney ne sert Ă rien, le village n’a pas besoin de se parler Ă lui-mĂŞme, le village doit parler dans un contexte international et c’est ce que nous avons fait depuis le dĂ©but. Quand nous avons exposĂ© Melik Ohanian, il n’Ă©tait pas accompagnĂ© d’artistes français mais de ses homologues internationaux pour que des dialogues se crĂ©ent et que nos homologues puissent comprendre ce qui se passe ici mĂŞme. Et, comme disait Nicolas, si nous avions fait cette exposition il y a quatre ans, nous aurions Ă©tĂ© un centre d’art comme beaucoup d’autres, qui n’apporterait rien Ă la scène française. Nous avons eu une approche diffĂ©rente qui a donnĂ© un regain d’intĂ©rĂŞt sur Paris, sur la France. Et le point d’orgue est cette exposition qui existe aujourd’hui comme un rapport d’activitĂ© de ce qu’on a fait pendant quatre ans.
Aucun lieu en France n’a fait un travail aussi permanent et aussi important pour la scène française. C’est pourquoi nous ne comprenons pas comment des rumeurs peuvent naĂ®tre alors qu’on ne fait jamais ce genre de rĂ©flexions sur d’autres institutions Ă Paris ou en rĂ©gion.
Parmi les artistes reprĂ©sentĂ©s, on note la prĂ©sence par exemple de Kader Attia et non Gilles Barbier, Ă©galement celle de Wang Du qui est plus âgĂ© que les autres artistes de l’exposition. Comment votre sĂ©lection s’est-elle donc effectuĂ©e?
N.B. Elle s’est effectuĂ©e de manière naturelle. Nous avons toujours voulu faire une radiographie de la gĂ©nĂ©ration qui a Ă©mergĂ© en mĂŞme temps que le Palais de Tokyo. Il y des artistes qui avaient Ă©videmment une carrière importante avant, mais dont le travail s’est cristallisĂ© Ă ce moment-lĂ . C’Ă©tait une vue très subjective; c’est le tournant du XXe au XXIe siècle qui voit l’apparition d’une gĂ©nĂ©ration et c’est ce qui a dĂ©terminĂ© notre premier choix. Ce n’est pas une question d’âge. Effectivement, il y a des artistes comme Arnaud Labelle-Rojoux ou Wang Du qui sont plus âgĂ©s que les autres mais dont le travail a trouvĂ© son point d’impact au mĂŞme moment qu’une Agnès Thurnauer ou un Adel Abdessemed.
J.S. Cela aurait Ă©tĂ© une erreur de faire une tranche gĂ©nĂ©rationnelle car cela n’existe pas dans le rapport que les uns ont avec les autres. Il est vrai que c’est beaucoup plus juste de mettre face Ă face Arnaud Labelle-Rojoux et Loris GrĂ©aud que des artistes sortis de l’École des beaux-arts. Cela n’aurait aucun intĂ©rĂŞt pour aucun d’entre eux, chacun a des expĂ©riences qui se nourrissent les unes des autres.
Quand Laurent Grasso se retrouve avec Saadane Afif ou avec d’autres expĂ©riences, c’est nourrissant. L’image que nous avons montrĂ©e est une image de la scène française composĂ©e des artistes qui ont la possibilitĂ© d’exister au niveau international, ceux qui ont dĂ©jĂ une reconnaissance europĂ©enne ou qui sont en passe de l’avoir.
Ce n’est pas pour le village, encore une fois, mais pour nos homologues internationaux qui Ă©prouvent de grandes difficultĂ©s Ă tenir un discours cohĂ©rent sur la scène française, Ă avoir une vision claire et nette de l’ensemble des protagonistes.
Les Français ne cessent de se diviser pour parler de la scène française. Tout le monde pleure qu’il n’y a pas de scène française, mais personne n’est d’accord pour parler des mĂŞmes artistes. Donc la question n’est pas de savoir qui sont les artistes absents de l’exposition, mais si l’exposition est cohĂ©rente, forte ou non, symptomatique d’un moment de notre temps en France.
N.B. Tout Ă fait. La pire chose Ă faire, par exemple, aurait Ă©tĂ© de faire une exposition qui aurait contentĂ© tout le monde, une sorte de paysage consensuel de la scène française. C’est tout Ă fait le type de projet qui ne sert Ă rien ni Ă personne et surtout pas aux artistes.
On a vraiment l’impression d’assister ici Ă une exposition historique. C’est la première fois que sont rassemblĂ©s autant d’artistes de la gĂ©nĂ©ration des annĂ©es 2000. Le titre est donc bien choisi…
J.S. Pour aller encore plus loin, c’est une des premières fois qu’une radiographie d’une gĂ©nĂ©ration est faite Ă l’instant «t» et non trop tard. Regardez, la gĂ©nĂ©ration des annĂ©es 90 est une gĂ©nĂ©ration ratĂ©e par les institutions. Chen Zhen, Wang Pang Ping, ou Dominique Gonzales Foerster, Pierre Huygues et autres, n’ont jamais Ă©tĂ© montrĂ©s ensemble au moment de leur apparition.
N.B. La caractĂ©ristique de cette exposition est d’avoir fait une photo en mouvement de ces artistes saisis dans leur Ă©lan et non pas au moment oĂą ils avaient dĂ©jĂ atteint une reconnaissance internationale entière. Cet instant «t» a donc Ă©galement Ă©tĂ© l’image Ă partir de laquelle nous avons travaillĂ©.
J.S. On pourrait dire de plus que la mission du Palais de Tokyo est celle que nous nous sommes donnĂ©e puisque personne ne le faisait. Avant de se prĂ©senter au Palais de Tokyo en 2002, Nicolas Bourriaud et moi-mĂŞme avions dĂ©jĂ le dĂ©sir de faire ce que nous avons prĂ©sentĂ© durant quatre ans. Il y avait un trou considĂ©rable et il y en a encore d’autres Ă combler. On a toujours espĂ©rĂ© que le Palais de Tokyo donnerait envie Ă d’autres de crĂ©er d’autres lieux complĂ©mentaires car c’est lorsqu’il y a compĂ©tition entre diffĂ©rents lieux et que tout le monde travaille ensemble qu’il peut y avoir une vĂ©ritable offre Ă Paris. L’offre n’est pas assez importante Ă Paris curieusement.
Le ministère de la Culture lance cette annĂ©e le projet d’une grande manifestation exposant l’art français qui deviendra biennale au Grand Palais. Y avez-vous contribuĂ©? Qu’en pensez-vous?
J.S. Nous ne sommes pas associĂ©s Ă ce projet. Nous avons annoncĂ© ce projet et Ă l’Ă©poque personne ne pensait faire d’exposition sur la scène française. Depuis cette annonce, Ă la confĂ©rence de presse Ă la dernière Biennale de Lyon, tout Ă coup une avalanche de projets arrive autour des artistes français. Regardons ce qui va ĂŞtre fait…
N.B. EspĂ©rons que trop de passion ne tue pas la passion…
J.S. La question est de savoir comment peut-on comprendre tout Ă coup cette avalanche d’expositions et d’intĂ©rĂŞt pour la scène française dans les mĂ©dias et Ă l’extĂ©rieur. Est-ce que ça ne va pas crĂ©er plus de confusion que d’intĂ©rĂŞt? Et surtout, s’il y a autant de commissaires dans une exposition, comment peut-on donner une position claire et un engagement prĂ©cis sur une scène artistique?
Que répondez-vous à vos détracteurs qui qualifient le Palais de Tokyo de brouillon muséal? Quel bilan faites-vous de votre action?
N.B. Ah le fameux brouillon musĂ©al!! C’est intĂ©ressant de voir qu’on ne considère en France les centres d’art qu’Ă l’aune du musĂ©e. C’est-Ă -dire, la forme du musĂ©e est tellement ancrĂ©e dans les esprits, est tellement l’horizon unique qui devrait dĂ©terminer selon certains observateurs un peu passĂ©istes l’activitĂ© de l’art, que l’on ne peut concevoir une Kunsthalle française que comme un brouillon de musĂ©e. Il ne s’agit pas d’ĂŞtre une avant scène musĂ©ale, le Palais de Tokyo n’a jamais fonctionnĂ© comme cela.
Le Palais de Tokyo est un catalyseur d’Ă©nergies, le lieu oĂą l’on vit la crĂ©ation en train de se faire. Ensuite, le musĂ©e doit faire son travail, mais c’est un autre travail, nous n’intervenons pas en aval du musĂ©e, c’est un autre travail. Il faudrait que les Français le comprennent car on ne se questionnerait jamais sur ce point en Allemagne ou en Angleterre oĂą les rĂ´les sont clairement dĂ©finis. En Allemagne, les musĂ©es ne sont pas des Kunsthalle, des Kunstverein, le problème c’est que les musĂ©es se prennent trop souvent en France pour des Kunstverein ou des Kunsthalle.
J.S. Qui oserait poser cette question Ă la directrice de la Piecewall Ă New York, au directeur du Kunstverke Ă Berlin? Je pense qu’il est typiquement français d’essayer de dĂ©truire les Ă©nergies en train de se faire.
De toute façon, si brouillon il y a, un brouillon n’est jamais nĂ©gatif. Le brouillon existe toujours avant l’Ă©mergence. Les quatre ans passĂ©s ici ont dĂ©montrĂ© que si nous Ă©tions brouillons, c’est exactement ce que demandait le public et ce qu’attendaient les artistes. Nous arrivons Ă près d’un million de visiteurs. Nous sommes le centre d’art le plus frĂ©quentĂ© au monde.
Vous avez contribué à la nomination de votre successeur, Marc-Olivier Wahler, que pensez-vous de son programme à venir?
N.B.. Il nous paraissait capital de transmettre le flambeau de l’institution que nous avons crĂ©Ă©e dans les meilleures conditions possibles. Nous avons tenu Ă organiser un jury composĂ© de personnes du ministère de la Culture, de membres du Conseil d’administration de l’association du Palais de Tokyo et des intervenants extĂ©rieurs de manière Ă pouvoir vraiment choisir en toute connaissance de cause et sur des projets, ce qui est très important pour le lieu.
Par ailleurs, il Ă©noncera son programme en temps voulu. Il nous paraissait essentiel que son projet s’inscrive Ă la fois dans la continuitĂ© de ce que nous avons fondĂ© et en mĂŞme temps d’apporter sa propre touche personnelle car l’idĂ©e est que le lieu sera activĂ© en permanence par de nouveaux directeurs. Nous avions conçu ce lieu comme une plateforme permettant Ă des sensibilitĂ©s diffĂ©rentes de s’exprimer.
J.S. Nous nous Ă©tions engagĂ©s dès le dĂ©part Ă ne rester que quatre ans, Ă la diffĂ©rence de tous les lieux existant en France oĂą, lorsque l’on est placĂ© Ă une direction, on reste accrochĂ© Ă l’arbre.
Étant tous deux indĂ©pendants et n’imaginant pas que nous arriverions Ă la direction d’un lieu aussi important, car il n’y a pas de place pour les gens comme nous qui ne sont pas de la corporation, nous pensions que la France avait besoin d’un lieu diffĂ©rent par son mode de gestion, un lieu de libertĂ©s. Nous avons donc inscrit dans l’ADN du Palais de Tokyo que nous-mĂŞmes, les fondateurs, ne resterions pas plus longtemps que quatre ans de programmation. Nous nous y sommes engagĂ©s et nous les faisons. Il faut changer les mentalitĂ©s, c’est comme ça que la scène française pourra changer dès lors que les gens seront jugĂ©s sur leurs qualitĂ©s et non pas parce qu’ils sont accrochĂ©s Ă un arbre.
Enfin, quels sont vos prochains projets, respectifs et/ou communs? Votre duo va-t-il se scinder?
J.S. Vous savez, quand on vit six ans avec quelqu’un, il est difficile de ne pas imaginer des projets encore communs dans l’avenir. Nous prenons donc chacun une route sĂ©parĂ©e, mais oĂą nous allons nous retrouver de manière rĂ©gulière sur des projets prĂ©cis. Nous avons bien sĂ»r des projets personnels. Je sors un album avec mon duo qui s’appelle Liquid Archiecture, l’album s’appelle Revolution is Over, et il sort le 27 fĂ©vrier chez NaĂŻ;ve, il sera disponible dans les bacs. Une tournĂ©e s’annonce.
J’ai gagnĂ© par ailleurs, il y a un an, un concours avec deux architectes, StĂ©phane Maupin et Mathieu Poitevin, pour un parcours programmatique autour de l’Ă®le Seguin qui devrait avoir lieu d’ici deux ou trois ans.
N.B. Quant Ă moi, outre ce que vient de dire JĂ©rĂ´me sur nos projets futurs communs, je constitue une collection pour une fondation d’art contemporain en Ukraine Ă Kiev, la fondation Victor Pinchuk.
Je monte Ă©galement une exposition l’Ă©tĂ© prochain avec Bertrand Lavier comme co-commissaire qui va s’appeler Contrebande, au Fonds rĂ©gional d’Art contemporain.
Et il y a également une exposition dont je suis commissaire au Musée de Ljubljana cette année.
Il y a donc plein de choses et plein de projets Ă faire. Par ailleurs, je continue Ă Ă©crire, notamment un projet que je n’ai pas eu le temps de concrĂ©tiser depuis ces quatre dernières annĂ©es, qui est un essai sur l’impact de la mondialisation sur l’esthĂ©tique.
J.S. Pour conclure notre prĂ©sence ici, ĂŞtre vivant c’est savoir se rĂ©inventer.









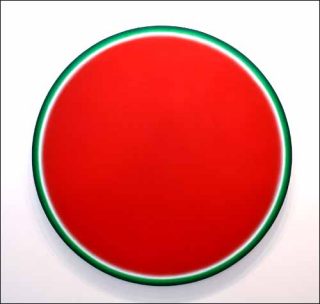


 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram