Interview
Par Doreen Bodin
Paris-art. Depuis 1995, votre galerie est installÃĐe derriÃĻre Beaubourg. Cela a-t-il contribuÃĐ Ã votre dÃĐveloppement ?
Nathalie Obadia. Il y a effectivement plus de passage, mais cela n’augmente pas pour autant la clientÃĻle d’acheteurs avisÃĐs. Quand nous avons ouvert en 1993, nous ÃĐtions situÃĐs dans le Marais. Il y avait dÃĐjà tout un faisceau de galeries importantes comme Thaddaeus Ropac, Yvon Lambert, etc. Cependant, nous avons multipliÃĐ notre surface. Cela permet de rÃĐaliser des expositions de plus grande envergure et de travailler avec une plus grande ÃĐquipe. Lorsque la galerie se dÃĐveloppe, il faut un certain nombre de personnes pour accompagner le travail d’archivage, l’organisation du transport des œuvres, le suivi des dossiers des collectionneurs… Nous avons aussi une plus grande surface de stockage, nous disposons donc d’un plus grand nombre d’œuvres à prÃĐsenter aux clients.
D’une maniÃĻre gÃĐnÃĐrale, qui sont les visiteurs de votre galerie ?
C’est assez variable. Cela va du simple visiteur au collectionneur qui vient acheter des œuvres. Il y a aussi beaucoup d’ÃĐtudiants. Tous les visiteurs n’ont pas les moyens d’acheter car l’art contemporain reprÃĐsente un investissement. Mais à force de visiter des galeries, ils dÃĐveloppent un intÃĐrÊt et un goÃŧt de plus en plus fort pour l’art.
Il faut savoir que les galeries sont en France et dans le monde entier une voie non nÃĐgligeable pour dÃĐcouvrir l’art contemporain. Nous sommes, ne l’oublions pas, des lieux culturels publics. C’est avantageux lorsque l’on est passionnÃĐ de pouvoir voir gratuitement une trentaine, ou mÊme une quarantaine, d’expositions.
Comment les accueillez-vous ?
Là est tout le problÃĻme. C’est vrai que nous mettons un certain nombre d’informations à la disposition du public : classeurs avec le prix des œuvres, curriculum vitÃĶ de l’artiste, articles de presse, catalogues, etc. Les ÃĐtudiants peuvent mÊme pour leur mÃĐmoire consulter les documents de notre bibliothÃĻque. Mais il est ÃĐvident que nous sommes avant tout un espace commercial. Nous n’avons pas le temps de rÃĐpondre à toutes les questions qui nous sont posÃĐes. D’ailleurs cela ne se fait pas non plus dans un musÃĐe.
Qui sont vos acheteurs ?
Là aussi c’est assez variable. Les institutions et les entreprises mises à part, l’acheteur privÃĐ peut Être cadre supÃĐrieur, banquier, avocat, mÃĐdecin, riche homme d’affaires ou rentier. Cela va de ceux qui ont les moyens d’acheter des œuvres d’un certain prix à ceux moins fortunÃĐs pour lesquels l’achat reprÃĐsente un investissement. Mais à vrai dire il n’y a vraiment pas de rÃĻgles.
Les collectionneurs ont-ils tendance à acheter des œuvres disparates ou suivent-ils le travail d’un artiste ?
Cela dÃĐpend de l’ÃĐtendue de la collection, des moyens, et des envies du collectionneur. Selon qu’il dÃĐsire se concentrer sur un ou deux artistes, avoir un panel de crÃĐations picturales ou tout autre mÃĐdium, ou encore se consacrer plutÃīt à une gÃĐnÃĐration… Là aussi c’est trÃĻs variable.
Vous accordez une grande place à la peinture dans vos expositions. Aujourd’hui la scÃĻne artistique internationale s’enthousiasme pour les peintres anglais, allemands ou amÃĐricains. Et les peintres français ?
Lorsque j’ai ouvert ma galerie, en 1993, c’est l’ÃĐtiquette que l’on m’a collÃĐe. J’ai effectivement dÃĐbutÃĐ avec des expositions picturales de ValÃĐrie Favre, Pascal Pinaud, Fiona Rae, Carole Benzaken, etc. Ces artistes commençaient à se faire connaÃŪtre sur la scÃĻne parisienne. Mais la plupart des galeristes de ma gÃĐnÃĐration, bien que relativement indÃĐpendants intellectuellement, ne se sont pas intÃĐressÃĐs à eux, parce que la peinture comme concept ÃĐtait rejetÃĐe à la fin des annÃĐes 1990. D’autres ne voulaient pas les exposer pour des raisons stratÃĐgiques et de marketing.
Les uns et les autres ont maintenant une belle carriÃĻre. Carole Benzaken a reçu le prix Marcel Duchamp 2004. Elle s’impose, dans cette gÃĐnÃĐration, comme la meilleure reprÃĐsentante du courant pictural français, aux cÃītÃĐs de ValÃĐrie Favre. Pascal Pinaud est l’un des meilleurs peintres abstraits de sa gÃĐnÃĐration aprÃĻs Bernard Frize. Il rÃĐinvente la peinture abstraite sans chÃĒssis ni pinceau.
Mais il faut savoir que pendant prÃĻs d’une dizaine d’annÃĐes, les peintres français n’ont pas ÃĐtÃĐ montrÃĐs par nos propres commissaires d’expositions et nos propres musÃĐes, donc aucun peintre français n’apparaissait dans les biennales et les expositions internationales. Si bien qu’ils ÃĐtaient mal considÃĐrÃĐs. Ils n’ont pu s’imposer face aux artistes ÃĐtrangers montrÃĐs partout, ni se raccrocher au train du marchÃĐ mondial.
Justement, on parle de ÂŦ renouveau de la peinture Âŧ, partagez-vous cette idÃĐe ?
C’est du marketing. Elle a toujours ÃĐtÃĐ prÃĐsente. Mais il y a actuellement un regain d’intÃĐrÊt pour la peinture dans le milieu de l’art contemporain, alors on focalise sur elle. Aujourd’hui, tous les galeristes et les institutions se tournent vers les peintres. MÊme ceux qui les rejetaient dix ans auparavant. Malheureusement, on commence à en montrer beaucoup de mauvais, à cause de certains musÃĐes et commissaires qui s’accrochent à la mode.
Il y a six mois, j’ai vu une exposition à l’Espace 315 du Centre Pompidou. Elle se divisait en deux parties avec, d’un cÃītÃĐ, le travail d’un artiste allemand, Magnus van Plessen, et, de l’autre, celui d’une AmÃĐricaine dont j’ai oubliÃĐ le nom [Kristin Baker] : des artistes peintres sans grand talent, tout le monde l’a reconnu. Seulement, quand c’est ÃĐtranger, on considÃĻre que c’est meilleur.
Le marchÃĐ de l’art n’a jamais fait autant de place aux jeunes artistes qui sortent à peine des ÃĐcoles, il n’ÃĐchappe pas à la course aux nouveaux talents. Globalisation et consommation outranciÃĻres ne poussent-elles pas les galeristes à vendre plus qu’à dÃĐvelopper la carriÃĻre des artistes ?
Nous sommes tous responsables de cette accÃĐlÃĐration. Mais je ne suis pas sÃŧre que ce soient les galeristes qui ont donnÃĐ le ton en cette matiÃĻre. La prolifÃĐration des musÃĐes et la multiplication des biennales ont beaucoup jouÃĐ. Il faut bien remplir ces espaces. Quand les peintres, les photographes ou les sculpteurs ne suffisent plus, on va chercher du cÃītÃĐ des jeunes pousses. Ils sont beaucoup plus rentables que les artistes renommÃĐs, trÃĻs chers en matiÃĻre d’assurance et de dÃĐplacement.
Cependant, un jeune talent en vogue prend rapidement de la valeur sur le marchÃĐ, et les collectionneurs ne peuvent pas toujours suivre financiÃĻrement. C’est pourquoi on va plutÃīt se tourner du cÃītÃĐ de la troisiÃĻme gÃĐnÃĐration de la peinture allemande : l’ÃĐcole de Leipzig, par exemple, oÃđ les tableaux ÃĐtaient au dÃĐpart à 5000 euros, et qui en valent maintenant 50 000.
Le marchÃĐ a explosÃĐ en volume parce qu’il y a un emballement. Le nombre des collectionneurs privÃĐs, des musÃĐes, et des institutions qui achÃĻtent, a beaucoup augmentÃĐ. Les demandes ont dÃĐpassÃĐ les offres. Et comme la notion de progrÃĻs en art n’est pas la mÊme que dans d’autres secteurs, la qualitÃĐ ne se multiplie pas.
Dans un tel contexte, comment les artistes peuvent-ils encore prendre le temps de crÃĐer et faire mÃŧrir leur travail ?
Certains artistes sont effectivement soumis à une pression trÃĻs conjoncturelle. Ils doivent rÃĐpondre à des commandes dans des temps trÃĻs courts. Ils paniquent, s’angoissent et acceptent n’importe quelle exposition institutionnelle. Bien qu’ils travaillent avec des galeries sÃĐrieuses qui sont là pour les baliser. Certains ont tendance à se renfermer dans leur atelier. D’autres peignent de plus en plus. Le problÃĻme, notamment en peinture, c’est que ÂŦ plus Âŧ ne veut pas forcÃĐment dire ÂŦ meilleur Âŧ.
Le marchÃĐ de l’art est devenu extrÊmement organisÃĐ et stratÃĐgique. C’est maintenant trÃĻs compliquÃĐ pour les artistes qui produisent sans se soucier de la qualitÃĐ. Mais si sur le court terme on peut jouer sur le marketing, l’idÃĐe ou le sensationnel, sur le long terme, l’objet reste trÃĻs important.
Les politiques et les institutions culturelles françaises ont la rÃĐputation d’Être commercialement peu efficaces, ce qui pÃĐnalise les artistes sur le marchÃĐ international et sur la scÃĻne artistique. DÃĐvelopper des antennes à l’ÃĐtranger, comme vous l’avez fait à New York en 1998, ne serait-il pas un moyen de pallier cette dÃĐfaillance ?
Aujourd’hui, le meilleur vecteur pour montrer et dÃĐfendre les artistes français ce sont les foires et les contacts que nous crÃĐons avec nos confrÃĻres ÃĐtrangers. C’est ainsi que l’on pourra les convaincre, eux et les collectionneurs, de les acheter.
Il est beaucoup plus intÃĐressant d’exposer les artistes français dans une galerie berlinoise ou londonienne rÃĐputÃĐe, à cÃītÃĐ de grands artistes internationaux, que dans une galerie française qui aurait crÃĐÃĐ une antenne à l’ÃĐtranger. Il faut les mÃĐlanger. D’ailleurs les artistes l’ont compris et s’exportent eux-mÊmes. Carole Benzaken est allÃĐe travailler à Los Angeles et ValÃĐrie Favre est partie à Berlin.
Quelques mots sur votre prochaine exposition…
Lorna Simpson est une artiste afro-amÃĐricaine originaire de Brooklyn. Elle travaille maintenant depuis une quinzaine d’annÃĐes, mais c’est sa premiÃĻre exposition en France. Elle vient montrer deux vidÃĐos et un ensemble de photographies. Lorna porte un regard trÃĻs politique sur ses origines qu’elle lie dans ses œuvres à une recherche plastique. C’est ce qui est intÃĐressant. C’est trÃĻs caractÃĐristique dans ses vidÃĐos notamment oÃđ le va et vient entre discours engagÃĐ et quÊte de la beautÃĐ est continuel. Cependant ce n’est pas une œuvre militante car le travail plastique prÃĐdomine.


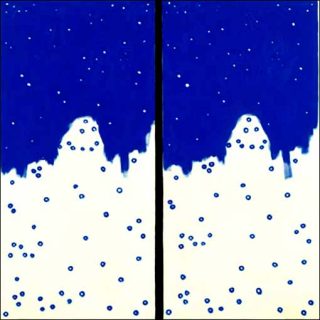





 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram