Eric Corne: L’œuvre de Natacha Nisic correspond ├Ā ce que je voulais montrer au Plateau dans les notions d’effacement, de contemporan├®it├®. C’├®tait important qu’il y ait une monographie au Plateau. Dans l’œuvre de Natacha Nisic, on trouve cette juste distance entre l’œuvre, et ce qu’elle dit. Il y a cette ironie grave, ou cette grave ironie. Par exemple, on peut voir A louer/zu vermieten dans la frontalit├® ou une chute qui se d├®robe…
Ma├½lle Dault: Tu envisages une exp├®rimentation du m├®dium photographique ou vid├®o sur plusieurs niveaux. Tu m├©nes, par exemple, le travail photographique dans diff├®rentes directions: la question de la lumi├©re, la photographie refilm├®e, la superposition de photos dans le mouvement, la photographie mise en sc├©ne, l’affiche… Qu’est-ce qui te pousse ├Ā engager le travail dans cette exploration du m├®dium?
Natacha Nisic: Au d├®part, le m├®dium photographique est pour moi une source d’interrogation, de d├®bat. Je suis en porte ├Ā faux avec la notion de ┬½┬Āphotographie┬Ā┬╗. J’utilise l’appareil photographique comme un syst├©me et la question devient: qu’est-ce qu’on fait de ce syst├©me ? Il faut, par exemple, poser le probl├©me de la d├®clinaison, non pas d’une photographie mais d’une s├®rie de prises de vue car ce n’est pas quelque chose de cern├®, de d├®finitif. Je travaille beaucoup plus sur le mouvement, sur l’espace. La photographie se situerait ├Ā l’int├®rieur de cela, sur ces diff├®rents statuts. Par exemple, lorsque la photographie devient objet dans A louer/zu vermieten, cela donne un autre temps de lecture, et en cela, l’aboutissement final serait 3 x 36 aide-m├®moire, la photo devient un d├®roul├®, une trace du temps. J’ai lu quelque part que la prospective n’est que l’attente… Dans 3 x 36, aide-m├®moire, c’est l’attente de ce qu’on va voir. D├©s qu’on est dans le temps, on est dans cet entre-deux.
Eric Corne: Pourquoi utilises-tu diff├®rents m├®dia: image fixe de la photo et pour le film, le super 8, la vid├®o? Comment adaptes-tu chaque projet ├Ā son m├®dium?
La vid├®o est par exemple une technique qui a son histoire, ses objets mais on ne se pose plus la question des contraintes que peuvent poser entre autres cette technique. Avec le super 8, et ses trois minutes sur la pellicule, c’est un temps qui d├®veloppe l’intensit├® du regard, et par exemple, l’ad├®quation avec la lumi├©re de l’endroit o├╣ l’on est. Au d├®but du cin├®ma, on ├®tait tr├©s conscient de ces contraintes. Etienne-Jules Marey avait mont├® un studio en ext├®rieur, pour des questions de lumi├©re. Je suis sensible aux contraintes que proposent ces techniques. Quand on travaille la vid├®o, il n’y a pas cette id├®e de la pellicule. Le suicide des objets ou Haus sont des œuvres o├╣ l’on n’est pas dans une r├®flexion sur la photographie, mais sur le flux, le temps. Etre sensible ├Ā un mode de pr├®hension du r├®el. Voil├Ā sans doute ce que je tente.
Ma├½lle Dault: Tu poursuis un travail qui est ├®troitement li├® aux questions de la reproductibilit├® des images. On le per├¦oit dans l’exposition ├Ā travers le passage d’un m├®dium ├Ā un autre. En m├¬me temps, il y a une v├®ritable immat├®rialit├® dans ton travail li├®e au m├®dium de la vid├®o. Comment envisages-tu ce passage entre mat├®rialit├® et immat├®rialit├® de l’image, œuvre unique et multiple ?
J’ai souvent envisag├® l’exposition comme quelque chose qui s’approche du visible. Durant un temps donn├®, j’investis un espace comme une maison au sens propre, une maison comme un lieu qui accueille, comme un espace qui rend visible. Dans la premi├©re phase de mon travail, je suis dans quelque chose qui est ├Ā la fois extr├¬mement concret, mais aussi tr├©s immat├®riel. L’exposition fait passer de choses immat├®rielles et invisibles ├Ā un autre statut. Pendant que je travaille, je suis avec des fils, des K7… Une fois dans l’exposition, ce travail est mis en jeu dans l’espace puis dispara├«t. D’autre part, il y a une fa├¦on de placer les oeuvres dans un univers o├╣ elles ont une valeur marchande. C’est une prise de position de pr├®senter l’œuvre. Elle est pr├®sent├®e ici, ensuite elle dispara├«t ou elle peut tr├©s bien ├¬tre pr├®sent├®e ailleurs de mani├©re diff├®rente, elle n’est pas un ┬½┬Āobjet┬Ā┬╗ unique. Par contre, la photo fige les choses, j’essaie de r├®soudre ce conflit entre oeuvre et objet, diff├®remment.
Eric Corne: La notion du grain de l’image est importante dans ton œuvre, peux-tu en parler? L’entends-tu comme mat├®rialit├® de l’image, comme surface tactile, o├╣ traverses-tu gr├óce ├Ā ce grain la mat├®rialit├® des objets pour en r├®v├®ler l’aspect sensible?
Oui, c’est important, mais je ne cherche pas ├Ā avoir une attitude romantique avec ├¦a. Le grain, c’est la trace de quelque chose. Dans 3 x 36, aide m├®moire, il n’y a pas de grain… Ce qui appara├«t, c’est la trace du processus.
Ma├½lle Dault: Le silence et la lenteur sont souvent des principes qui se d├®veloppent dans les pi├©ces pr├®sent├®es dans ton exposition au Plateau. Est-ce qu’il est question d’envisager par ce biais avec le spectateur, la disponibilit├® du regard?
Je ne peux pas regarder et entendre en m├¬me temps avec la m├¬me intensit├®. Ce parti pris permet aux sens de se d├®velopper avec l’ensemble de leur potentiel. C’est un choix.
Eric Corne: Oui, dans le Catalogue de gestes, le silence est assourdissant. Peut-on parler d’image mouvement, dans ce sens compris de Bergson ├Ā Deleuze. Le temps dans l’image fixe d├®termine-t-il la m├®moire? Ce travail de m├®moire, ces coupes de temps sont-elles d├®terminantes?
Comment retranscrire les questions du temps, de l’image ? A partir du moment o├╣ on filme, on est dans la m├®moire. C’est une grande frustration que j’ai eue en approchant le cin├®ma dans un rapport de vingt quatre images par seconde: les images se suivent de fa├¦on in├®luctable, c’est comme un emprisonnement du regard. Dans 3 x 36 aide-m├®moire, j’ai photographi├® avec une pellicule de trente six poses trois fois sur le m├¬me film puis refilm├® de mani├©re tr├©s lente. Ces photographies sont mises bout ├Ā bout… C’est trouver des trous ├Ā l’int├®rieur du temps de l’image pour aboutir ├Ā une autre forme de perception qui lutte avec le temps de l’image. Je ne peux pas saisir quelque chose qui arrive trop vite. C’est quelque chose de politique. Une fa├¦on de donner une lecture qui n’associe pas sens et rythme. Il n’y pas d’unicit├® de lecture, on propose des sens multiples, des choses interm├®diaires. L’image est tr├©s pi├®geante en ce sens.
Eric Corne: Est-ce que tu peux nous parler du titre de l’exposition?
Le titre Haus/raus – aus est un titre en allemand. ┬½┬ĀHaus┬Ā┬╗, signifie la maison, ┬½┬Āraus┬Ā┬╗, en langage familier ┬½┬Ācasse-toi┬Ā┬╗ et ┬½┬Āaus┬Ā┬╗ d├®signe un mouvement vers le dehors. C’est quelque chose de contradictoire. On est ├Ā la fois dans le lieu, chez soi, on parle de sa propre exp├®rience. On est en m├¬me temps exclu, amen├® ├Ā l’ext├®rieur. On est entre les deux.
Ma├½lle Dault: Ton travail semble fouiller le r├®el. Tu passes d’un resserrement autour de la r├®alit├® ├Ā des ├®carts ou ├Ā une d├®r├®alisation pour mener ├Ā un retour vers plus de perception. Comment envisages-tu cette question du r├®el? Y a-t-il pour toi une n├®cessit├® ├Ā passer par ces diff├®rentes ├®tapes?
Dans le cin├®ma, on est d’embl├®e dans le r├®el. Comment construire un langage, comment placer la cam├®ra. L’histoire de l’art a transform├® ces repr├®sentations, ce r├®alisme. Dans ma fa├¦on de penser je suis d’avantage proche de l’histoire de l’art que de l’histoire du cin├®ma. Il n’y a pas un r├®el, ce que je montre n’est pas le r├®el. C’est une position politique par rapport ├Ā l’image, car l’image tente de nous faire croire que c’est r├®el, ce n’est que de la mise en sc├©ne, du protocole. Ma tentative est de montrer ce dispositif, il y a la volont├® de montrer la mise en sc├©ne. Le leurre est vite d├®samorc├® c’est ce qui cr├®e la distance. On n’existe qu’├Ā partir du moment o├╣ on cr├®e de la distance. On ne s’en sort que si on d├®saxe le regard. La situation de la France, si on la voit de l’ext├®rieur, devient diff├®rente. Par exemple, la cit├® pavillonnaire, telle que je la filme dans Haus vue du dessus, ressemble ├Ā une maquette.
Eric Corne: C’est la question de l’ubiquit├® au Moyen Age, on ne donne pas un regard ├Ā voir, mais plusieurs points de vue. Alors quel serait ton rapport au cin├®ma ? Dans l’exposition, par exemple, je pense ├Ā Pierrot le fou, Providence et Blow up?
Le cin├®ma, est beaucoup trop fini pour moi, j’ai envie de le d├®structurer. Le cin├®ma exp├®rimental m’attire beaucoup plus. Il y a beaucoup de choses dans le cin├®ma, parfois il y a des moments magiques dans un plan qui me s├®duisent, mais il ne s’agit pas d’├¬tre dans la narration. La question du r├®el, la question du temps m’est pos├®e. Le cin├®ma apporte des solutions aux choses. Indice Nikkei, a ├®t├® r├®alis├® ├Ā partir de tablo├»;ds de la Bourse que l’on peut lire dans le journal, c’est tr├©s banal. Cela fait partie de nouveaux langages pseudo- scientifiques, en m├¬me temps ce n’est pas ├®vident, c’est ├®tranger. L’incidence du niveau de la bourse est folle, c’est quelque chose de dramatique. La position est d’avoir de l’humour l├Ā-dessus, c’est ├Ā la fois de la gravit├® et de l’ironie. Comment jouer ou ne pas jouer, la courbe est un ├®cran. C’est une puret├® graphique, une simple ligne.
Ma├½lle Dault: En m├¬me temps, avec la bande sonore, tu r├®introduis de l’humain dans cette pi├©ce, cette voix est toujours pr├¬te ├Ā faillir.
Il y a quelque chose de d├®risoire devant l’├®tendue de l’implication r├®elle des choses. C’est l’impression du d├®risoire.
Public: C’est poser une attitude graphique. C’est quelque chose d’abstrait mais en m├¬me temps des gens de toutes les cultures peuvent comprendre, cela traduit un sentiment.
Non, c’est la lecture de cette courbe qui devient un sentiment, la courbe est on ne peut plus neutre, quasiment scientifique. En m├¬me temps, ce sont des courbes exactes, la chanteuse chante juste, elle chante de fa├¦on exacte, comme si ces courbes ├®taient redessin├®es agrandies, il n’y a pas de sentimentalisme. C’est une proposition de distance.
Public: C’est vous qui avez choisi de peindre cette salle en rouge?
Oui, je l’ai choisi, ├¦a pouvait ├¬tre un cardiogramme, c’├®tait pour introduire un doute sur la bourse. C’est un point chaud.
Public: Pouvez-vous parler de Zones Taboues, c’est une pi├©ce ├Ā part dans l’exposition.
C’est un travail qui est en cours, comme tous les travaux que je fais. Je suis partie du livre de Desmond Morris, La Cl├® des gestes. Je suis partie de sch├®mas qui ├®taient simplifi├®s. Au d├®part, je pensais introduire des mises en sc├©nes film├®es. J’ai finalement r├®alis├® des photos o├╣ les personnes sont mises en sc├©ne. Cela cr├®e une distance par rapport ├Ā l’objet.
Public: Dans ce travail, on pense ├Ā l’ic├┤ne.
C’est aussi l’id├®e du n├®gatif ├Ā partir du moment o├╣ on expose les zones qu’on touche. Si elles sont d├®sign├®es, on ne peut pas les toucher. C’est l’effet du n├®gatif et du positif, c’est le probl├©me de la vision de l’image et du contact, la m├®taphore du mot ┬½┬Ātoucher┬Ā┬╗. C’est la limite. Le texte de Desmond Morris devient un projet artistique sans qu’il s’en rende compte.
Public: Sur 3 x 36 aide m├®moire est-ce que vous aviez le souvenir de ce qui avait ├®t├® pris avant?
C’est un m├®lange des deux: hasard et souvenirs. C’est un jeu de technicit├®, c’est la m├¬me pellicule imprim├®e trois fois.
Public: En regardant A louer, j’ai pens├® ├Ā une mise en ab├«me du lieu, l’architecture qui est photographi├®e ressemble ├Ā celle du Plateau.
Ce sont des bureaux t├®moins photographi├®s sur la Friedrich Strasse ├Ā Berlin. O├╣ il y avait de nombreux chantiers avec des espaces achev├®s et des espaces non achev├®s. Une entreprise proposait de s’├®quiper avec ce mat├®riel. Effectivement, ce sont des photos qui parlent d’une certaine standardisation. D’o├╣ le fait d’avoir le sentiment de reconna├«tre dans ces photographies l’espace ou l’architecture du Plateau.
Ma├½lle Dault: On pense aussi ├Ā la maquette en regardant ces photos et au travail de Thomas Demand : les lieux sont tellement arch├®typal et parfait… On pense aussi tout simplement ├Ā l’architecture du Plateau…
La derni├©re photo, j’aurais effectivement pu la prendre au Plateau, quand il ├®tait en travaux. C’est une architecture uniforme.
Public: Est-ce que vous aviez conscience du rapport au lieu?
Oui, ├®videmment. J’ai aussi envisag├® ce travail en fonction de ce lieu. Je connais l’histoire du Plateau. Je sais que ce lieu aurait pu ├¬tre destin├® ├Ā ├¬tre un supermarch├®. Ce sont des b├ótiments Bouygues. Ce sont des modules.
Public: Comment avez-vous travaill├® sur le
C’est un travail que j’ai commenc├® il y a plusieurs ann├®es. Je l’ai pr├®sent├® de fa├¦ons diff├®rentes. Ici, c’est une pr├®sentation d’une version super 8. Il y a des pr├®sentations avec deux ou quatre images film├®es simultan├®ment. Dans ce catalogue, il y a plus de cent gestes. A chaque fois, je les montre de fa├¦ons diff├®rentes selon le lieu.
Public: Est-ce que vous ├®tablissez une ├®chelle du r├®el?
Je n’ai pas cette vision de l’objectivit├®. Il n’y pas de rapport symbolique ou de signification, le calage d’une histoire et d’une image me d├®range. Je souhaite plut├┤t me placer dans l’interstice, je voudrais me situer en amont ou en aval.

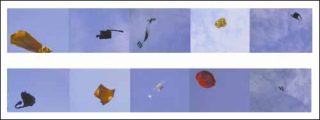

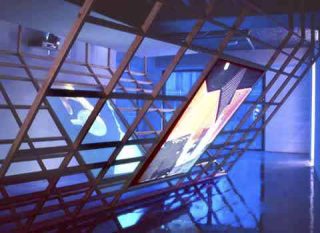



 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram