Christian Rizzo est à lâÃĐcoute de notre monde. Incontestablement. Attentif à sa complainte, il sait en transcrire les couleurs ternes et les stridences, les solitudes partagÃĐes, les flux anonymes. Et ce nâest pas sans une lÃĐgÃĻre pointe dâironie que ses danseurs nous accueillent de dos, visages encapuchonnÃĐs, corps prisonniers dâune rythmique monotone et hypnotique. La scÃĻne, noyÃĐe dans une lumiÃĻre brumeuse â qui nâest pas sans ÃĐvoquer les ambiances vaporeuses et anxiogÃĻnes de la plasticienne Ann Veronica Janssens â se pare de nos grisailles quotidiennes. Grisailles de nos villes bÃĐtonnÃĐes, qui tranchent avec le vert des plantes en pot disposÃĐes ça et là comme pour insister encore sur cette urbanitÃĐ en carence dâoxygÃĻne. Et dâamour ?
Parce quâil est forcÃĐment question dâamour. Le titre est là pour le prouver, ou du moins nous laisse espÃĐrer son avÃĻnement futur. Les mots, aussi. Ceux chantÃĐs (ou dÃĐclamÃĐs) en live par Mark Tompkins, empruntÃĐs aux poÃĻmes de lâÃĐcrivain amÃĐricain William Carlos Williams, aux morceaux de Morrissey ou de Patti Smith. Un amour pris dans la tourmenteâĶ qui exhale sa douceur par petites touches, au moyen de ces corps qui se rencontrent, sâeffleurent, sâenlacent, se soutiennent, se sÃĐparent. Trajectoires solitaires qui se croisent un temps. Et si la voix sâemporte, si la musique crie ses harmoniques saturÃĐes, les mouvements eux sont fluides, presque neutres, prÃĐservÃĐs du pathÃĐtique. Ce qui ne leur empÊche pas de dire le drame à leur maniÃĻre, dans lâinertie des corps qui se couchent, dans le pessimisme dâun arbre droit tronquÃĐ oÃđ la tÊte semble disparaÃŪtre dans le sol â jeu dâhorizontales et de verticales. Par moment, quelques incursions du cÃītÃĐ des arts martiaux ou du Tai-chi-chuan nous replongent dans nos mythologies contemporaines.
Ce va-et-vient entre le haut et le bas cohabite avec des allers-retours incessants entre la scÃĻne et les coulisses. Objets â table, chaises, arbustes, sac à dos â circulent sous la poussÃĐe de flux migratoires. Ils structurent lâespace, construisent des lignes de forces, ouvrent les perspectives. Dans leurs dÃĐplacements, les danseurs transforment la topographie de la scÃĻne, ajoutent ou enlÃĻvent de la matiÃĻre, bÃĒtissent une architecture. On retrouve ici lâattachement du chorÃĐgraphe à penser les environnements dans leur ensemble, à crÃĐer des ÂŦ esthÃĐtiques gÃĐographiques Âŧ, oÃđ lâinanimÃĐ et lâanimÃĐ se croisent. Rien nâest fixÃĐ, à lâimage de ces sphÃĻres noires qui roulent et disparaissent, ÃĐnigmatiques. MÊme les degrÃĐs de visibilitÃĐ ÃĐvoluent dans ce brouillard ambiant : nâest-ce pas les musiciens que lâon aperçoit en filigrane, à lâarriÃĻre plan, suspendus dans les airs ?
Comme à son habitude, Christian Rizzo dÃĐcloisonne les genres. La musique est mise sur un pied dâÃĐgalitÃĐ avec le mouvement dansÃĐ â qui gagne ici en intensitÃĐ (et le corps en prÃĐsence). La lumiÃĻre et le son sculptent lâespace, travaillent sa plastique. Quant au chorÃĐgraphe Mark Tompkins, il entre dans la peau dâun chanteur-poÃĻte. Ce qui donne à lâensemble un air de comÃĐdie musicale post-moderne, de performances rock. MÊme outrance dans lâintensitÃĐ sonore, mÊme dÃĐmesure, mÊme ÃĐtirement du temps jusquâà la saturation. De quoi nous faire ressentir un certain malaise, comme si nous ÃĐtions au bord dâun gouffre â matÃĐrialisÃĐ un instant par cette ombre dÃĐvoreuse projetÃĐe sur le sol.
ÂŦ De lâasphodÃĻle, cette fleur plutÃīt verte, je viens te dire le chant (âĶ) Aussi fus-je rempli de joie lorsque jâappris quâil sâen trouvait mÊme en enfer Âŧ. Un paradis infernal, mÃĐtaphore dâun monde contrastÃĐ ; voilà ce que nous offre Christian RizzoâĶ
Horaires : 20h30
CrÃĐation pour 8 danseurs, 3 musiciens, 1 chanteur
â ChorÃĐgraphie, scÃĐnographie et costumes : Christian Rizzo
â LumiÃĻres : Caty Olive
â Musique : Didier Ambact, Bruno Chevillon, Gerome Nox
â Chant : Mark Tompkins
â Assistante : Sophie Laly
â InterprÃĐtation : Philippe Chosson, Christine Bombal, Pep Garrigues, Kerem Gelebek, Wouter Krokaert, Ifang Lin, Tamar Shelef

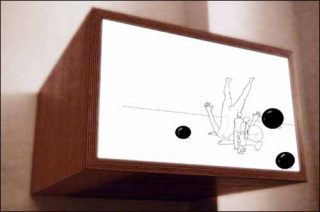

 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram