Interview
Par Pierre-Évariste Douaire
Comment en es-tu venue Ă crĂ©er une galerie d’art contemporain ?
Chaque galeriste est le rĂ©sultat d’un parcours particulier. Pour tous les autres mĂ©tiers, il existe des chemins — plus ou moins — tracĂ©s Ă l’avance. Pour ĂŞtre galeriste, il n’en existe pas. Par contre, ma mère est artiste et je connaissais ses galeristes, cela a constituĂ© une première approche. La rencontre qui a Ă©tĂ© vraiment importante a Ă©tĂ© celle de Leo Castelli. Lors de la dĂ©dicace du livre Ă©crit sur lui par Claude Berry, Ă la Fiac, j’ai Ă©tĂ© lui parler, j’avais quatorze ans. La galeriste allemande de ma mère me disait, que si je devais rencontrer une seule personne c’Ă©tait bien lui. Avec l’innocence de ma jeunesse j’ai Ă©tĂ© voir ce vieux monsieur de quatre-vingt ans, et j’Ă©tais Ă mille lieux de m’imaginer qu’il Ă©tait le pape de l’art contemporain. Très naĂŻ;vement je lui ai dis que je voulais ĂŞtre comme lui plus tard, que j’aimerais faire le mĂŞme mĂ©tier que lui. Cette petite conversation s’est prolongĂ©e en amitiĂ©. Le rapport que nous avions ensemble a Ă©tĂ© très important. J’allais souvent Ă New York et lors de mes visites, il me disait qu’il fallait commencer ce mĂ©tier très jeune. Il regrettait de n’avoir commencĂ© qu’Ă quarante et un ans, il se disait qu’il aurait pu accomplir beaucoup plus de choses s’il avait commencĂ© plus tĂ´t. Leo Castelli a Ă©tĂ© le dĂ©clencheur de ma vocation. Il m’a expliquĂ© que ce mĂ©tier Ă©tait passionnant et qu’il fallait se lancer tout de suite. J’ai suivi son conseil et je me suis lancĂ©e.
L’aventure de ta galerie commence en 1991, comment se sont passĂ©s les dĂ©buts ?
J’ai rĂ©flĂ©chi aux conseils de Leo pendant deux ans, et Ă dix-sept ans je me suis lancĂ©e. Le premier espace relevait plus de la bidouille que de la galerie. Il avait plus Ă voir avec une association loi de 1901 qu’avec un lieu classique consacrĂ© Ă l’art. C’Ă©tait encore expĂ©rimental. Mes parents m’avaient imposĂ© une seule condition qui Ă©tait de poursuivre les meilleures Ă©tudes possibles. Ce qui m’importait Ă l’Ă©poque, c’Ă©tait de prĂ©senter des artistes qui n’Ă©taient pas très visibles. Cette première expĂ©rience m’a donnĂ© le goĂ»t de monter un projet plus abouti, plus professionnel. J’avais dans l’idĂ©e de monter une vraie galerie entre guillemets. La logique de cette entreprise m’amène dans le treizième arrondissement, Ă cĂ´tĂ© de la grande bibliothèque.
La galerie est de l’autre cĂ´tĂ© de la rue Louise Weiss. Est-ce un handicap ?
Aujourd’hui, ce ne l’est plus, mais il a fallu se diffĂ©rencier de la rue Louise Weiss. Le quartier de la Bibliothèque est un quartier d’avenir, mais au dĂ©part c’Ă©tait un pari risquĂ©. Au final, je suis contente d’ĂŞtre lĂ oĂą je suis. Je me serait sentie comme un parasite en allant me coller Ă un groupe de galeries qui Ă©taient lĂ avant moi et dont je ne fais pas partie. Je n’aurais pas Ă©tĂ© très fière de rĂ©cupĂ©rer le bĂ©nĂ©fice de ce qu’ils ont crĂ©Ă©. Le succès que l’on rencontre ici n’est dĂ» qu’Ă notre travail, nos vernissages sont pleins. Maintenant, il y a d’autres galeries qui s’ouvrent de nĂ´tre cĂ´tĂ©. Je me suis attachĂ©e Ă l’Ă©volution du quartier, j’ai l’impression d’ĂŞtre dans l’œil du cyclone en Ă©tant entre la bibliothèque et une nouvelle fac. C’est top, j’adore.
Tu es également professeur à Sciences Po, les deux activités sont-elles conciliables ?
Je passe seulement deux heures par semaine Ă Sciences Po. Cette activitĂ© est l’autre face d’un mĂŞme travail qui consiste Ă sensibiliser le plus grand nombre Ă l’art contemporain et Ă la culture. La galerie et l’Ă©cole sont les deux pĂ´les sur lesquels j’interviens. Promouvoir, prĂ©senter de nouveaux artistes Ă des publics variĂ©s m’intĂ©resse Ă©normĂ©ment. La dĂ©couverte et la sensibilisation sont deux choses très excitantes. Comme galeriste, j’aurais pu choisir les arts du passĂ© mais c’est beaucoup moins jouissif. J’aime croire qu’avec ce type de dĂ©marche on arrive Ă faire avancer, un tout petit peu, la crĂ©ation actuelle. C’est dans cette optique que j’interviens bĂ©nĂ©volement au Cube, l’espace d’Issy-Les-Moulineaux.
Ton travail consiste Ă sensibiliser tous les publics Ă l’art contemporain.
J’aime les sensibiliser. En tant que galeriste, je pourrais ne pas m’y consacrer, mais c’est mon choix que d’ĂŞtre un relais avec le public. Dans la galerie, je ne m’adresse pas seulement aux collectionneurs, mais Ă tous les visiteurs. Nous sommes trois Ă la galerie et nous passons beaucoup de temps Ă expliquer les œuvres aux gens.
Est-ce dans ce mĂŞme soucis que tu dĂ©fends l’art urbain ?
Il m’est très important de dĂ©fendre les nouvelles pratiques, que ce soit l’art urbain ou l’art numĂ©rique. Ce sont des arts qui ne sont pas encore très bien acceptĂ©s par le marchĂ©. Je n’ai pas envie non plus d’exposer un artiste très connu, de le piquer Ă la concurrence, ce n’est pas quelque chose qui me passionne, je prĂ©fère voyager et farfouiller partout pour dĂ©nicher des artistes que l’on a jamais vus. Quand cela se produit, c’est gĂ©nial car les gens sont Ă©tonnĂ©s. Ils les dĂ©couvrent et sont Ă©merveillĂ©s.
Pour ces pratiques émergentes, considères-tu la galerie comme un espace de légitimation ?
Les galeries d’art apportent toujours de la crĂ©dibilitĂ© aux nouveaux courants. Elles sont l’un des maillons de la lĂ©gitimation des artistes.
Est-ce que la galerie est une machine au service des artistes ?
Tout Ă fait. Nous sommes au service des artistes, d’ailleurs ma mère me dis souvent qu’une galerie n’est rien sans ses artistes. C’est massif comme argument, mais c’est aussi très vrai. Notre contrat vis-Ă -vis d’eux est Ă©crit ou moral, mais il nous impose un engagement qui consiste Ă les dĂ©fendre et Ă aller dans la direction qu’ils veulent prendre. Notre rĂ´le consiste Ă les accompagner. Ils ont tous des envies diffĂ©rentes. Ils ne rĂŞvent pas tous de la mĂŞme chose, ils ne veulent pas tous exposer Ă Frize par exemple. Dans ce contexte, nous devons prendre en compte leurs motivations. Ce travail nous tient particulièrement Ă cœur, j’aime dire que l’on reprĂ©sente les artistes. Tous les jours, nous sommes en contact avec eux par mails et par tĂ©lĂ©phone pour avoir des nouvelles rĂ©gulièrement. On ne travaille pas ensemble seulement pour faire une expo dans la galerie, cela va beaucoup plus loin.
Comment choisis-tu les artistes ?
C’est comme une histoire d’amour. A long terme, la relation ne peut pas ĂŞtre unilatĂ©rale. Les rencontres sont souvent informelles, elles fonctionnent souvent par recommandation. Des critiques, des commissaires d’exposition me parlent des gens qu’ils connaissent. Au bout d’un moment, c’est tout un petit rĂ©seau qui se met en place. Une seule chose ne fonctionne pas très bien : les candidatures spontanĂ©es. Il y en a Ă©normĂ©ment, je les regarde pour me tenir au courant, mais dans 99,99% des cas ce qui est proposĂ© ne correspond pas Ă ce que nous exposons. Par contre, ce qui marche très bien ce sont les rĂ©seaux que les artistes entretiennent entre eux. A partir d’un artiste, tu te retrouves en contact avec ses amis et les artistes avec lesquels il a exposĂ©. Toutes ces rencontres sont des histoires d’amour.
Le hasard préside ces destinées.
Ces rencontres sont toujours informelles, mais il ne faut pas oublier que nous sommes des tĂŞtes chercheuses dans notre travail et qu’Ă la fin du compte, tous ces hasards sont lĂ©gèrement provoquĂ©s. Je n’arrĂŞte pas de voyager et j’en profite pour rechercher, en permanence, de nouveaux artistes.
N’es-tu pas arrivĂ©e Ă un stade oĂą il y a assez d’artistes dans la galerie ?
Je collabore avec vingt artistes. La logique d’exposition impose de faire des choix. L’exposition de l’un se fait au dĂ©triment de l’autre. La dĂ©couverte d’un nouvel artiste signifie qu’un autre va ĂŞtre moins prĂ©sentĂ©, mais cela fait partie des histoires que nous entretenons entre nous. D’un autre cĂ´tĂ©, il arrive que certains artistes dĂ©cident de partir une annĂ©e pour voyager et travailler Ă l’Ă©tranger. Comme ils me demandent moins de services, cela me permet de donner sa chance Ă un nouveau venu. Actuellement m’occuper d’une vingtaine d’artistes est le seuil de ma compĂ©tence et de mes moyens matĂ©riels.
Je vois, de temps en temps, des artistes ayant exposé chez toi aller ailleurs.
On ne fait jamais rien tout seul. Avec Kitchen 93, on collabore souvent, on appartient au mĂŞme rĂ©seau — Ă la diffĂ©rence qu’elle se place plus comme un Ă©diteur. A chaque livre qu’elle produit, elle en profit e pour faire une expo. Ce mĂŞme rĂ©seau est activĂ© pour promouvoir des artistes en rĂ©gion et Ă l’Ă©tranger. Un autre cas de figure existe, il s’agit des artistes qui n’Ă©prouvent pas le besoin d’ĂŞtre uniquement reprĂ©sentĂ©s par une seule galerie. Avec eux, il faut avoir l’intelligence de les comprendre et de les accompagner chez les autres.
Cela ne va pas sans poser de problèmes ?
Non, pas du tout. Pour mes artistes qui exposent dans d’autres galeries parisiennes, je leur envoie mes clients sans pour autant le clamer sur tous les toits. Je suis lĂ pour montrer au maximum les artistes que j’aime, que ce soit chez moi ou chez les autres. S’ils sont bien vus, tant mieux. D’un autre cĂ´tĂ©, je ne peux pas saturer la galerie avec un seul artiste, un seul genre, donc c’est très bien qu’ils exposent ailleurs. Moi-mĂŞme, j’encourage les artistes Ă exposer. Je prends des pièces que je vais exposer Ă Miami par exemple. L’exclusivitĂ© n’est pas pensable, l’artiste n’est pas une chose que l’on s’accapare.
Il y a des galeries qui imposent des contrats d’exclusivitĂ©.
Oui, il y en a. Cela dĂ©pend du service que tu leur rends. Nous ne donnons pas tous les moyens Ă nos artistes, ce qui veut dire qu’en retour nous ne pouvons pas tout leur demander. Comme on peut pas tout leur donner, qu’une autre galerie vienne complĂ©ter le service est une chance pour nous et pour l’artiste. Mais tout cela dĂ©pend du dĂ©sir des artistes. Certains prĂ©fèrent rester libres de leurs mouvements, d’autres sont attachĂ©s Ă n’avoir qu’un seul interlocuteur. Notre rĂ´le d’accompagnateur consiste Ă proposer un service sur-mesure. On ne pourrait pas s’occuper de plus de vingt artistes car, Ă chaque fois, il faut s’adapter Ă leurs dĂ©sirs.
En quoi consiste les aides, les services que tu leur proposes ?
Il faut d’abord que les artistes estiment appartenir Ă la mĂŞme structure. A l’intĂ©rieur de la galerie, ils ont la possibilitĂ© de travailler ensemble. Des collaborations voient le jour, et c’est très bien car nous faisons partie du mĂŞme groupe, de la mĂŞme Ă©quipe. La galerie est lĂ pour fĂ©dĂ©rer cette Ă©quipe. Deuxièmement, nous faisons tout un travail de soutien et de conseil. On accompagne les artistes au quotidien — pas seulement pour l’accrochage Ă la galerie. On est très prĂ©sent pour les soutenir hors des murs. En troisième point, on est lĂ pour amener de nouvelles idĂ©es, pour apporter des projets et pour les dĂ©fendre. On assure la communication presse, on regarde de très près les concours et les Ă©ventuels partenariats. L’artiste n’est pas lĂ pour se promouvoir, c’est le rĂ´le de la galerie. Grâce Ă nos rĂ©seaux, on est au courant des bons plans qui peuvent les intĂ©resser. On les aide Ă©galement Ă trouver des moyens de production, parce que ce n’est pas facile. Il faut les encourager et, en dernier lieu, les aider Ă monter l’exposition et in fine vendre l’œuvre, car cela permet Ă l’artiste de vivre de son travail. Je suis très contente si mes artistes peuvent se consacrer totalement Ă leur art et en vivre.
Dans la galerie, il y a beaucoup de duos qui se forment spontanément.
Oui, j’aime beaucoup quand les artistes travaillent ensemble. Aujourd’hui, Shepard Fairey et Darek fusionnent littĂ©ralement leurs pratiques pour faire des objets Ă quatre mains. Entre eux, ils se rendent des services. Ce type de fonctionnement est très sain car il leur permet de rompre la solitude de l’atelier dans lequel est plongĂ© tout artiste.
La galerie s’impose-t-elle une ligne de conduite dans ses choix ?
J’ai jamais voulu parler de ligne, mĂŞme si le mot a Ă©tĂ© très Ă la mode. Cela enferme l’art contemporain dans quelque chose de très Ă©troit alors qu’il est par dĂ©finition très mouvant. En revanche, il y a des artistes que j’ai envie de suivre. Mon choix est très Ă©clectique. L’art urbain me fait vibrer depuis mon adolescence, l’art numĂ©rique me passionne pour d’autres raisons. Après ces deux grandes tendances, il y a des individualitĂ©s et des travaux qui m’intĂ©ressent. Si j’avais plus de temps, je me consacrerais peut-ĂŞtre Ă Ă©crire sur le sujet. J’ai toujours considĂ©rĂ© mon travail et mes choix comme Ă©tant très militants. J’ai toujours voulu dire aux gens : «regarder ces artistes, ils sont formidables». L’art urbain a Ă©tĂ© le dĂ©clencheur, mais je n’ai jamais voulu en faire une exclusivitĂ© car je serais tombĂ©e dans un ghetto. Je trouvais dommage que les fresques murales ne soient pas considĂ©rĂ©es comme de l’art et c’est pour cela que j’ai commencĂ©. J’ai toujours voulu dĂ©montrer aux gens que ces fresques Ă©taient importantes.
Justement, comment justifier le passage de cet art d’extĂ©rieur Ă l’intĂ©rieur d’une galerie ?
Ces deux activitĂ©s sont complĂ©mentaires. Parler de passage implique dès le dĂ©part qu’il y a un avant et un après. Pour ma part, je fais une distinction entre ceux qui se revendiquent comme non-artistes et ceux qui veulent avoir une dĂ©marche artistique. Parmi ces derniers, il y en a qui sont meilleurs Ă l’intĂ©rieur qu’Ă l’extĂ©rieur et inversement. Mais dans tous les cas, le travail n’est pas le mĂŞme quand il est exĂ©cutĂ© dans la rue ou pour un collectionneur. Dans le premier cas, l’efficacitĂ© sera privilĂ©giĂ©e au dĂ©triment de la finition. Pour une œuvre sur papier, le mĂŞme artiste va pouvoir se laisser aller Ă la minutie qui lui fait dĂ©faut dehors. La rapiditĂ© de son geste, l’automatisme que lui impose la dangerositĂ© de la rue est abandonnĂ© au profit d’une mĂ©ticulositĂ© d’orfèvre.
Pour moi, cette question entre l’intĂ©rieur et l’extĂ©rieur se pose depuis le Land Art.
Ce que tu dis est un bon parallèle : un artiste comme James Turell est Ă l’aise dans les deux cas de figure. Il parvient Ă crĂ©er de l’Ă©motion n’importe oĂą, mais cette facilitĂ© n’est pas donnĂ©e Ă tous les artistes. La problĂ©matique que tu Ă©voques n’est pas propre Ă l’art urbain, j’ai les mĂŞmes soucis avec l’art numĂ©rique. A chaque fois, je me demande comment je vais prĂ©senter les œuvres. Montrer ce type de crĂ©ation est très difficile car il faut absolument le rendre accessible, il faut qu’il soit intelligible et ce n’est pas Ă©vident.
Quel est le profil de tes collectionneurs ?
Il y en a plusieurs. J’ai commencĂ© avec des gens modestes qui rĂ©glaient en douze fois. Après avoir exposĂ© des œuvres pas chères, fait des salons et m’ĂŞtre associĂ©e Ă des galeries Ă©trangères, j’ai accĂ©dĂ© Ă d’autres types de collectionneurs. L’Ă©ventail va du collectionneur modeste — qui s’intĂ©resse Ă l’art et fait l’effort de mettre un peu de sous de cĂ´tĂ© pour acheter — au très grand collectionneur qui construit son musĂ©e privĂ©.
S’intĂ©ressent-ils Ă un domaine de l’art en particulier, comme l’art urbain ou l’art numĂ©rique ?
Par mes Ă©tudes, je rencontre des gens qui ne sont pas du tout dans le monde l’art et Ă qui j’essaie d’inoculer le virus. Ensuite, il y a des gens qui s’intĂ©ressent très prĂ©cisĂ©ment Ă l’art urbain, Ă l’art numĂ©rique, ou Ă la photographie très architecturĂ©e que je propose. Ceux-lĂ sont des connaisseurs avec qui nous travaillons en Ă©quipe. Ils viennent très souvent nous voir pour savoir si nous avons de nouvelles pièces. Ils font partie de l’Ă©quipe, je leur prĂ©sente les artistes et nous travaillons ensemble. Troisièmement, il y a des gens qui collectionnent autre chose et qui achètent chez nous par coup de cœur. Je pense Ă ce monsieur fĂ©ru de mobilier du 18ème siècle qui a achetĂ© un très grand Miss Van et qui l’a accrochĂ© au-dessus d’une commode d’Ă©poque. Je trouve ça gĂ©nial.
C’est important de proposer des articles symboliquement très abordables comme les stickers pour donner aux gens l’envie d’acheter ?
Il y a beaucoup de gens qui aimeraient possĂ©der et qui ne le peuvent pas. Moi-mĂŞme, j’ai Ă©tĂ© dans ce cas et je me suis toujours dit qu’il fallait proposer au moins quelque chose en dessous de dix euros. Cela permet de prolonger le plaisir. La sĂ©rie limitĂ©e est importante car elle permet de personnaliser l’achat. La qualitĂ© doit ĂŞtre au rendez-vous et il ne faut pas non plus proposer une offre trop importante, il faut rester dans une juste limite. Quand on parvient Ă avoir des partenaires pour les vernissages, on essaie toujours de faire des stickers ou des tee-shirts que l’on donne aux gens pour qu’ils soient contents. On rĂ©alise des badges, des tee-shirts, des sucettes. Dans la moitiĂ© des cas, tout le monde peut repartir avec quelque chose.
Comment va Ă©voluer la galerie dans le futur ?
La galerie ne peut pas rester comme ça, ce n’est pas possible, cela ne fait pas partie de mon tempĂ©rament. Je bouge tout le temps et j’en veux toujours plus. Je suis toujours Ă la recherche d’autre chose. Avant de rencontrer Castelli je voulais exercer tous les mĂ©tiers, ĂŞtre galeriste c’est pouvoir rĂ©aliser ce rĂŞve et pouvoir faire plein de choses Ă la fois. Pour l’instant, j’ai envie de faire plein d’expos hors-les-murs pour valoriser au maximum les artistes de la galerie et montrer de l’art Ă un maximum de gens.

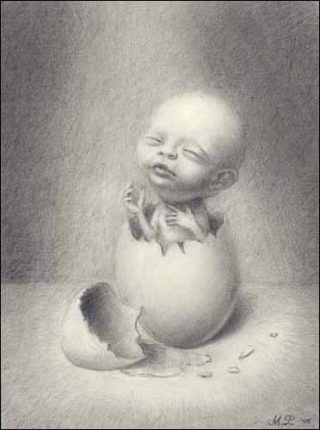





 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram