— Éditeur(s) : Paris, L’Harmattan
— Année : 2002
— Format : 21,50 x 13,50 cm
— Illustrations : aucune
— Page(s) : 188
— Langue(s) : français
— ISBN : 2-7475-2828-6
— Prix : 15 €
La production industrielle de l’image
par Michel Porchet
Deux mutations techniques sont symptomatiques de la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle :
Рl’apparition, vers 1880 en horlogerie, des pièces interchangeables qui banalise les multiples,
Рl’apparition, vers 1900, de l’organisation scientifique du travail de Taylor, qui confisque, au bénéfice du service des méthodes, le savoir-faire de l’atelier et rend les hommes interchangeables dans l’usine.
On a ainsi réalisé, en deux étapes, la reproductibilité mécanique des objets mécaniques par des agents anonymes. Il est aussi possible de retenir deux traits de l’actuelle révolution industrielle :
– elle liquide les savoir-faire industriels, en ne se limitant plus seulement √Ý ceux des ex√©cutants mais en touchant aussi ceux des concepteurs,
Рelle se dit, par un fréquent paradoxe de langage, « post industrielle » alors que tout y est devenu industrie.
Comment na√Æt un objet, pourquoi les √©normes moyens techniques qu‚Äôapporte l‚Äôinformatique favorisent-ils l‚Äôindustrialisation mais pas la v√©ritable cr√©ation d‚Äôun artefact ? J‚Äôai pens√© pendant longtemps que la cr√©ation technique, par ses c√¥t√©s r√©p√©titifs et son caract√®re plus r√©pandu, √©tait proche des conditions classiques de l‚Äôexp√©rience scientifique (ind√©pendance du sujet, reproductibilit√©, etc.) et se pr√™tait bien √Ý l‚Äô√©tude de la cr√©ation. Je suis aujourd‚Äôhui convaincu que cette approche ne permet pas de mieux comprendre l‚Äôactivit√© cr√©ative du cerveau humain. Si le technicien et l‚Äôartiste ont, pour l‚Äôessentiel, le m√™me cerveau, leurs situations respectives sont totalement diff√©rentes. Pour le premier, l‚Äôimp√©ratif est √©conomique et, s‚Äôil prend en compte les besoins ce sont les besoins solvables. La cr√©ation technique est un carcan, le travail pour un ma√Ætre est une ali√©nation. Le r√¥le du d√©sir est fondamental, le corps participe aussi. Les questions de la relation de la plasticit√© √Ý la cr√©ation et de l‚Äôabsence de plasticit√© des ordinateurs et des proc√©dures qu‚Äôils engendrent se profilent l√Ý.
La notion de plasticit√© ne peut √™tre √©tendue √Ý l‚Äôordinateur. L‚Äôextension du langage est source d‚Äôid√©ologisation. Il est possible d‚Äô√©tendre tr√®s loin des notions comme celle de plasticit√© ou de langage. Il peut √™tre l√©gitime de parler de la plasticit√© du langage, tout comme il est possible de disserter sur le langage de la plasticit√©. La cr√©ation par l‚Äôinterm√©diaire d‚Äôune machine liquide le contact avec la mati√®re, donc l‚Äôintervention du corps. L‚Äôutilisateur se trouve en quelque sorte priv√© de son corps, du geste, de l‚Äôoutil prolongement de la main. Il est difficile d‚Äôorganiser un espace qui n‚Äôest perceptible que par l‚Äô√©troite fen√™tre de l‚Äô√©cran. La cr√©ation devient √©criture dans la confusion des sens.
L‚Äôordinateur est le produit d‚Äôune histoire complexe. Il n‚Äôa pas plus d‚Äôinventeur que la roue ou le tour de potier. La prise en compte des processus qui ont conduit aux machines actuelles est indispensable pour saisir ce qui ressort de l‚Äôessence de ces machines et ce qui ressort des idiosyncrasies dues aux conjonctures de leur histoire concr√®te. Pour √©largir la client√®le potentielle, il fallait rendre les machines plus conviviales, c‚Äôest-√Ý-dire plus proche de la culture de la client√®le vis√©e. Une bataille commerciale intense s‚Äôest d√©roul√©e pour conqu√©rir le poste de travail de la secr√©taire et, plus largement, des employ√©s de bureau, march√© sans commune mesure avec celui d√©tenu alors par les gros ordinateurs et les micro-ordinateurs ¬´ scientifiques ¬ª. Le paradigme du bureau a contamin√© toute l‚Äôinformatique. L‚Äôesprit des utilisateurs est tellement conditionn√© que l‚Äôon passe pour un vieux grincheux si l‚Äôon avoue que l‚Äôon d√©teste se promener dans un monde dont l‚Äôesth√©tique et le mode de fonctionnement oscillent entre le centre d‚Äôimp√¥ts et le catalogue de vente par correspondance.
L‚Äôinformatique d‚Äôaujourd‚Äôhui se gargarise du terme ¬´ interactif ¬ª, √Ý tel point que l‚Äôon peut croire que les informaticiens auraient, sinon invent√©, √Ý tout le moins d√©couvert l‚Äôinteractivit√©. Or, l‚Äôinformatique s‚Äôest tout d‚Äôabord caract√©ris√©e par l‚Äôabsence totale d‚Äôinteractivit√©.
La convivialit√© des machines ou ce que l‚Äôon nomme convivialit√© a un prix. On a quitt√© un univers logiciste pour un monde qui peut √©voquer le comportement du vivant. On en arrive √Ý ce que j‚Äôappelle le paradigme du chien : ¬´ Si votre comportement est ad√©quat, ad√©quat ne se confondant pas avec rationnel, vous obtiendrez de votre chien/ordinateur en gros ce que vous en attendez. Sinon ‚Ķ ¬ª Une certaine connaissance de la psychologie du chien est indispensable, mais la connaissance des circuits de synapses du chien, n‚Äôest ni possible, ni pertinente pour diriger son √©ducation.
Un ordinateur est une machine physique. La lumi√®re, les courants √©lectriques appartiennent au monde de la mati√®re. Je ne parviens pas √Ý qualifier d‚Äôimmat√©rielles des images auxquelles je n‚Äôacc√®de que par l‚Äôinterm√©diaire de machines incorporant des milliers d‚Äôann√©es-homme de travail. La singularit√© de ces machines, qu‚Äôelles partagent avec les objets qu‚Äôelles produisent, ce qui peut conduire √Ý les regarder comme presque immat√©rielles est la fa√ßon dont elles incorporent du travail social. √Ä quelques √©l√©ments marginaux pr√®s (le bo√Ætier, les cartes nues, les connecteurs, etc.), il faut la m√™me quantit√© de travail pour concevoir et produire un, dix, voire dix milles ordinateurs et les logiciels qu‚Äôils contiennent.
Le mot ¬´ virtuel ¬ª, adjectif signifiant ¬´ ce qui n‚Äôest qu‚Äôen puissance ¬ª ou en devenir, qui est √Ý l‚Äô√©tat de simple possibilit√© dans un √™tre, est aujourd‚Äôhui tant√¥t utilis√© en adjectif, tant√¥t en substantif pour d√©signer une technique, un mode d‚Äô√©laboration de l‚Äôimage et une repr√©sentation d‚Äôun monde. Pour le physicien, le virtuel d√©signe le possible, le probable. Le virtuel n‚Äôest pas le contraire du r√©el. Il s‚Äôoppose au formel qui ne consid√®re que la forme, abstraction faite de la mati√®re, et √Ý l‚Äôactuel, ce qui est en acte et non potentiel. Il n‚Äôest pas le faux, l‚Äôillusoire, le fictif, le trompeur etc., mais un mode particulier d‚Äôexistence de la r√©alit√©. Dans la r√©alit√© virtuelle des nouvelles technologies, l‚Äôimage cesse d‚Äô√™tre une repr√©sentation pour devenir un lieu dans lequel on se d√©place par l‚Äôutilisation d‚Äôune manette ou d‚Äôune commande. Le passage au virtuel se caract√©rise habituellement par trois donn√©es propres √Ý l‚Äôimage : l‚Äôimmersion, la navigation, l‚Äôintervention.
L‚Äôimage construite sur un mod√®le ou cod√©e par un texte acquiert la libert√© du langage, elle √©chappe aux contraintes du temps et de l‚Äôespace. Elle permet de visualiser l‚Äôinfiniment petit comme l‚Äôinfiniment grand, quelle que soit la dur√©e du ph√©nom√®ne, de la nano-seconde jusqu‚Äôaux milliards d‚Äôann√©es. La circulation des quarks comme des collisions de galaxies peuvent √™tre montr√©es. Une particularit√©, qui oppose images et sons de synth√®ses aux images argentiques et aux sons des instruments traditionnels, est le fait qu‚Äôin√©vitablement, par leur caract√®re m√™me, ils s‚Äôappuient sur une th√©orie de la perception. Une image informatique est cr√©√©e par l‚Äôaffichage ou l‚Äôimpression sur un support physique (aujourd‚Äôhui presque toujours bidimensionnel (√©cran, film, feuille de papier)), parfois st√©r√©oscopique (casque de visualisation) du r√©sultat de l‚Äôapplication d‚Äôun certain nombre de m√©thodes de traitement √Ý un ensemble de donn√©es. Les terminologies actuellement adopt√©es ne sont pas satisfaisantes. La formule ¬´ image de synth√®se ¬ª tend √Ý opposer ces images √Ý des ¬´ images naturelles ¬ª. les termes ¬´ image num√©rique ¬ª ou ¬´ image num√©ris√©e ¬ª √©voquent l‚Äôid√©e de la traduction de l‚Äôimage en nombres. Or, l‚Äôh√©t√©rog√©n√©it√© des m√©thodes de codage et de traitement est telle que l‚Äôon ne peut attribuer que fort peu de propri√©t√©s pertinentes √Ý ces ¬´ nombres ¬ª. Tout code est r√©ductible √Ý des nombres que l‚Äôon peut finalement √©crire sous une forme binaire. La terminologie anglaise ¬´ data-driven image ¬ª (image pilot√©e par des donn√©es) est meilleure.
Dans l’ordinateur, l’image est codée par un texte situé quelque part entre une langue purement formelle et une langue naturelle. Il y a une vingtaine d’année encore, on archivait les données sous la forme d’une liste de caractères (lettres et signes ASCII) lisibles par l’homme (en anglais « Man Readable »). La rédaction et la maintenance de programmes de traitement étaient plus facile d’où une certaine indépendance par rapport aux systèmes qui avaient créé ces données. Cette façon d’archiver les données ; garantissant ainsi leur pérennité indépendamment des relations avec un fournisseur.
Actualis√©e, l‚Äôimage pourra, au m√™me titre que l‚Äôimage peinte ou la photo r√©v√©l√©e, √™tre examin√©e en tout temps. Par contre, si elle garde une trace plus ou moins visible de son origine num√©rique, l‚Äôimage actualis√©e a irr√©m√©diablement perdu le code dont elle est issue. L‚Äôimage sur l‚Äô√©cran de l‚Äôordinateur et l‚Äôimage imprim√©e ne sont plus virtuelles mais elles sont devenues analogiques donc soumises √Ý tous les al√©as d‚Äôune reproduction que l‚Äôon ne peut faire √Ý l‚Äôidentique. L‚Äôimage √©cran et l‚Äôimage imprim√©e diff√®rent par leur dur√©e de vie. Fugitive, l‚Äôimage √©cran doit √™tre r√©g√©n√©r√©e plusieurs fois par seconde en relisant la m√©moire image. Une fois imprim√©e, l‚Äôimage peut durer plusieurs ann√©es. L‚Äôimage se fait lieu de rencontre entre un intelligible qui n‚Äôest que virtuel et un sensible qui ne l‚Äôest qu‚Äôimparfaitement car l‚Äôimage infographique jouit trop souvent de la cr√©dibilit√© que lui donne le fait d‚Äô√™tre une fen√™tre ouverte sur le monde tr√®s platonicien des mod√®les et non sur une r√©alit√© impure. Le texte qui code l‚Äôimage peut √™tre reproduit sans perte. La copie ne se distingue en rien de l‚Äôoriginal, elle est un original susceptible √Ý son tour d‚Äô√™tre copi√© sans perte et √Ý des co√ªts d√©risoires. Il n‚Äôy a plus alors de g√©n√©ration qui s√©pare un original de ses copies. Ainsi, de lin√©aire qu‚Äôelle √©tait √Ý l‚Äô√©poque de la reproduction m√©canique, la propagation de copies devient exponentielle √Ý l‚Äô√©poque du codage textuel de l‚Äôimage. √âtrange monde o√π la copie du code de l‚Äôimage √Ý l‚Äôidentique est possible √Ý l‚Äôinfini, mais o√π la production de l‚Äôimage visible est un des proc√©d√©s m√©caniques les plus al√©atoires.
Plus personne n‚Äôenvisage que la nouvelle √©conomie domine et asservisse rapidement l‚Äô√©conomie traditionnelle. Malheureusement, vaincues les utopies se retournent contre leurs auteurs. Les irruptions de la propri√©t√© intellectuelle, du droit des marques, des m√©canismes de censures montrent d√©j√Ý que la fin de la r√©cr√©ation a √©t√© sonn√©e. Les artistes sont ballott√©s dans ces mutations. Pouss√©s par les soci√©t√©s d‚Äôauteurs, certains deviennent complices de la normalisation. D‚Äôautres tentent de d√©velopper des concepts et des pratiques nouvelles sans qu‚Äôil soit toujours facile de trancher entre blagues de potaches et mouvements faisant r√©ellement sens. Le poids de l‚Äôindustrie culturelle cro√Æt. Il serait illusoire de croire que les ma√Ætres des grandes multinationales de la communication, les J6M et consorts laisseront plus de place √Ý l‚Äôart que les ma√Ætres de forge du XIXe si√®cle. Le XXe si√®cle a vu √Ý la fois la remise en cause radicale du programme de Vasari et l‚Äôapparition, gr√¢ce √Ý l‚Äôordinateur, du moyen de passer directement d‚Äôun langage √Ý la forme sans qu‚Äôintervienne un quelconque savoir-faire manuel, mais comme c‚Äôest aussi le cas pour l‚Äôouvrier ou l‚Äôartisan personne ne consid√®re cela comme un progr√®s. L‚Äôart entretien une relation √©troite √Ý sa surface d‚Äôinscription. Les supports num√©riques renouvellent incontestablement cette derni√®re. La propri√©t√© la plus importante de cette nouvelle surface est certainement son √©clatement. La surface d‚Äôinscription fondamentale est sans conteste le code qui d√©crit les proc√©dures d‚Äôactualisation de l‚Äôimage virtuelle. La surface d‚Äôinscription du code lui-m√™me ne joue qu‚Äôun r√¥le secondaire. Toute surface, que l‚Äôon peut d√©composer en zones poss√©dant deux √©tats distincts, convient si elle satisfait aux crit√®res de capacit√©, de d√©bit et de p√©rennit√© des donn√©es. Le code donne des instructions qui doivent √™tre mises en ≈ìuvre par le syst√®me informatique. L‚Äôimage physique est finalement cr√©√©e, souvent par un balayage r√©current qui recr√©e l‚Äôimage une centaine de fois par seconde. Cette recr√©ation permanente montre bien que l‚Äô√©cran n‚Äôest pas v√©ritablement une surface d‚Äôinscription. La description des proc√©dures n‚Äôest pas compl√®te, une partie importante est d√©crite par des codes abscons dont les cl√©s sont dispers√©es dans le syst√®me technique. Le texte d√©crivant l‚Äôimage peut √™tre regroup√© ou dispers√© dans l‚Äôensemble du syst√®me informatique. Par sa nature m√™me, le code peut √™tre d√©compos√© jusqu‚Äô√Ý un niveau o√π il ne porte plus aucun ancrage signifiant dans le r√©el. Il devient alors pure convention. La surface d‚Äôinscription num√©rique met en cause l‚Äôunicit√© de l‚Äôobjet mais aussi son unit√©. Ce n‚Äô√©tait pas le cas de la majorit√© des objets supports de connaissance du pass√© comme un tableau de ma√Ætre ou un violon de grand luthier. En fait d‚Äôacc√®s √Ý la chose, le spectateur √©duqu√© r√©alise vite qu‚Äôil n‚Äôacc√®de m√™me pas √Ý l‚Äô≈ìuvre originale mais √Ý une instanciation de celle-ci, √©chappant largement √Ý l‚Äôartiste car soumise √Ý l‚Äô√©volution industrielle. Il a d√ª se convaincre du caract√®re trompeur du terme ¬´ r√©alit√© virtuelle ¬ª. Les mondes aujourd‚Äôhui simul√©s dans les ordinateurs ne sont le virtuel d‚Äôaucune r√©alit√©. Toutes les tentatives d‚Äôactualisation de ces mod√®les ont √Ý ce jour √©chou√©s.
Une fable grossière
Un plasticien, peut-√™tre par amour de l‚Äô√©tymologie, travaille une masse d‚Äôargile √Ý laquelle il souhaite donner une forme, dont il a une image mentale pr√©cise. Il utilise ses yeux et ses mains pour saisir la forme et ses mains pour la transformer sans se poser la question d‚Äôun langage capable de traduire, autrement que po√©tiquement, son action. La plasticit√© m√™me de l‚Äôargile fait qu‚Äôil n‚Äôest pas besoin d‚Äôune autre surface d‚Äôinscription de l‚Äôobjet ou du processus en cours que l‚Äôobjet lui-m√™me.
La construction d‚Äôun syst√®me programm√© capable de travailler la m√™me masse d‚Äôargile va imposer de d√©finir un langage de description des actions de la main. M√™me en choisissant de simplement d√©l√©guer ces actions √Ý un op√©rateur humain, le travail impose que l‚Äôauteur et l‚Äôop√©rateur se comprennent donc qu‚Äôils partagent le m√™me mod√®le ou √Ý tout le moins la m√™me conception de la main. Le deuxi√®me niveau consisterait √Ý construire un v√©ritable automate. L√Ý, une conception de la main de l‚Äôhomme dans son rapport au modelage de l‚Äôargile sera indispensable √Ý la cr√©ation d‚Äôune main artificielle, puis un mod√®le de cette main sera n√©cessaire √Ý la cr√©ation du langage de programmation. Une main anthropomorphe n‚Äôest pas forc√©ment la solution optimale du point de vue technique, mais elle sera plus facile √Ý mettre en ≈ìuvre par un non-sp√©cialiste de la robotique. Mis √Ý disposition du plasticien, pour cr√©er ses propres objets, ce langage lui permettra de ne plus se salir les mains et de rejoindre, sans conteste, le territoire merveilleux des arts lib√©raux.
C‚Äôest l√Ý que peut intervenir le fabricant de machines destin√©es √Ý la p√¢tisserie. Il a d√©velopp√© un automate capable, programm√© de fa√ßon pertinente, de produire les merveilles qui nous √©blouissent dans les vitrines de certains magasins. Le fabricant propose au plasticien d‚Äôutiliser son automate et lui dit : ¬´ je sais ce que sont la main et les mat√©riaux plastiques, prend mon syst√®me, essaie le et j‚Äôy ajouterai par la suite quelques fonctions n√©cessaires pour toi et que je saurai bien vendre aux p√¢tissiers ¬ª. C‚Äôest ainsi que ce plasticien d√©couvre avec √©merveillement le langage plastique des p√¢tissiers. Depuis, il affiche son combat pour un art n√©o-kitch, seul capable de sortir l‚Äôart contemporain de son marasme et de r√©tablir les liens avec les vrais gens.
Prise au pied de la lettre, la fable n‚Äôa qu‚Äôun rapport lointain √Ý la r√©alit√©. Par contre, si l‚Äôon remplace le plasticien par un homme d‚Äôimage ou un musicien, elle rejoint une certaine r√©alit√©. Les exemples de syst√®mes techniques, fond√©s sur une vision r√©ductrice de la perception et d√©bouchant sur une grande r√©duction des probables et m√™me des possibles, ne manquent pas.
La nouvelle surface d‚Äôinscription offerte par l‚Äôinformatique, c‚Äôest-√Ý-dire le code, n‚Äôaccueille pas l‚Äô≈ìuvre, mais l‚Äô≈ìuvre virtuelle. Elle ne s‚Äôactualise que par la m√©diation de l‚Äôensemble du dispositif technique mis en ≈ìuvre.
L’auteur
Michel Porchet est professeur, ing√©nieur, docteur en sciences techniques. Il a cr√©√© le Laboratoire de conception assist√©e par ordinateur de l‚Äô√âcole polytechnique f√©d√©rale de Lausanne. Il est actuellement coordinateur p√©dagogique au Fresnoy, Studio national des arts contemporains √Ý Tourcoing.

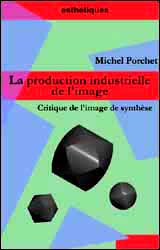

 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram