Composées de pixels agrandis et savamment redistribués en mosaïques, ces images sont aussi dépourvues de titre individuel qui permettrait de les singulariser. Thomas Ruff ébranle ainsi la certitude et l’authenticité que nous associons à la photographie, parce qu’elle est encore souvent pour nous synonyme d’impression lumineuse portée par des clichés argentiques.
En suspendant également la netteté qui nous permet en général d’authentifier le sujet et de singulariser le médium photographique parmi les pratiques productrices d’images, les JPegs remettent en question la fonction d’indice et de trace du réel dont la photographie a toujours semblé solidaire.
Les JPegs de Thomas Ruff prennent ainsi acte d’une dimension nouvelle de notre rapport aux images: elles sont médiatisées par des écrans de télévision et d’ordinateur. Ces derniers ne sont pas seulement les supports neutres de ces images mais aussi le lieu de leur (re)composition possible, dont la pixellisation est la forme élémentaire.
Ainsi, la matérialité de l’écran reconfigure l’image qu’il soutient, et ne permet plus de la renvoyer directement à une réalité extérieure dont elle serait la trace ou l’indice. Car où est le réel dès lors que l’écran participe à la configuration de l’image? Le réel n’a dès lors plus de statut en dehors de ces écrans, qui en un sens produisent l’image et peuvent donc la falsifier.
Plus radicalement, y a-t-il encore un sens à parler de falsification dès l’instant qu’on reconnaît cette puissance démiurgique à l’écran? Quoi qu’il en soit, les JPegs de Thomas Ruff sont ainsi ce qu’on pourrait nommer des images-écrans, en trois sens: des photographies qui sont les versions papier d’un écran; des images qui font écran à la réalité au sens ordinaire d’expérience du monde; et des images qui constituent néanmoins l’écran en lieu d’apparition du réel.
La recomposition maîtrisée d’images décomposées en unités élémentaires et l’anonymat de ces images sont les deux procédés intimement liés qu’utilise Thomas Ruff pour faire apparaître toute l’ambiguïté et la fragilité de ces images-écrans quant à leur rapport à la réalité. Les JPegs montrent ainsi deux choses: que les images-écrans sont dépourvues de matérialité propre et tirent leur peudo-consistance du support-producteur qu’est l’écran ainsi que du regard du spectateur; et que cette consistance, par conséquent très éphémère, renvoie le jugement de réalité à la décision du regard que nous portons sur ces images.
Chaque cliché est en effet décomposable à deux niveaux d’unités élémentaires: en un premier nombre fini de carrés, eux-mêmes divisibles ensuite en carrés plus petits mais eux-mêmes indécomposables. Ces derniers constituent donc autant d’atomes de photographie ou d’écran, et ne se distinguent que par leur couleur. Mais la disposition de ces atomes ne correspond pas à la simple division d’une ligne ou d’une forme en petites parcelles, comme si l’on segmentait une figure en parties élémentaires sans en bouleverser la continuité.
Car Thomas Ruff recompose la totalité du sujet de l’image à partir d’une subtile redistribution de ces atomes. Le principe de cette recomposition consiste à substituer une contiguïté d’atomes extérieurs les uns aux autres à la continuité d’une ligne ou d’une figure dessinée ou photographiée. Les atomes sont toujours suffisamment organisés et contigus pour que le sujet apparaisse dès qu’on s’éloigne du cliché, et suffisamment désorganisés et discontinus pour dissoudre cette même figure dès qu’on cherche à l’approcher.
Ces atomes ne participent donc à la totalité de l’image et à sa portée photographique que par leur inscription dans un assemblage que le spectateur est invité à reconstituer. Ce procédé brise ainsi la croyance en la neutralité de l’écran et en la continuité des figures qui y apparaissent. Au moyen de l’agrandissement des pixels et de leur désorganisation organisée, Thomas Ruff démystifie dans ces JPegs la continuité apparente des images qui défilent sur nos écrans familiers, et fait apparaître la discontinuité réelle que l’écran leur impose tout en la dissimulant. Est ainsi exhibé ce pouvoir de (dé)composition de l’image inhérent à l’écran, l’apparence de continuité n’étant plus qu’un cas particulier de cette discontinuité fondamentale.
Mais ce procédé implique que le spectateur participe aussi de l’apparition de l’image. Il doit en effet se déplacer pour trouver le ou les points de vue à partir duquel ou desquels apparaîtra le sujet de l’image dans son faux-semblant de continuité. Les images-écrans auxquelles renvoient les JPegs n’ont donc pas la consistance matérielle des photographies ordinaires. Leur statut est éminemment fugace, puisque le sujet de l’image ne surgit que du hasard d’une rencontre, celle d’une image et d’un point de vue. Ainsi, dans un seul et même mouvement, les JPegs donnent le réel et le dérobent; la puissance de dissolution portée par cette pixellisation savante fait pendant à la brillance et à la vibration qui nous sont restituées dans l’instant fragile où nous trouvons un point de vue révélant la composition et le sujet d’ensemble. Cette apparition toujours menacée de disparition fait ainsi écho à l’inévitable précarité des images que nos écrans nous livrent, et qui tient à plusieurs choses: mémoire limitée des machines, flux d’images qu’on ne peut toutes retenir, et surtout l’écran sur lequel rien ne peut s’imprimer à proprement parler, demeurant irrémédiablement vierge de toute trace. Entre le noir sous-jacent des écrans et l’errance du regard en quête du bon point de vue, seul le flou demeure.
Ce n’est donc que dans l’éclair d’une coĂŻncidence que peut s’immiscer le jugement de rĂ©alitĂ© quant au sujet de l’image. Dans les JPegs en effet, le rĂ©el est plutĂ´t Ă©branlĂ© qu’annulĂ©: le regard oscille en permanence entre la reconnaissance quasi immĂ©diate d’évĂ©nements ou de lieux devenus familiers – les attentats du 11 septembre ou le temple d’Angkor – et l’effort de reconstitution toujours prĂ©caire d’une image qui pourrait aussi bien avoir Ă©tĂ© forgĂ©e de toutes pièces par une machine, sans rĂ©fĂ©rence aucune au rĂ©el. La rĂ©alitĂ© du sujet ne se soutient donc que des images que nous projetons sur ces images-Ă©crans que sont les JPegs. En l’absence de titre, rien ne permet d’authentifier avec certitude le temple d’Angkor et l’explosion du Pentagone. C’est donc la rĂ©fĂ©rence Ă d’autres images qui permet la reconnaissance. Mais c’est surtout ce dĂ©sir d’authentification et d’identification qui est ici mis en question, parce que vouĂ© Ă l’incertitude. Pour rendre lisibles ces images et leur donner un sens, nous projetons en effet presque spontanĂ©ment sur elles d’autres images, tirĂ©es de notre mĂ©moire (clichĂ©s des attentats, cartes postales du Cambdoge, etc.): nous participons donc Ă la fabrication du sens de ces images. Elles jouent donc une nouvelle fois le rĂ´le d’un Ă©cran, allumĂ© cette fois-ci par notre propre regard en quĂŞte de sens et d’identification. De ce point vue, l’écart entre les JPegs reprĂ©sentant des paysages anonymes de montagne ou des arbres et ceux Ă©voquant les attentats du 11 septembre ou le temple d’Angkor devient donc assez mince puisque, prises en elles-mĂŞmes, sans titres ni commentaires, toutes ces images purement anonymes restent ouvertes Ă l’hypothèse de la fiction comme Ă celle de la rĂ©alitĂ©.
L’anonymat de ces clichés est donc le corollaire de leur adroite atomisation interne. Toutes les images pouvant être réduites à un petit nombre de carrés ou d’atomes d’écran, elles ne se distinguent plus par leur référent «réel» mais uniquement par l’agencement de ces atomes. C’est ce que souligne le titre global des clichés exposés à la Galerie Nelson, qui fait planer le doute sur la singularité et donc sur l’authenticité des événements et des lieux. Évoquant le format informatique auquel toutes les images numériques peuvent être ramenées sans distinction, JPegs est le nom générique d’images sans nom, réductibles à un jeu d’impulsions électriques absolument indifférent à leur contenu. Les JPegs plongent donc le monde dans le noir de l’anonymat, celui de l’écran dans sa pure fonction de manifestation et de configuration des images, sans égard pour le rapport que le sujet entretient avec le réel. Les images-écrans nous placent ainsi toujours au bord de l’insignifiant, au bord du silence, et vibrent d’un étrange scintillement: est-ce celui de la vie ou la brillance lumineuse des machines? Les JPegs révèlent toute l’ambiguïté des images-écrans: écrans au réel mais écrans du réel, dorénavant indiscernable en soi de la fiction. Peut-être n’y a-t-il donc rien en dehors de l’écran, et Thomas Ruff nous abandonne à cette incertitude.
Thomas Ruff:
— JPegs, 2004. C-print. 246 x 188 cm.
— JPegs, 2005. C-print. 188 x 257 cm.
— JPegs, 2004. C-print. 188 x 311 cm.
— JPegs, 2004. C-print. 188 x 188 cm.
— JPegs, 2004. C-print. 244 x 188 cm.





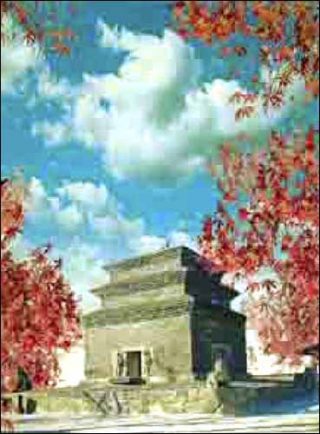
 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram