Propos recueillis par Pierre-Évariste Douaire
Pierre-Évariste Douaire. Que faisiez-vous avant de créer votre galerie?
JĂ©rĂ´me de Noirmont. Avant d’ouvrir la galerie en 1994, j’ai Ă©tĂ© pendant dix ans antiquaire. J’achetais des objets de toutes les Ă©poques. J’Ă©tais chineur.
Pourquoi l’art contemporain?
Je cĂ´toyais beaucoup d’artistes et j’avais envie de travailler avec eux. Je voulais exposer et dĂ©fendre l’art de notre Ă©poque, prĂ©senter la crĂ©ation actuelle.
Pourquoi s’installer avenue Matignon ? Quartier chic, mais Ă©loignĂ© des pĂ´les artistiques contemporains?
En 1994 le marchĂ© de l’art sortait d’une très grande crise. Toutes les grandes villes Ă©taient touchĂ©es de New York Ă Londres en passant par Paris. Il n’existait pas encore de quartiers clairement consacrĂ©s Ă l’art contemporain. La Bastille Ă©tait Ă ses balbutiements et la rue Louise Weiss n’existait pas encore. A l’inverse j’avais besoin de travailler très rapidement, et de rĂ©munĂ©rer les artistes que j’embarquais avec moi. Le VIIIe arrondissement s’est imposĂ© car il avait l’avantage de drainer une clientèle Ă©trangère, grâce Ă ses grands hĂ´tels et ses commerces de luxe. Dès le dĂ©part les collectionneurs Ă©trangers descendus Ă Paris au Bristol, situĂ© au coin de la rue, passaient devant la galerie avant de se rendre avenue Montaigne pour leur shopping. C’est anecdotique mais ce sont des petits dĂ©tails qui comptent. Parfois le succès tient Ă peu de chose!
Dès le dĂ©but vous aviez l’intention de vous tourner vers l’international?
Depuis l’antiquitĂ© l’art est international. C’est un Ă©change perpĂ©tuel. L’art s’est toujours affranchi des frontières. Les Romains achetaient des statues aux Grecs, la Chine et la Hollande ont toujours commercĂ©. L’aspect marchand d’une oeuvre d’art est trop souvent nĂ©gligĂ© Ă mon goĂ»t. Sa valeur, son prix, lui permettent de voyager. C’est grâce Ă eux qu’elle pourra affronter le passage du temps. Sa survie est liĂ©e Ă son prix. Je suis un propriĂ©taire provisoire de ce que je possède. Mon rĂ´le de galeriste se rĂ©sume Ă la fonction de passeur. Au final il n’y a que les œuvres qui nous survivent.
Vous vouliez axer votre stratégie sur des collectionneurs internationaux?
Tout Ă fait, nous avions un but prĂ©cis. Nous voulions prĂ©senter des artistes Ă©trangers, ce qui avait pour corollaire de tisser des liens avec des collectionneurs Ă©trangers. Les Français n’Ă©taient pas pour autant oubliĂ©s. Je ne voulais pas faire de prosĂ©lytisme pour une catĂ©gorie d’artistes. J’Ă©tais plus intĂ©ressĂ© par les questions et les interrogations des artistes que par leur nationalitĂ©. Le message primait plus que le passeport d’origine. La crĂ©ation Ă©tait la maĂ®tresse de nos destinĂ©es. La crĂ©ation contemporaine m’intĂ©resse quand elle permet de s’accepter et d’accepter les autres.
Vous avez dès vos dĂ©buts exposĂ© de grands noms de l’art contemporain.
Dès 1997 Jeff Koons a exposĂ© Ă la galerie. C’Ă©tait sa première exposition en France. Aucun autre lieu, mĂŞme institutionnel, n’avait franchi le pas. Nous avons eu la chance de faire la mĂŞme chose avec Shirin Neshat. En 1999 nous avons produit un de ses tout premiers films. Il est maintenant projetĂ© dans le monde entier et c’est une grande fiertĂ© pour nous.
Comment avez-vous réussi à les convaincre de venir à Paris?
Grâce à un mélange de culot et de flan. Je les ai démarchés personnellement. Je leur proposais de les défendre directement en France. Ils étaient parfois surpris, mais à force de conviction on finissait toujours par lier des contacts.
Quels Ă©taient les arguments que vous mettiez en avant pour les convaincre?
Je leur vantais Paris, un endroit extraordinaire, une citĂ© dĂ©diĂ©e aux arts. J’insistais sur l’Ă©clatement des foyers artistiques dans le monde. Plus aucune ville ne peut se prĂ©valoir du monopole des arts plastiques.
Paris demeure une place importante par son histoire et par son actualitĂ©, il Ă©tait important pour eux de ne pas la nĂ©gliger, car elle reste un endroit artistiquement et culturellement attirant. L’attrait financier ne les poussait pas Ă venir travailler ici. Les collectionneurs français n’Ă©taient pas encore assez nombreux pour les intĂ©resser. Il fallait pouvoir leur donner des garanties financières. La production d’œuvres Ă©tait un argument qui permettait d’emporter leur dĂ©cision. Le contact privilĂ©giĂ© avec l’artiste est tout aussi important que les propositions d’expositions et de monstration que vous lui proposez. Amener des projets permet d’exciter sa curiositĂ©, son envie de travailler avec vous sur des commandes publiques ou privĂ©es.
ĂŠtre capable de monter une œuvre monumentale comme celle de Jeff Koons Ă Avignon permet de surmonter les rĂ©sistances les plus dures j’imagine?
Solange Auzias de Turenne, la commissaire de l’exposition les «Champs de la sculpture», avait commandĂ© Split Rocker. Mais le projet a avortĂ© pour des raisons techniques et le coĂ»t d’installation de la sculpture vĂ©gĂ©tale. La pièce Ă©tait tellement lourde et si difficile Ă mettre en place sur l’avenue des Champs-ÉlysĂ©es, que ces complications et le manque de temps ont eu raison de notre enthousiasme.
Mais grâce Ă Jean de Loisy, le commissaire de la BeautĂ© in fabula, qui a eu vent de l’Ă©tat d’avancement de la production en cours et de l’impossibilitĂ© de terminer dans les temps les travaux Ă Paris, nous avons pu la rĂ©aliser en Avignon. Il nous a laissĂ© choisir l’emplacement dans la cour du Palais des Papes.
L’Ă©vĂ©nement Ă©tait de taille, pour la France, car elle avait l’exclusivitĂ© mondiale de cette rĂ©alisation, et pour Jeff Koons, qui avait Ă sa disposition un lieu fabuleux. Le rĂ©sultat Ă©tait Ă la hauteur de nos espĂ©rances. Split Rocker trĂ´nait dignement dans la citĂ© papale, il Ă©tait le point d’orgue de la manifestation. La fondation Pinault l’a acquis avant l’inauguration.
C’est difficile d’exposer des artistes stars avec la concurrence actuelle?
Non car vous Ă©tablissez des liens affectifs avec les artistes. Un climat de confiance se tisse au fil des annĂ©es. Il faut pouvoir leur garantir des retombĂ©es Ă©conomiques, de belles expositions et de beaux projets. Vous ajoutez Ă cela une complicitĂ© de dix ans et au final il n’est pas difficile de travailler avec eux. Pour autant rien n’est jamais acquis d’avance et il faut se battre continuellement. C’est ça qui est bien !
Daniel Templon me disait dans une interview prĂ©cĂ©dente que les galeries anglo-saxonnes ne permettaient plus Ă leurs artistes d’exposer Ă l’Ă©tranger, car elles imposent des conditions financières prohibitives.
La France est moins attractive sur des donnĂ©es purement commerciales. Si vous traitez par l’intermĂ©diaire de ces galeries ce n’est pas financièrement intĂ©ressant. Par contre si vous passez outre et que vous traitez directement avec les artistes, les barrières et les rĂ©ticences tombent d’elles-mĂŞmes.
Il me disait qu’il pouvait librement accueillir les artistes conceptuels…
C’est vrai que Daniel a connu les annĂ©es 1970. C’Ă©tait un vĂ©ritable no man’s land commercial pour l’art. Les opportunitĂ©s Ă©taient beaucoup plus faciles Ă lancer. Dès les annĂ©es 1980 les choses ont changĂ© et les affaires sĂ©rieuses se sont mises en place. Encore une fois tout dĂ©pend des relations privilĂ©giĂ©es que vous entretenez avec les artistes.
Comment les choisissez-vous justement?
Certaines galeries se spĂ©cialisent dans un type d’art, moi je prĂ©fère me laisser guider par mon plaisir. Une galerie, malgrĂ© le travail en Ă©quipe, reste Ă l’image d’un homme. Elle reflète le choix d’une personne. Il faut crĂ©er des liens très Ă©troits avec les artistes et les collectionneurs. C’est une alchimie très particulière Ă obtenir. Je choisis les artistes que j’aime, qui me questionnent, qui recoupent mes propres prĂ©occupations, qui m’amènent Ă douter. Leur esthĂ©tisme me touche et m’influence beaucoup.
Vous avez utilisé le terme de «passeur» pour définir votre rôle de galeriste, pourquoi?
C’est très important de rendre visible l’art de notre Ă©poque. Cette mission passe par la vente et par les expositions. Il faut permettre aux œuvres d’ĂŞtre visibles. Cette Ă©tape achevĂ©e, il faut penser Ă ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir acquĂ©rir une pièce unique. Eux aussi ont le droit d’accĂ©der Ă la crĂ©ation. C’est pour cette raison que nous fournissons un gros effort d’Ă©dition. Nous publions beaucoup de catalogues de nos expositions. Tout le monde peut se l’offrir contrairement aux œuvres exposĂ©es. Il permet de garder une impression de l’exposition.
Donner la photographie d’un moment prĂ©cis permet d’œuvrer pour la postĂ©ritĂ©. Mais c’est aussi un bon argument de vente, il ne faut pas le nier, ils facilitent les ventes. Leur diffusion dans le monde permet aux artistes de toucher un public très large. Le spectateur lambda comme le directeur d’un musĂ©e ont accès Ă l’exposition. Pour les textes, nous privilĂ©gions des auteurs qui s’intĂ©ressent aux artistes et qui amènent un regard nouveau. Des grands conservateurs Ă©trangers et des critiques français travaillent de concert avec les artistes et la galerie. Cet Ă©change est bĂ©nĂ©fique. Il illustre bien selon moi, la façon dont fonctionne l’art contemporain aujourd’hui.
Vous avez pensé votre site internet comme vos catalogues.
Internet est un outil de communication très important. Les galeries sont très en retard dans ce domaine, elles ne pensent qu’en terme de rentabilitĂ© immĂ©diate. Nous soignons particulièrement la mise Ă jour des visuels et des textes pour rester crĂ©dible.
Il y a dans votre galerie un goût pour le travail bien fait, pour le rendu impeccable.
Si vous parlez du cĂ´tĂ© mĂ©ticuleux du travail de Pierre et Gilles, je pense qu’il favorise l’accessibilitĂ© Ă l’œuvre exposĂ©e. Par ce biais elle se donne plus facilement. C’est un marche pied qui aide le spectateur. Ensuite vient le temps de la complexitĂ© et des interprĂ©tations. Ce genre de facture permet un accès immĂ©diat. Le public n’est pas rejetĂ©, il peut grâce Ă cette politesse tourner la première page du livre qui lui est proposĂ©.
Vous êtes la galerie des couples : Pierre et Gilles, McDermott et McGough, Eva et Adèle. Le travail à quatre mains est-il plus intéressant que les autres?
C’est un hasard que je n’explique pas. Je travaille avec eux sans doute parce qu’avec mon Ă©pouse nous formons aussi un duo. Mais nous n’avons pas voulu cela. Cette situation s’est imposĂ©e d’elle-mĂŞme. Je vous rassure nous n’avons pas encore cherchĂ© Ă dĂ©baucher Gilbert et George. Nous ne nous destinons pas Ă devenir la galerie des couples d’artistes. Par contre le travail en collaboration m’a toujours intĂ©ressĂ©. Quand Warhol et Basquiat peignent ensemble le rĂ©sultat me fascine toujours. J’ai toujours Ă©tĂ© frappĂ© par les ateliers hollandais du XVIe et surtout du XVIIe siècle, qui mĂ©langeaient la peinture du père et du fils. RĂ©aliser une œuvre Ă deux ou quatre mains ne m’intĂ©resse que si le rĂ©sultat est satisfaisant. La signification d’une œuvre m’importe plus que sa rĂ©alisation. Peu importe qu’elle soit le fruit d’une ou plusieurs personnes.
Comment vous répartissez-vous les tâches avec votre épouse?
Je m’occupe de la partie artistique, de la crĂ©ation, de la production des œuvres. Elle prend en charge la communication et l’aspect administratif. Tout cela en relation Ă©troite avec les artistes. Elle est la moitiĂ© de moi-mĂŞme dans la crĂ©ation et l’activitĂ© de la galerie. Elle est essentielle.
Est-il vrai que les galeries choisissent leurs collectionneurs comme Ă l’entrĂ©e d’une boĂ®te de nuit (se reporter Ă Adam Lindeman, Collectionner l’art contemporain, Ă©d. Taschen)?
Certaines galeries s’ingĂ©nient Ă crĂ©er des files d’attentes fictives en expliquant que l’artiste ne produit que trois tableaux dans l’annĂ©e. En fait il s’agit de trois tableaux vendus dans l’annĂ©e. Nuance. Peu d’artistes ne font que trois œuvres dans l’annĂ©e. Cette façon de procĂ©der est purement marketing. Depuis dix ans, la concurrence entre les maisons de vente a changĂ© la vision traditionnelle du marchĂ© de l’art. Le rapport entre la galerie et le collectionneur est dĂ©passĂ© par l’arrivĂ©e des grosses maisons. Ces nouveaux acteurs ont imposĂ© des techniques commerciales nouvelles et agressives. Certaines provoquent la pĂ©nurie d’un artiste ou rarĂ©fient son offre. Je comprends la chose quand le manque est rĂ©el, quand une production se limite Ă une vingtaine d’œuvres par an, par contre je n’ose pas croire qu’un artiste ne produise que trois œuvres dans une annĂ©e.
Comment voyez-vous l’explosion du marchĂ© de l’art contemporain ? La spĂ©culation est de retour, c’est une menace?
L’art contemporain est par essence spĂ©culatif. Il ne faut pas s’en offusquer. Pour sa première exposition un artiste vaut le prix que l’on veut bien lui donner. Mais depuis l’apparition de grandes fortunes Ă travers le monde, le marchĂ© s’est complètement emballĂ©. Ces Ă©volutions sont difficilement perceptibles en France car la sociĂ©tĂ© est très nivelĂ©e. L’Inde, la Chine et la Russie ont accouchĂ© de gens extrĂŞmement riches. C’est assez inimaginable, ces quelques privilĂ©giĂ©s concentrent des liquiditĂ©s colossales! Après avoir achetĂ© tout ce dont ils rĂŞvaient, ils jettent leur dĂ©volu sur des œuvres d’art pour se diffĂ©rencier. Le marchĂ© contemporain en profite actuellement, mais il ne faudrait pas que les collectionneurs soient lĂ©sĂ©s dans cette histoire.
C’est-Ă -dire?
Certaines œuvres sont devenues inabordables tandis que d’autres, par effet de levier, voient leurs prix s’envoler. Le marchĂ© de l’art est très transparent. Beaucoup plus transparent qu’il n’y paraĂ®t, car tout se passe en galerie. Ce n’est que pendant les ventes aux enchères que le grand public s’Ă©tonne. Les prix records font grand bruit dans l’opinion public, mais cela reste marginal et très mĂ©diatique. Ce genre de phĂ©nomène favorise la starification des artistes les plus en vue. Cela profite aux artistes et surtout Ă la crĂ©ation. Tant mieux.






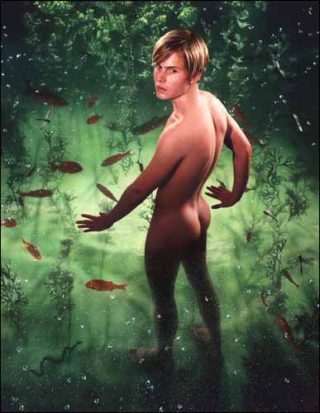



 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram