ŌĆö ├ēditeur : Le Magasin, Grenoble
ŌĆö Ann├®e : 2002
ŌĆö Format : 29 x 23,50 cm
ŌĆö Illustrations : nombreuses, en couleurs et en noir et blanc
ŌĆö Pages : 175
ŌĆö Langues : fran├¦ais, anglais
ŌĆö ISBN : 2-906732-73-7
ŌĆö Prix : 36 Ōé¼
Introduction
par Lionel Bovier et Fabrice Stroun
┬½ Que faire dŌĆÖun artiste tel que Jack Goldstein qui, apr├©s des performances, des films et des peintures mettant lŌĆÖaccent sur des effets spectaculaires, se tourne vers une peinture ┬½┬Āabstraite┬Ā┬╗ ŌĆö ou, plus pr├®cis├®ment, vers une peinture dŌĆÖimages et dŌĆÖ├®v├®nements rendus abstraits (…) ? ┬╗ CŌĆÖest par cette interrogation que sŌĆÖouvre un important essai de Hal Foster, ┬½ Signs Taken for Wonders ┬╗ (paru en 1986 et reproduit ci-apr├©s [Hal Foster, ┬½ Signs Taken for Wonders ┬╗, Art in America, New York, n┬░74, juin 1986, p. 80-91 et 139]), sŌĆÖattachant ├Ā d├®crire et ├®valuer diff├®rentes pratiques abstraites (picturales ou para-picturales) dŌĆÖartistes encore rattach├®s au ph├®nom├©ne r├®cent de ┬½ lŌĆÖappropriationisme ┬╗. Portant un regard critique sur cette ┬½ nouvelle peinture ┬╗, Foster lui pr├¬te une habilet├® ├Ā instrumentaliser des styles issus des avant-gardes, une certaine mauvaise fois historique et un rapport plus quŌĆÖambigu avec le march├® ŌĆö tous traits quŌĆÖelle partage avec le n├®o-expressionnisme ambiant. LŌĆÖauteur en vient m├¬me ├Ā douter de la capacit├® de la peinture (un artisanat bourgeois datant de lŌĆÖ├©re pr├®industrielle) ├Ā interroger s├®rieusement notre soci├®t├® capitaliste et technologique. Au-del├Ā de ce constat partiellement n├®gatif, cet article est symptomatique de la fortune critique de Jack Goldstein dans les ann├®es 1980, qui reste ins├®parable des d├®bats id├®ologiques qui secouent cette d├®cennie. Son ┼ōuvre sert en effet de pivot ├Ā nombre de commentateurs qui accompagnent lŌĆÖav├©nement de ┬½ lŌĆÖappropriationisme ┬╗, puis du ┬½ simulationisme ┬╗. ├Ć chaque fois, il nŌĆÖest pas seulement question de d├®crire des pi├©ces contemporaines de lŌĆÖartiste, mais de rappeler son parcours. Tour ├Ā tour post-minimal, post-conceptuel, associ├® aux d├®veloppements de la performance, puis enfin au retour critique dŌĆÖune peinture ayant accompli la mod├®lisation du tableau en objet et du motif en image (picture), le travail prot├®iforme de Jack Goldstein traverse la plupart des courants n├®o-avant-gardistes des ann├®es 1970 et 1980. Pour toute une g├®n├®ration de critiques engag├®s, comme Douglas Crimp, Craig Owens et Hal Foster, cette ┼ōuvre permet alors, non seulement de diagnostiquer le positionnement id├®ologique de la production artistique am├®ricaine contemporaine, mais ├®galement dŌĆÖeffectuer un pronostic global sur le devenir de la (post-)modernit├®.
Douglas Crimp affirme ainsi dans Pictures, un texte accompagnant lŌĆÖexposition ├®ponyme organis├®e pour ┬½ Artists Space ┬╗ ├Ā New York en 1977, que les films et performances de Jack Goldstein op├©rent un v├®ritable d├®placement dans notre conception de lŌĆÖimage. LŌĆÖauteur inscrit les travaux des artistes rassembl├®s (on trouve notamment, ├Ā c├┤t├® de Goldstein, Sherrie Levine, Troy Brauntuch et Robert Longo), dans la filiation du minimalisme. Dans une deuxi├©me version de ce texte, publi├® en 1979 dans la revue October [Les deux textes figurent dans la pr├®sente anthologie], il revient en effet sur la ┬½ th├®├ótralisation ┬╗ de lŌĆÖ┼ōuvre dŌĆÖart d├®cri├®e par Michael Fried [Dans son c├®l├©bre article de 1967 ┬½ Art and Objecthood ┬╗, paru dans le num├®ro de juin dŌĆÖArtforum; on en trouve une traduction fran├¦aise in Artstudio, Paris, vol. 6, automne 1987], effet structurel qui met en p├®ril lŌĆÖautonomie formelle de lŌĆÖ┼ōuvre en instaurant dans lŌĆÖexp├®rience de sa perception une dur├®e subjective ŌĆö et qui d├®termine un nouveau rapport triangulaire entre lŌĆÖobjet, son contexte, et le spectateur. Pour Crimp, les artistes de Pictures, renversant les priorit├®s de lŌĆÖart minimal, font de la situation litt├®rale et de la dur├®e de lŌĆÖ├®v├®nement une image, dont la pr├®sence et la temporalit├® sont int├®gralement psychologis├®es. Ainsi, les films et les performances de Jack Goldstein sont appr├®hend├®s par le spectateur comme une repr├®sentation, non pas tant au sens dŌĆÖune ┬½ re-pr├®sentation de ce qui leur est pr├®alable, mais en tant que condition in├®vitable de lŌĆÖintelligibilit├® de ce qui est pr├®sent [Douglas Crimp, ┬½┬ĀPictures┬Ā┬╗, October, Cambridge, MIT Press, n┬░8, printemps 1979, p. 77; nous traduisons.] ┬╗. En ce sens, ces ┼ōuvres, en mettant lŌĆÖaccent sur les structures de signification, ┬½ (…) maintiennent un rapport de d├®pendance ├Ā lŌĆÖaspiration radicale que nous continuons dŌĆÖidentifier comme modernistes ┬╗ [Douglas Crimp, ┬½ Pictures ┬╗ in Pictures, cat., ┬½ Artists Space ┬╗, New York 1977, n. p.; nous traduisons].
Crimp sŌĆÖinterroge ici sur le devenir des avant-gardes, ├Ā un moment o├╣ la pertinence politique et le caract├©re exp├®rimental de lŌĆÖart sont largement remis en cause. Dans ┬½ The Photographic Activity of Postmodernism ┬╗, publi├® dans October en 1980 [Douglas Crimp, ┬½ The Photographic Activity of Postmodernism ┬╗, October, Cambridge, MIT Press, n┬░15, hiver 1980, p. 91-101], il oppose ainsi au ┬½ pluralisme ┬╗ ambiant, libre de toute d├®termination historique, une notion de post-modernit├® responsable et progressiste. La fin de lŌĆÖautonomie de lŌĆÖ┼ōuvre et lŌĆÖacquisition dŌĆÖune aura ┬½ fantomatique ┬╗ ŌĆö lŌĆÖabsence dŌĆÖorigine, dŌĆÖauteur et dŌĆÖauthenticit├® ŌĆö, sont alors con├¦ues comme des ├®l├®ments dŌĆÖune strat├®gie critique et engag├®e. Pour Crimp, ┬½ le postmodernisme ne peut ├¬tre compris que comme une rupture sp├®cifique avec le modernisme, avec ces institutions qui pr├®conditionnent et qui construisent le discours du modernisme ┬╗ [Ibid., p. 91 ; nous traduisons], ├Ā savoir le mus├®e, lŌĆÖhistoire de lŌĆÖart et, dŌĆÖune mani├©re plus complexe (┬½ puisque le modernisme d├®pend ├Ā la fois de son absence et de sa pr├®sence ┬╗ [Ibid.; nous traduisons]), la photographie.
JusquŌĆÖau d├®but des ann├®es 1980, la plupart des artistes de Pictures exposent encore dans des lieux alternatifs, loin des institutions mus├®ales et du march├®. Mais, lorsquŌĆÖen 1979, Goldstein abandonne (quasiment) sa production filmique pour se consacrer ├Ā la peinture, ce passage sera v├®cu par de nombreux critiques comme une semi-d├®ception. Dans ┬½ Back to the Studio ┬╗, un long texte pol├®mique ├®crit ├Ā la suite dŌĆÖune exposition dŌĆÖanciens ├®tudiant de CalArts en 1981 [Craig Owens, ┬½ Back to the Studio ┬╗, Art in America, New York, n┬░56, janvier 1982, p. 99-107; reproduit ci-apr├©s. LŌĆÖexposition ├®tait organis├®e par Helene Winer, co-fondatrice de la galerie Metro Pictures, o├╣ pr├®cis├®ment les artistes de Pictures allaient exposer durant les ann├®es 1980], Craig Owens sŌĆÖinterroge ainsi sur le retour de cat├®gories traditionnelles comme la peinture et lasculpture au sein dŌĆÖune g├®n├®ration pourtant issue du ┬½ poststudio art ┬╗. Il rappelle que lŌĆÖatelier est le premier maillon dŌĆÖune cha├«ne de contr├┤le incluant la galerie, le Mus├®e et lŌĆÖhistoire de lŌĆÖart : ┬½ cŌĆÖest cette s├®paration initiale du lieu de production dŌĆÖavec le lieu dŌĆÖexposition qui ali├©ne un artiste de sa propre production, le r├®duisant ├Ā ├¬tre un fournisseur de marchandises pour un march├® de lŌĆÖart sp├®culatif ┬╗ [Ibid., p. 101; nous traduisons]. Et si nombre des artistes pr├®sent├®s dans lŌĆÖexposition jouent la feinte (on parle alors volontiers dŌĆÖune subversion complice), Owens questionne la possibilit├® r├®elle de maintenir une distance critique de lŌĆÖint├®rieur du syst├©me. En ce qui concerne les peintures de Jack Goldstein, Owens identifie dans le geste warholien de substitution de la figure du producteur ├Ā celle de lŌĆÖartiste, dans le traitement profond├®ment inauthentique de ces objets (qui mettent ├Ā mal la notion m├¬me de tableau) et dans le caract├©re ┬½ public ┬╗ de lŌĆÖiconographie, des motifs de continuit├® de son travail pr├®c├®dent et des proc├®d├®s radicaux de sa pratique performative et filmique. Sans pour autant percevoir cette nouvelle production comme un renoncement de la part de lŌĆÖartiste, lŌĆÖauteur se demande n├®anmoins si, dans un contexte quŌĆÖil juge globalement r├®actionnaire, la spectacularisation extr├¬me de la violence dans les toiles de Goldstein (├Ā travers les th├®matiques guerri├©res de cette ├®poque), ne participent finalement pas au dispositif de s├®duction quŌĆÖelles critiquent.
Revenant, quelque dix ann├®es plus tard, sur ces propos, Foster conclut :
La simulation nŌĆÖest ├®galement pas une force ├Ā prendre ├Ā la l├®g├©re en dehors de IŌĆÖart. Avec les r├®gimes plus anciens de la surveillance disciplinaire et du spectacle m├®diatique, la simulation dŌĆÖ├®v├®nements est une forme importante de dissuasion sociale aujourdŌĆÖhui, car comment pouvons-nous intervenir dans des ├®v├®nements quand ceux-ci sont simul├®s ou remplac├®s par des pseudo├®v├®nements ? (ŌĆ”) Mais de nombreux artistes du N├®o-G├®o ont cherch├® ├Ā repr├®senter ce recouvrement par les signes : lŌĆÖabstraction des mod├©les du capitalisme avanc├® (ŌĆ”), des modes technologiques de vision, comme dans les peintures spectaculaires de Jack Goldstein (ŌĆ”). La tentative de repr├®senter cet ordre abstrait extra-artistique peut ├¬tre comprise comme un projet cognitif. Elle pourrait m├¬me ├¬tre associ├®e ├Ā la ┬½ cartographie cognitive ┬╗ des syst├©mes capitalistes avanc├®s d├®fendue par Frederic Jameson. Pourtant, le N├®o-G├®o ne cherchait pas tant ├Ā nous situer dans ce nouvel ordre, quŌĆÖil ne nous plongeait dans une crainte esth├®tique face ├Ā ses effets : il aspirait en r├®alit├® ├Ā cr├®er une version actuelle du sublime capitaliste.
The Return of the Real [Hal Foster, The Return of the Real, MIT Press, Cambridge 1996, p. 105; nous traduisons]
Ainsi, de Pictures (1977) ├Ā lŌĆÖouvrage de Foster de 1996, on passe des aspirations n├®o-avant-gardistes dŌĆÖune g├®n├®ration issue des ann├®es 1960-1970 ├Ā lŌĆÖaccomplissement dŌĆÖune fin de partie (endgame). Si cette histoire nŌĆÖest quŌĆÖincidemment celle de Jack Goldstein ŌĆö dont la coh├®sion interne du travail, traversant trois d├®cennies, offre bien dŌĆÖautres entr├®es ŌĆö, il nous semblait n├®cessaire de souligner que son ┼ōuvre na cess├® de synth├®tiser, au sein dŌĆÖun contexte critique fort, les contradictions les plus aigu├½s de son ├®poque. Pour cette raison, nous avons donn├® dans cette anthologie une place importante aux textes de Crimp, Foster et Owens. Le fait quŌĆÖil nŌĆÖexiste gu├©re de bilan ou dŌĆÖouvrage offrant une perspective synth├®tique sur ces d├®bats th├®oriques [Voir cependant : Hal Foster (├®d.), The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture, The New Press, New York 1983; Brian Wallis (├®d.), Art After Modernism : Rethinking Representation, The New Museum of Contemporary Art, R. Godine Publisher, New York & Boston 1984; Russell Ferguson, William Olander, Marcia Tucker, Karen Fiss (├®ds.), Discourses : Conversations in Postmodern Art and Culture, The New Museum of Contemporary Art, MIT Press, New York & Cambridge iggo] ŌĆö et aucun en langue fran├¦aise ŌĆö a, au surplus, encourag├® une telle r├®union. ├Ć ces textes doivent encore ├¬tre associ├®s deux articles de Thomas Lawson (reproduits ci-apr├©s), un des rares artistes de sa g├®n├®ration ├Ā ├®pouser pleinement la position de critique. ┬½ The Uses of Representation : Making Some Distinctions ┬╗ [Publi├® in Flash Art International, Milano, n┬░ 88-89, mars-avril 1979, p. 37-38; reproduit ci-apr├©s] prend ainsi la forme dŌĆÖun v├®ritable manifeste pour la pratique dŌĆÖartistes tels que Goldstein, Salle ou Brauntuch, position que d├®veloppe et radicalise encore son c├®l├©bre essai Last Exit : Painting [Thomas Lawson, ┬½ Last Exit : Painting ┬╗, Artforum, New York, n┬░ 2, octobre 1981, p. 40-47]. Revendiquant pour la peinture ┬½ appropriationiste ┬╗ une position centrale dans un post-modernisme engag├® et critique, il conf├©re ├Ā ce m├®dium un r├┤le aussi stimulant que celui que joue la photographie pour Levine, Prince ou Sherman. Son ├®tude monographique sur Goldstein, parue dans Real Life [Thomas Lawson, ┬½ Long Distance Information ┬╗, RealLife, New York, n┬░4, ├®t├® 1980, p. 3-5], le magazine quŌĆÖil ├®ditait ├Ā New York au d├®but des ann├®es 1980, reste en outre lŌĆÖun des meilleurs textes sur la fantasmagorie froide, mcluhanienne d├®clin├®e par lŌĆÖartiste dans ses peintures de guerre ou de catastrophes.
Outre des comptes-rendus dŌĆÖexpositions, apportant maintes pr├®cisions documentaires, cette anthologie r├®unit la plupart des analyses monographiques consacr├®es au travail de Goldstein. Ainsi, un tr├©s large extrait du texte de David Salle ┬½ Jack Goldstein; Distance Equals Control ┬╗ (publi├® dans le catalogue accompagnant lŌĆÖexposition de la Hallwalls Gallery de Buffalo en 1978), qui identifie d├®j├Ā les principales caract├®ristiques de son travail et ses modes de production. LŌĆÖauteur d├®crit en effet, avec pr├®cision, lŌĆÖaspect commercial, hollywoodien de lŌĆÖ┼ōuvre et la mutation concomitante de la figure de lŌĆÖartiste en celle de producteur; le spectacle hyper-r├®el, m├®diatis├® du monde comme processus de contr├┤le social et de substitution existentielle; lŌĆÖanxi├®t├® sourde dŌĆÖune catastrophe diff├®r├®e; la m├®taphorisation de lŌĆÖimage, sa condition essentiellement th├®├ótrale et psychologique. Sur ce dernier, point David Salle alloue ├Ā lŌĆÖ┼ōuvre de Jack Goldstein une dimension quasi-brechtienne en avan├¦ant que ┬½ nous pourrions bien ├¬tre confront├®s, avec ce travail, aux premiers d├®veloppements dŌĆÖun nouveau genre dŌĆÖart social d├®coulant dŌĆÖune dialectique avec la culture entendue comme enti├©rement disponible pour tous ┬╗ [David Salle, ┬½ Jack Goldstein; Distance Equals Control ┬╗, in Jack Goldstein, Cat., Hallwalls, Buffalo 1978, p. 9; nous traduisons].
Nous publions ├®galement, dans son int├®gralit├®, ┬½ Jack Goldstein : The Trace of Absence ┬╗ de Jean Fisher (1983), qui adopte une approche plus ouvertement philosophique [Nous renvoyons ├®galement le lecteur ├Ā deux autres textes de Fisher, que nous nŌĆÖavons pu retenir dans lŌĆÖanthologie par manque de place et qui se pr├¬tent mal ├Ā la publication partielle, lŌĆÖun paru dans le catalogue de la premi├©re r├®trospective de Goldstein (St├żdtische Galerie Erlangen, 1985), lŌĆÖautre co-sign├® avec Stella Santacatterina ┬½ Figuring DifferenceŌĆöThe Work of Jack Goldstein ┬╗) et publi├® r├®cemment dans la revue Afterall (London, n┬░4, 2001, p. 30-34) et qui d├®veloppent sensiblement les m├¬mes arguments en variant les corpus philosophiques utilis├®s dans lŌĆÖanalyse (Derrida pour le premier, Deleuze pour le second)]. La dialectique de pr├®sence et dŌĆÖabsence, d├®velopp├® par Douglas Crimp ├Ā partir de lŌĆÖart minimal, est ici rejou├®e sur le mode heideggerien : pour lŌĆÖauteur, en effet, la mise en sc├©ne des processus de distanciation induits par le spectacle de la technologie engendre une ┬½ qualit├® dŌĆÖimminence ┬╗, une nouvelle forme de sublime. Si, comme le pr├®tend Owens, ┬½ la distance dont parle Goldstein nŌĆÖest pas essentiellement dŌĆÖordre esth├®tique mais ├®pist├®mologique ┬╗ [Owens, art. cit., p. 105 ; nous traduisons], alors le texte de Fisher est probablement lŌĆÖun des plus proches des consid├®rations propres ├Ā lŌĆÖartiste.
Enfin, les textes de Rosetta Brooks [QuŌĆÖil sŌĆÖagisse de celui que nous publions en extraits (┬½ Space Fictions ┬╗, Flash Art International, n┬░131, d├®c. i986ŌĆöjanv. 1987, p. 78-80) ou de son ├®tude monographique sur lŌĆÖartiste paru dans le magazine ZG n┬░3 dont lŌĆÖauteur ├®tait ├®galement lŌĆÖ├®ditrice (London, 1981, p. [?])] mettent lŌĆÖaccent, singuli├©rement, sur les r├®f├®rences issues de la culture populaire dans lŌĆÖ┼ōuvre de Goldstein (vulgarisation scientifique, fascination dŌĆÖune soci├®t├® pour la technologie, science-fiction, etc.), autrement dit, sur un aspect souvent n├®glig├® dŌĆÖun artiste se disant pourtant int├®ress├® ├Ā ┬½ combler lŌĆÖespace entre le Pop et lŌĆÖart minimal ┬╗ [Morgan Fisher, ┬½ Talking with Jack Goldstein ┬╗, LAICA journal, Los Angeles, n┬░14, avril-mai 1977, p. 42].
Les quatre entretiens donn├®s par Jack Goldstein depuis 1977 ŌĆö ├Ā Morgan Fisher dŌĆÖabord (cin├®aste exp├®rimental de Los Angeles et ami proche), ├Ā Michael Newman ensuite (pour la revue ZG en 1981), ├Ā Chris Dercon (enregistr├® en 1985 pour la t├®l├®vision n├®erlandaise et rest├® in├®dit) et Philip Pocock enfin (pour son Journal of Contemporarv Art en 1988) ŌĆö ├®clairent de nombreuses autres facettes du travail. Ils seront consid├®rablement utilis├®s, tout comme les aphorismes de lŌĆÖartiste dont nous republions ├®galement une s├®lection, dans les textes critiques parus depuis la fin des ann├®es 1990. CŌĆÖest que, ainsi que lŌĆÖ├®crit John Miller :
├Ć bien des ├®gards, Jack Goldstein reste son meilleur critique. Son autocritique prend la forme dŌĆÖun manifeste paradoxal, r├®dig├® en aphorismes. LŌĆÖaphorisme (en tant que para-Doxa) est une forme ad├®quate pour ├®duquer un potentiel spectateur, Un seul aphorisme peut suffire ├Ā mettre en place une s├®rie extr├¬mement condens├®e de propositions qui forment une superstructure quasi-autonome. Ces propositions nŌĆÖen restent pas moins des potentialit├®s. Le style ├®pur├® de Goldstein les concr├®tise. Elles en apparaissent irr├®vocables : ┬½ Un explosif cŌĆÖest la beaut├® avant ses cons├®quences. ┬╗ ┬½ Les objets dangereux sont des lieux s├®duisants ├Ā vivre. ┬╗ ┬½ La spontan├®it├® est une m├®taphore du risque. ┬╗ Mieux encore, elles mat├®rialisent lŌĆÖespace entre ce quŌĆÖune ┼ōuvre peut faire et ce que nous r├¬vons quŌĆÖelle puisse faire. [John Miller, ┬½ A Trailer for the Future ┬╗, in Jack Goldstein, cat., Galerie Daniel Buchholz, K├Čln 2002, [en pr├®paration]; nous traduisons.]
La r├®trospective organis├®e par Bruce Grenville pour la Mendel Art Gallery de Saskatoon en 1992 sera lŌĆÖoccasion de faire un premier ├®tat des lieux. Dans ┬½ The Spectacle of Technology ┬╗, lŌĆÖauteur prend de la distance avec lŌĆÖune ou lŌĆÖautre des lectures pr├®valentes des ann├®es 1970 et 1980 et, surtout, commente de mani├©re d├®taill├®e et chronologique lŌĆÖensemble des ├®tapes du travail et de sa r├®ception critique. ├Ć cette ├®poque, Jack Goldstein dispara├«t plus ou moins compl├©tement du circuit des expositions et d├®veloppe un travail dŌĆÖ├®criture ├Ā cette heure encore in progress. La voie ouverte par Grenville restera ainsi sans ├®cho, jusquŌĆÖ├Ā lŌĆÖexposition organis├®e par Fareed Armaly au K├╝nstlerhaus de Stuttgart en 1999, ┬½ Jack Goldstein. Artist Once-Removed ┬╗, dont la pr├®sente exposition souhaite cr├®diter lŌĆÖeffet inducteur. LŌĆÖentretien r├®alis├® avec lŌĆÖorganisateur, qui cl├┤t lŌĆÖanthologie, dresse un panorama des nouveaux champs de lecture et dŌĆÖinterpr├®tation de lŌĆÖ┼ōuvre de Goldstein se dessinant aujourdŌĆÖhui. Prenant en compte le contexte historique et culturel ├®largi de lŌĆÖ├®poque et tenant lŌĆÖ┼ōuvre comme une r├®ponse non seulement esth├®tique, mais ├®galement socio-politique aux profondes transformations du champ de lŌĆÖart et de lŌĆÖindustrie du spectacle, ces nouvelles pistes ont ├®t├® explor├®es r├®cemment par John Miller (┬½ A Trailer for the Future ┬╗ [Publi├® in Art + Text, Los Angeles, n┬░75, nov. 2001ŌĆöjanv. 2002, p. 58-65]), Meg Cranston (┬½ Haunted by the Ghost : Jack GoldsteinŌĆöThen and Now ┬╗) ou Tom Holert (┬½ Managing FascinationŌĆöJack Goldstein, Hollywood and the Desire for Control ┬╗ [Publi├® in Afterall, London, n┬░4, 2001, p. 40-47]). Dressant une cartographie du milieu artistique californien des ann├®es 1970 et de ses liens avec lŌĆÖindustrie hollywoodienne, red├®ployant les ┼ōuvres dans lŌĆÖespace des positionnements id├®ologiques de cette fin de si├©cle, ces textes font non seulement du travail de Goldstein une machine ├Ā capturer les d├®sirs, les pulsions et les angoisses traversant notre soci├®t├® capitaliste et technologique, mais ├®galement lŌĆÖhorizon dŌĆÖune possible action sur cette soci├®t├®.
(Texte publi├® avec lŌĆÖaimable autorisation des ├®ditions du Magasin)
LŌĆÖartiste
Jack Goldstein, n├® en 1945 ├Ā Montr├®al, Canada, vit ├Ā Los Angeles, ├ētats-Unis.

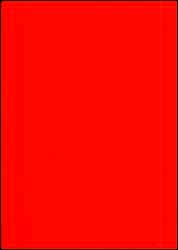

 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram