Interview
Par Pierre-Évariste Douaire
Es-tu conscient du chemin que tu as parcouru en dix ans ?
Oui, je vois bien l’Ă©volution, cela fait quinze ans que j’ai ouvert ma première galerie. Pendant quatre ans, j’ai Ă©tĂ© assistant — de dix-sept Ă vingt-et-un ans — puis je me suis lancĂ© dans cette aventure. Maintenant, il y a beaucoup plus de personnes qui me disent bonjour. Je vois très bien cette Ă©volution Ă la Biennale de Venise ; mieux qu’ailleurs les personnalitĂ©s se rĂ©vèlent et tous les deux ans je peux constater le chemin parcouru. Mais si j’ai avancĂ©, je sais très bien — et mĂŞme mieux que personne — qu’il me reste encore beaucoup Ă faire et beaucoup Ă prouver. Mon ancien patron me disait qu’il Ă©tait assez facile de monter sur une vague mais qu’il Ă©tait plus difficile d’y rester. Pour l’instant, je touche du bois, la galerie fonctionne bien, mais c’est dĂ» Ă une important travail. Il faut ĂŞtre conscient que cet Ă©quilibre peut ĂŞtre remis en question Ă tout moment.
Quel est le rĂ´le de ta galerie ?
C’est un lieu qui peut ĂŞtre puissant et qui, de toute façon, est au service des artistes. Elle est lĂ , avant tout, pour les aider Ă rĂ©aliser leurs projets.
En ce moment, elle est là pour servir les intérêts des artistes ?
Tout Ă fait. En France, on aime les galeries qui ont du mal Ă survivre. Cet hĂ©roĂŻ;sme est saluĂ©. Pour notre part, nous avons une galerie qui marche bien et qui — contrairement Ă d’autres confrères — paie ses artistes. Grâce Ă l’argent que nous gagnons, ils peuvent vivre et se consacrer Ă leur art. Nous ne vivons pas des subventions. Nous ne sommes pas une institution mais cela ne nous empĂŞche pas d’avoir une responsabilitĂ© avec les artistes, bien au contraire. Il faut que notre situation financière et Ă©conomique soit saine pour que les artistes puissent en profiter et monter des projets de plus en plus ambitieux. Nous sommes lĂ pour leur emboĂ®ter le pas et les soutenir dans leurs productions. L’enjeu est majeur puisqu’il s’agit de la survie ou non des artistes.
Le revers de la rĂ©ussite, ce sont les reproches qu’elle traĂ®ne dans son sillage ?
Non, encore une fois tout va bien, mais c’est vrai que la rĂ©ussite de la galerie amène son lot de prĂ©jugĂ©s. Elle est bien loin de l’usine Ă fric que l’on peut dĂ©crier. Nous avons du mal Ă sortir de cette image qui n’est pas la nĂ´tre. Les observateurs les plus attentifs caricaturent un peu notre programmation, alors que paradoxalement ils apprĂ©cient nos artistes quand ils sont en dehors de nos murs.
La rĂ©ussite a Ă©tĂ© fulgurante chez toi, comment l’expliques-tu ?
Tout le monde me parle de rĂ©ussite rapide, mais pour en arriver lĂ il a fallu Ă©normĂ©ment travailler. En plus, les artistes que tout le monde considère comme Ă©tant des stars ne l’Ă©taient pas au dĂ©but. A l’Ă©poque, ce n’Ă©tait pas Ă©vident de parier sur eux. Ils n’ont pas toujours Ă©tĂ© ce qu’ils sont, c’est par la suite qu’ils sont devenus incontournables. Je peux t’assurer qu’exposer les travaux de Damien Hirst n’Ă©tait pas simple : prĂ©senter des photos de morgue et de tĂŞtes dĂ©coupĂ©es n’Ă©tait pas synonyme de vente assurĂ©e. C’est vrai qu’avec Mariko Mori, ils ont tout de suite marchĂ© très fort. Mais Ă part eux, la rĂ©ussite des autres a Ă©tĂ© beaucoup plus longue. MĂŞme si certains s’accordent Ă dire que ça a Ă©tĂ© fulgurant, il a fallu les soutenir pendant plusieurs annĂ©es. Avec la plupart de mes artistes je considère que j’ai passĂ© huit annĂ©es difficiles, huit annĂ©es en dents de scie. Le rĂ©sultat actuel n’est pas cousu de fil blanc.
Ta rĂ©ponse n’est pas celui d’un modeste, mais je sens percevoir des craintes, je me trompe ?
MalgrĂ© le bel hĂ´tel particulier du Marais, de 700 m2, nous restons une structure fragile. J’aide les artistes Ă produire leurs œuvres, je suis partie prenante dans leurs interventions, et Ă ce titre, je prends beaucoup de risques financiers. Pour financer ces projets, je ne dispose pas d’un stock Ă©norme non plus. Maintenant, les artistes proposent des œuvres de plus en plus ambitieuses, de plus en plus coĂ»teuses et de plus en plus difficiles Ă vendre immĂ©diatement. Comme nous fonctionnons sans emprunt bancaire, les risques que nous prenons sont consĂ©quents. Je suis très fier de pouvoir mener Ă terme ces rĂ©alisations mais l’Ă©quilibre de la galerie s’en trouve affectĂ©e. Il reste beaucoup de choses Ă amĂ©liorer : il faudrait beaucoup plus de gens afin de rendre un meilleur service aux artistes.
Faudrait-il que la galerie soit encore meilleure pour qu’elle puisse rivaliser avec des pointures internationales ?
La structure de la galerie est encore insuffisante et trop fragile pour qu’elle puisse prĂ©tendre Ă faire jeu Ă©gal avec les mastodontes Ă©trangers. Ce sont mes collègues, mais ils restent nĂ©anmoins des concurrents. Pour arriver Ă ce niveau d’exigence il faut que l’on bosse encore beaucoup. En mĂŞme temps dans le quartier j’aimerais qu’une dynamique se mette en place avec des galeries comme Thaddaeus Ropac et Marian Goodman. Cela pourrait permettre d’asseoir un triangle dans lequel il serait important de passer. A terme, il faudrait devenir la galerie dans laquelle on se doit de ne pas rater la dernière expo. Pour l’instant, nous ne remplissons pas cette mission qui pourrait ĂŞtre la nĂ´tre, mais dans la nouvelle gĂ©nĂ©ration j’en vois certains qui vont de l’avant. Je pense en particulier Ă Kamel Mennour et Ă Loevenbruck. Ces deux lĂ vont très vite nous damer le pion.
Une des qualitĂ©s que l’on peut t’attribuer est celle d’ĂŞtre Ă©nergique, de vouloir faire bouger les choses. Je pense aux vernissages de la rue Louise Weiss et au stand très animĂ© que tu tiens Ă la Fiac chaque annĂ©e. Je me rappelle de cette annĂ©e oĂą tu imprimais des œuvres pour 100 euros.
Contre toute attente, cette opĂ©ration s’est soldĂ©e par une rĂ©ussite. Nous en avons vendues deux mille en deux jours ; Ă 100 euros l’exemplaire, tu peux faire le calcul. Mais Ă l’origine, il aurait Ă©tĂ© plus simple de vendre seulement deux pièces uniques, cela m’aurait rapportĂ© beaucoup plus d’argent. Cette idĂ©e de proposer, Ă un moindre coĂ»t, une œuvre Ă©tait gĂ©nĂ©reuse, mais elle a Ă©tĂ© mal comprise par certains, c’est dommage. La mentalitĂ© française voudrait que l’on fasse profil bas. Je ne suis pas du tout d’accord avec ce type d’attitude. Cette vente de prints Ă©tait l’occasion de montrer Ă tous les professionnels et Ă tous les mĂ©dias qu’il existait en France des acheteurs et des collectionneurs. En vendant des grosses pièces et des Ă©ditions limitĂ©es sur papier, la dĂ©monstration Ă©tait faite qu’il se passait des choses dans l’Hexagone et qu’il y avait vĂ©ritablement un marchĂ© capable de gĂ©nĂ©rer des revenus. Au sein de la sinistrose ambiante, il y avait la place de faire des choses…
Pour vous, les professionnels, le succès public de la Fiac n’est pas forcĂ©ment facile Ă gĂ©rer.
C’est très bien que se mĂ©langent les badauds et les acheteurs. Mais quand les premiers commencent Ă remplacer ceux qui nous font vivre, cela devient complètement absurde. Avec 110 000 visiteurs, ce n’Ă©tait plus possible. Il y avait tellement de monde que les œuvres Ă©taient en danger. Il fallait se battre tout le temps pour les sauvegarder, les protĂ©ger. ÉnormĂ©ment de pièces ont Ă©tĂ© endommagĂ©es Ă cause de cette trop grande frĂ©quentation. Nos galeries sont ouvertes et gratuites toute l’annĂ©e, elles restent quasiment vides la plupart du temps. J’engage les visiteurs Ă venir nous dĂ©couvrir sur toute une saison. La Fiac est, par dĂ©finition, une foire, et nous sommes lĂ pour vendre. Il faut pour cela trouver un Ă©quilibre entre les visiteurs et les acheteurs. Au-delĂ de cette dichotomie, ce phĂ©nomène nous amène Ă savoir pour qui nous travaillons, est-ce pour une poignĂ©e d’Ă©lus ou pour un public plus large ? Mes artistes sont eux-mĂŞmes partagĂ©s: il y a ceux qui se dirigent vers les connaisseurs et les autres qui veulent ĂŞtre visibles au plus grand nombre, et ne pas rester en dehors de la sociĂ©tĂ©.
Murakami — en collaborant avec Louis Vuitton — est emblĂ©matique de cette volontĂ© de rapprocher l’art et la vie. Beaucoup de gens hermĂ©tiques Ă l’art contemporain ne sont pas conscients qu’ils tiennent sous leur bras un sac signĂ© par un artiste mondialement cĂ©lèbre.
Takeshi parvient Ă faire le lien avec le grand public en effet, mais c’est au prix d’un travail de titan qui est Ă mille lieues de la facilitĂ© qu’on lui prĂŞte.
Frize est le seul artiste français prĂ©sent Ă Venise cette annĂ©e, c’est une rĂ©ussite pour la galerie ?
Bernard Frize est prĂ©sent Ă la Biennale de Venise, mais il n’aurait jamais Ă©tĂ© choisi pour ĂŞtre dans le pavillon français car il est chez moi. Ce qui est dommage, outre mon cas personnel, c’est que dans ce genre de manifestation les galeries ne soient pas plus associĂ©es. Il y aurait des synergies formidables Ă crĂ©er. Les artistes et la scène française seraient gagnants Ă l’arrivĂ©e. C’est dommage. J’aimerais beaucoup plus travailler avec les institutions publiques. Les ventes pour l’Ă©tat sont rĂ©duites Ă une portion congrue de mon chiffre d’affaires: cette annĂ©e j’ai rĂ©alisĂ© seulement cinq ventes pour l’institution.
C’est bizarre, j’avais l’impression que tu avais des contacts Ă©troits avec Beaubourg, le MusĂ©e d’Art Moderne et la Fondation Cartier ?
J’ai commencĂ© Ă travailler avec Jean-Michel Othoniel juste avant qu’il ne soit exposĂ© chez Cartier, mais l’expo avait Ă©tĂ© programmĂ©e depuis longtemps. Par contre pour Takeshi Murakami, nous avons assistĂ© Ă un moment de grâce. Il avait Ă©tĂ© approchĂ© pour ĂŞtre commissaire d’exposition et au final, il a montĂ© une exposition de groupe, Coloriage, et a prĂ©sentĂ© une exposition personnelle intitulĂ©e Kawaii ! Vacances d’Ă©tĂ©. Cette opportunitĂ© a Ă©tĂ© une très belle expĂ©rience. Pour la rĂ©trospective de Sophie Calle Ă Beaubourg, je ne peux pas avoir la prĂ©tention de dire que j’y suis pour quelque chose, j’ai juste Ă©tĂ© Ă l’initiative de la rencontre. A aucun moment, je ne peux me flatter ou m’approprier cette exposition. Elle a existĂ© uniquement parce que Sophie Calle est l’une des plus grandes artistes françaises, c’est tout. C’est la mĂŞme chose pour l’exposition de Bernard Frize au MusĂ©e d’art moderne, je n’y suis malheureusement pour rien, car il a Ă©tĂ© contactĂ© directement.
Bizarrement, les choses se goupillent bien entre ces expositions institutionnelles et les vernissages Ă la galerie ?
Quand ce genre d’Ă©vĂ©nement arrive, il est Ă©vident que je convaincs les artistes d’attendre un peu. Je leur explique qu’il est prĂ©fĂ©rable d’avoir les deux expos en mĂŞme temps, cela provoque une synergie incroyable. Parfois, je ne suis pas entendu ; par exemple, je ne suis pas parvenu Ă convaincre Xavier Veilhan d’attendre un peu lorsqu’il a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© Ă Beaubourg.
MalgrĂ© les succès tu sembles ĂŞtre encore le vilain petit canard de l’art contemporain.
Les choses changent doucement, mais j’espère très prochainement prouver que je ne suis pas le jeune homme arrogant que l’on dĂ©crit. J’espère pouvoir m’imposer comme quelqu’un avec qui il faut compter, avec qui il faut travailler. J’espère prouver ça au monde mĂ©diatique et institutionnel. J’aimerais pouvoir travailler beaucoup plus avec les institutions. Pour l’instant, mes artistes sont invitĂ©s, mais encore une fois je n’y suis pour rien. J’aimerais que cela change. J’aimerais initier des projets, proposer des partenariats, des rencontres. Jennifer Flay jouait ce rĂ´le moteur il y a encore peu de temps. Internationalement, ce type de dĂ©marche serait porteuse. Pour l’instant, je ne vois que Chantal Croussel qui soit parvenue Ă travailler d’une manière satisfaisante avec les institutions.
Tu dĂ©bauches les artistes pour qu’ils viennent chez toi ?
Non, pas du tout. Sophie Calle Ă©tait depuis longtemps sur le marchĂ© avant qu’elle ne vienne, Jean-Michel Othoniel Ă©tait sans galerie depuis sept ans, Bernard Frize Ă©tait lui aussi libre, Patrick Tosani Ă©tait son meilleur ami et on savait tous que Durand-Dessert allait arrĂŞter prochainement. Non, je n’ai jamais dĂ©bauchĂ© d’artiste, par contre j’en ai perdus. Beaucoup de mes premiers artistes ne sont pas restĂ©s et ont Ă©tĂ© absorbĂ©s par d’autres. A l’Ă©poque je ne pouvais pas leur proposer les services d’un galeriste classique, je dĂ©butais et j’essuyais les plâtres. J’en ai perdu plein : Pierrick Sorin, Philippe Parreno, Pierre Joseph, Dominique Gonzalez-Foerster… J’aurais pu avoir plus d’artistes de ma gĂ©nĂ©ration s’ils avaient Ă©tĂ© plus patients.
Quel est ton rĂ´le dans la rĂ©alisation des œuvres? Viens-tu te substituer aux artistes ? Je pense Ă Vingt ans Après (2001), la pièce qui faisait Ă©cho Ă la Filature de Sophie Calle rĂ©alisĂ©e en 1981.
Il y a peu d’artistes que tu peux aider directement. Les peintres sont confrontĂ©s Ă leur solitude, Ă leur travail d’atelier. A l’inverse, tu peux contribuer Ă aider ceux qui montent des projets.
Comment as-tu commencé à travailler avec Sophie Calle ?
Le plus simplement du monde, j’ai lu que la Filature avait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e le 16 avril 1981. Elle avait engagĂ© — par l’entremise de sa mère — un dĂ©tective privĂ©e pour la suivre une journĂ©e. Je me suis dis qu’il Ă©tait possible de faire la mĂŞme œuvre vingt ans après. Quelques jours avant la date fatidique, je lui ai tĂ©lĂ©phonĂ© pour lui dire que j’avais engagĂ© le mĂŞme privĂ© pour la suivre. Elle devait partir en Espagne et cela posait des problèmes matĂ©riels pour la filature, je lui ai demandĂ© de retarder son dĂ©part. La prĂ©venir ne posait pas de problème car dans la première mouture elle Ă©tait au courant de la prĂ©sence de son suiveur. Elle accepte la proposition tout en me mettant en garde, si dans la journĂ©e il ne se passe rien, l’œuvre ne pourra pas se faire. Elle prend note du dispositif et organise sa journĂ©e en consĂ©quence. Plus tard, elle me rappele en m’invitant au restaurant le jour J. C’est durant ce dĂ©jeuner, que nous saviant Ă©piĂ©s, elle a dĂ©cidĂ© de rejoindre la galerie. C’Ă©tait une rĂ©ussite car Ă l’Ă©poque elle Ă©tait sollicitĂ© par les plus grandes galeries, et ce n’Ă©tait pas une mince affaire que de la faire venir. Vingt ans après est une pièce chère Ă mon cœur, car avec des amis nous avions dĂ©cidĂ©s, quand nous Ă©tions adolescents, de nous poster Ă la terrasse du cafĂ© de Saint-Sulpice, Ă l’endroit mĂŞme oĂą Perec, vingt ans plus tĂ´t, avait dĂ©crit la place dans Je me souviens.
La galerie n’a pas assez de succès critique Ă ton goĂ»t ?
Je suis peut-ĂŞtre parano mais j’ai toujours le sentiment de ne pas intĂ©resser la presse spĂ©cialisĂ©e. Les premiers Ă me faire part de leurs Ă©tonnement sont les artistes Ă©trangers. Ils ne comprennent pas cette absence d’articles de fond sur les expositions. Dans les autres pays, il y a beaucoup plus d’Ă©chos. Mes artistes ont beau ĂŞtre estimĂ©s, j’ai l’impression que le fait d’exposer chez moi les met Ă l’index. Heureusement, aujourd’hui, les choses changent et je travaille de plus en plus avec les critiques, je prends le temps de leur parler pour casser l’image nĂ©gative qu’ils peuvent avoir de la galerie. L’incomprĂ©hension est en train de s’estomper et je pense que très prochainement les choses vont aller de l’avant. Le prochain challenge de la galerie sera d’obtenir des bonnes critiques pour les expos. Je ne parle pas ici des artistes qui sont bien traitĂ©s par les mĂ©dias, non, je parle de la perception qu’ont certains mĂ©dias français de notre galerie.
Certains artistes de tes artistes sont classés entertainement, ça te dérange ?
On a souvent cataloguĂ© la galerie, elle a Ă©tĂ© taxĂ©e de galerie du sexe, d’ĂŞtre une succursale manga Ă cause des artistes japonais que je reprĂ©sente comme Murakami. Mes goĂ»ts artistiques sont Ă©clectiques, j’apprĂ©cie autant les artistes jouisseurs que ceux qui proposent des formes moins accessibles. Les premiers paraissent moins intellos que les seconds, et alors ? Ce qu’ils font est peut-ĂŞtre beaucoup plus difficile ? Je suis contre la prime Ă l’austĂ©ritĂ©. Il est très facile d’accorder de l’importance et de la critique au pathos. ApprĂ©hender ces artistes sous l’angle de l’entertainement est Ă la fois pĂ©joratif et incorrect. L’imagerie enfantine qu’ils investissent n’est pas moins importante que d’autres formes artistiques. Ensuite, il ne faut pas s’arrĂŞter sur les apparences. J’entends très peu de personnes me parler de la noirceur qui colle Ă cette peinture rose bonbon. En arrière fond, il y a un contexte social brossĂ© Ă l’acide. Aya Takano nous explique le rĂ´le de la femme japonaise dans cette sociĂ©tĂ© hyper-machiste qui est la sienne. C’est dommage que cette imagerie occulte toute cette part d’ombre. Les œuvres de Mr. sont très dĂ©rangeantes, il aborde la pĂ©dophilie d’une manière que l’on a pas encore très bien sous-pesĂ©e.
J’ai l’impression que dans ta situation tu ne cherches pas de très jeunes artistes, tu te concentres beaucoup plus sur des personnes qui promettent, je pense par exemple Ă Piotr Uklanski.
Pourquoi devrais-je me priver de miser sur eux ? Pourquoi devrais-je m’interdire de travailler avec des artistes qui sont dĂ©jĂ lancĂ©s ? Si je n’avais pas pris Piotr, cela aurait Ă©tĂ© une erreur grave. Il est sur une voie royale pour ĂŞtre mon prochain Cattelan. C’est clair. C’est en train d’arriver, cela fait trois ans que l’on travaille pour ça. Pour une fois, on est arrivĂ© avec lui Ă avoir un retour presse. Le Figaro (pas encore), LibĂ©ration et Le Monde lui ont consacrĂ© des articles de fond et c’est Ă cela que tu t’aperçois que les choses changent. Avec les premiers artistes j’ai pu amener un travail en profondeur. Les collaborations du dĂ©but ont pu sceller des projets Ă long terme. Maintenant, je travaille avec des artistes qui ont dĂ©jĂ une expĂ©rience, mon rĂ´le n’est plus le mĂŞme. Avec Bernard Frize ou Sophie Calle, je peux seulement espĂ©rer que les gens verront la diffĂ©rence entre avant moi et après moi.
J’ai l’impression que tu prends moins des jeunes pousses.
La meilleure rĂ©ponse que je puisse apporter est la nouvelle programmation de 2005-2006. J’ai un programme prĂ©sentant cinq premières expositions personnelles en France. Je vais montrer majoritairement des gens inconnus.
Quels sont les projets de la galerie ?
Pour l’instant, je pense beaucoup Ă l’espace de Miami. Le chantier de rĂ©novation aura durĂ© un an et nous allons ouvrir le lieu en dĂ©cembre 2005. L’inauguration se fera avec une expo rĂ©unissant Uklanski, Frize et un artiste local, Martin Oppel.
Tu vas te servir de cette place pour promouvoir l’art français aux États-Unis ?
Évidemment, mais je ne suis pas bĂŞte, je ne vais pas aller trop vite avec une programmation franco-française, je vais opĂ©rer par touches. J’ai très envie de me servir de ce nouvel espace pour contribuer Ă Ă©tablir la scène française Ă l’Ă©tranger. C’est très important. Cette double implantation passe par un projet Ă©ditorial qui pourrait couvrir les deux espaces. Il faut inventer un support qui pourrait faire la promotion des deux cĂ´tĂ©s de l’Atlantique.
A part le rêve américain, as-tu des projets pour Paris ?
Le chantier de Miami me tient particulièrement Ă cœur, mais je veux aussi renforcer notre assise parisienne dans le Marais. Nous sommes juste Ă cĂ´tĂ© de la rue Saint-Claude et elle va bientĂ´t devenir incontournable, de nombreuses galeries s’y installent. Les galeries Polaris, Frank et Anne Barault y sont depuis plus longtemps mais elles vont en accueillir de nouvelles. Le nord du Marais est en train de se rĂ©veiller. J’espère fĂ©dĂ©rer autour de nous une Ă©nergie constructive. Cela se traduit par des dates communes pour le vernissage qui aura lieu le 10 septembre.



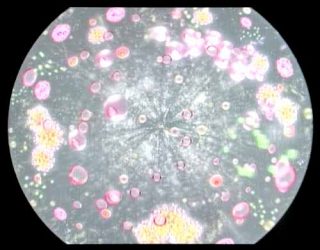

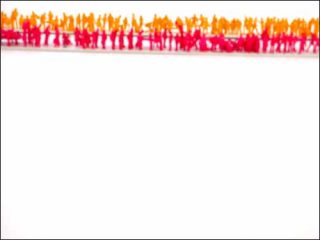
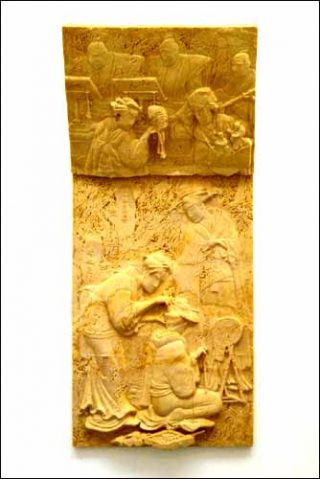
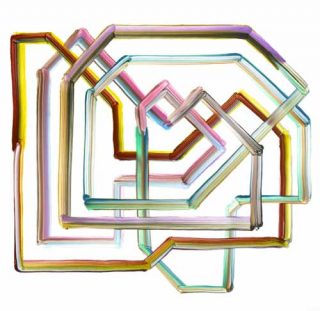
 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram