Elisa Fedeli. Pourquoi la problûˋmatique de l’image n’a-t-elle pas fait l’objet d’une discipline û part entiû´re jusqu’û prûˋsent? Comment les premiers philosophes et les premiers historiens de l’art envisageaient-ils l’image? Pourquoi, selon vous, leur approche est-elle insuffisante?
Emmanuel Alloa. L’image en tant qu’image n’a jamais constituûˋ un champ d’investigation en tant que tel, pour plusieurs raisons d’ordre thûˋorique et historique.
La premiû´re est qu’on a souvent considûˋrûˋ la seule image artistique. C’est le cas en histoire de l’art, oû¿ il semble tellement convenu qu’on parle d’images alors qu’en rûˋalitûˋ on n’en ûˋtudie qu’un pan. Par consûˋquent, la discipline a mis sous scellûˋs ce rûˋservoir infini que sont les images non artistiques: les images du quotidien, de la publicitûˋ, de propagande, les images d’usage comme l’imagerie scientifique. Mûˆme l’iconologie d’Erwin Panofsky demeure profondûˋment ambivalente, car si elle veut s’affranchir du cadre du Grand Art (Panofsky ira jusqu’û analyser la forme du radiateur des Rolls Royce), elle subordonne toujours l’œuvre au hors l’œuvre et explique l’image par un prûˋ-texte textuel qui en fournit les clûˋs (d’oû¿ l’insistance sur le logos dans l’iconologie).
Deuxiû´mement, si la philosophie ne se limite pas û traiter les images artistiques, mais s’interroge sur les images et les reprûˋsentations en gûˋnûˋral, la question de l’image en tant qu’image a ûˋtûˋ ûˋludûˋe une fois de plus. Autant on a vu l’ûˋmergence d’une philosophie spûˋcifique de l’art ou du langage, il n’y a pas û ce jour de philosophie de l’image. Au contraire, si la question de l’image est une des plus anciennes de la philosophie, les philosophes n’ont en gûˋnûˋral thûˋorisûˋ l’image que pour mieux s’en dûˋbarrasser. Platon n’est pas tant celui qui a banni l’art de la citûˋ, comme on aime û se le rûˋpûˋter, que celui qui a neutralisûˋ la force provocatrice de l’image en lui donnant une fonction prûˋcise au sein de sa hiûˋrarchie ontologique, la contraignant û marquer û tout jamais l’ûˋcart indûˋfectible entre l’idûˋe et le sensible.
Dans cette perspective, on peut affirmer que la question de l’image et de son efficace aura ûˋtûˋ systûˋmatiquement ûˋludûˋe.
Votre ouvrage rassemble des interventions de philosophes et d’historiens de l’art. Qu’apporte-il par rapport û cet hûˋritage?
Emmanuel Alloa. Notre ouvrage veut relayer la vivacitûˋ des dûˋbats qui ont eu lieu ces derniû´res annûˋes autour de l’image. Toutefois, ceux-ci s’inscrivent dans une certaine filiation qui remonte au dûˋbut du XXe siû´cle et que nous pouvons retracer rapidement ici.
Pour Aby Warburg, les images seront le vecteur qui permet de fonder les sciences de la culture. Au mûˆme moment, Freud a mis en ûˋvidence la logique propre aux images, leur puissance de condensation. Paul Valûˋry, les surrûˋalistes, Bachelard, Merleau-Ponty ont travaillûˋ chacun û leur faûÏon sur la puissance irrûˋductible des images.
Les annûˋes 1960 sont marquûˋes, quant û elles, par une passion deleuzienne, foucaldienne et klossowskienne pour les simulacres, ces images qui ruinent l’alternative entre l’original et la copie.
Dans les annûˋes 1980, la nouvelle attention pour les technologies entraûÛne un intûˋrûˆt pour l’image virtuelle et sa circulation, tandis qu’au croisement du structuralisme, de la psychanalyse et de l’anthropologie se met en place cette constellation de pensûˋe franûÏaise si particuliû´re, de Louis Marin, d’Hubert Damisch û Georges Didi-Huberman.
Si le livre doit beaucoup û ces auteurs, un de ses enjeux est de tûˋmoigner de deux autres traditions qui se sont dûˋveloppûˋes durant les annûˋes 1990: les ô¨Visual Studiesô£ amûˋricaines et les ô¨Bildwissenschaftenô£ allemandes. Les ô¨Visual Studiesô£ ouvrent le champ des images en direction d’une culture visuelle. Tom Mitchell, qui en est l’instigateur, a lancûˋ la formule du ô¨tournant picturalô£ pour dûˋcrire un changement de paradigme caractûˋristique de notre ûˋpoque. Ses travaux sont enfin traduits, avec vingt ans de retard. Parmi les ô¨Bildwissenschaftenô£, on peut nommer Hans Belting et Horst Bredekamp, dûˋjû en partie connus en France, mais aussi Gottfried Boehm dont la thûˋorisation d’un ô¨tournant iconiqueô£ en 1994 fut dûˋcisive pour le dûˋveloppement des dûˋbats en Allemagne.
Quelles sont les positions respectives de ces deux ûˋcoles?
Emmanuel Alloa. Mitchell insiste sur la dimension relationnelle des images, dont celles-ci tirent leur force. Pour lui, une image n’est pas isolûˋe et doit ûˆtre saisie dans son contexte historique, culturel et social.
Pour Gottfried Boehm, le risque d’une contextualisation excessive risque de relativiser une fois de plus la capacitûˋ intrinsû´que des images û gûˋnûˋrer du sens par elles-mûˆmes.
Et vous, quelle est votre position û ce sujet?
Emmanuel Alloa. Pour moi, les deux auteurs ont le mûˋrite d’ouvrir un dûˋbat qui n’est pas prûˆt de se clore avant un bon moment, je l’espû´re. Mais si je comprends tout l’intûˋrûˆt d’une rûˋflexion sur les ô¨logiquesô£ immanentes de l’image, il faut toujours s’assurer de ne pas s’enfermer dans un nouvel essentialisme. Selon moi, l’image est avant tout saisissable dans ses effets et devrait ûˆtre pensûˋe dans ses rapports avec le spectateur. L’image n’est pas tout û fait en nous, elle ô¨erreô£ comme disait si bien Blanchot. Elle est ce qui exige que nous changions de place. Elle ne tire sa force que d’une puissance que nous lui prûˆtons. Il faudrait traiter û la fois son autonomie et sa dûˋpendance vis-û -vis du spectateur.
L’apparition des technologies (le photocopieur, l’informatique, etc.) a permis la reproduction accûˋlûˋrûˋe des images et leur circulation intangible. Ces phûˋnomû´nes ont-ils modifiûˋ notre rapport û l’image?
Emmanuel Alloa. Les images prennent des proportions de plus en plus importantes dans notre vie. De jour en jour, s’accroit la place qu’elles occupent dans nos journaux, dans l’espace de la citûˋ, dans les pratiques des sciences, dans les prises de dûˋcision ûˋconomiques, etc. Mais en contrepartie de cette sur-stimulation, nous devenons plus expûˋrimentûˋs et en comprenons mieux les ressorts. Une des raisons, et non des moindres, est que nous ne sommes pas de simples consommateurs d’images, mais devenons souvent, par la dûˋmocratisation des technologies, des producteurs d’images. On est loin de la situation de l’artiste de la Renaissance italienne, oû¿ le nombre de producteurs d’images ûˋtait rûˋglûˋ par l’acceptation dans la corporation des peintres.
Aujourd’hui, il y a une dûˋferlante de producteurs amateurs. Cela change ûˋvidemment notre rapport aux images. Notre libertûˋ est bien plus grande que celle du spectateur illettrûˋ auquel on raconte l’histoire sacrûˋe par la peinture. Mais si nous rûˋalisons de mieux en mieux que les images sont mouvantes et migrent de support en support, nous ne pûˋnûˋtrons toujours pas les arcanes de leur commerce occulte. Si nous ne pouvons difficilement nous abstenir des images, tout l’essentiel est de ne pas se laisser tenir par elles.
Quels sont les artistes contemporains qui traitent de cette problûˋmatique et sous quelles formes?
Emmanuel Alloa. Les images se sont toujours rapportûˋes û d’autres images. Par le passûˋ, les artistes devaient tenir compte de restrictions dans les thû´mes qu’ils voulaient aborder et obûˋir û l’impûˋratif de la reconnaissance des sujets reprûˋsentûˋs.
A cela, l’art minimal a rûˋagi en rûˋduisant l’œuvre û l’exposition de sa matûˋrialitûˋ nue.
Aujourd’hui, on observe comment l’autorûˋflexion des images passe moins par un retour û une matiû´re immuable qu’û sa texture, vouûˋe û migrer û travers les supports. L’usage d’une peinture ûˋtrangement pixelisûˋe, comme chez Chuck Close, en est le dernier avatar. D’une faûÏon gûˋnûˋrale, l’autorûˋflexion de l’image est moins un retour sur soi qu’une mise en scû´ne de la pluralitûˋ intrinsû´que des images. Il suffit de regarder la place que prennent les pratiques hybrides de recroisement des supports, l’installation, le montage et l’usage de l’archive. Derriû´re l’image, non pas un monde, mais une infinitûˋ d’autres images.
On peut invoquer les derniû´res sûˋries photographiques de Thomas Ruff qui utilise des archives amateur, prises avec des tûˋlûˋphones portables, ou encore Film Socialisme de Jean-Luc Godard qui ne se prive pas d’insûˋrer des sûˋquences prises sur Youtube dans la trame de son rûˋcit narratif.
Dans ce jeu de citation, l’image ne se rûˋfû´re plus û un rûˋfûˋrent, mais û une autre image. Les images entretiennent entre elles des rapports de contamination, d’hybridation, de dissociation. ûtudier ces liens, qui nous ûˋchappent encore, constitue le dûˋbut d’une science de l’image.
Dans son essai, Hans Belting ûˋtudie l’image telle qu’elle est pensûˋe dans le monde musulman et choisit le moucharabieh comme forme symbolique. Ne pense-t-on pas l’image en Orient comme on la pense en Occident?
Emmanuel Alloa. L’image circule par-delû les frontiû´res plus vite que toute parole — d’oû¿ tous les espoirs qui furent de tout temps liûˋes û un langage universel des images, sorte d’esperanto de pictogrammes. Mais bien souvent, une telle langue en dit plus sur la culture dont proviennent ses inventeurs.
Toutefois, il existe des cultures de l’image qui ne sont pas neutres ni aussi globalisûˋes qu’on aimerait nous le faire croire. Je reviens tout juste d’un pays arabe, oû¿ les journalistes m’expliquent qu’il est beaucoup plus facile de dire et d’ûˋcrire des choses dûˋrangeantes, que de les montrer en images et en caricatures. La puissance de l’image est bien plus contestûˋe dans les pays marquûˋs par une tradition ornementale.
Cependant, l’image hyperrûˋaliste, indexicale, existe aussi dans les pays musulmans: comment expliquer la banalitûˋ de la violence que prûˋsentent les chaûÛnes du Golfe, quand elles donnent û voir sans censure les corps dûˋchiquetûˋs des martyrs? ll y a lû une ambivalence sur laquelle il faut rûˋflûˋchir et qui ne se rûˋsume certainement pas û une simple opposition entre une culture occidentale avide d’images et une culture orientale prûˋtendument iconoclaste.
Malgrûˋ la mondialisation, on observe aujourd’hui l’ûˋmergence de nouvelles cultures d’images. Il est passionnant de voir pourquoi le cinûˋma hollywoodien ne prend pas en Inde. En revanche, le cinûˋma de Bollywood est loin d’ûˆtre fermûˋ sur soi. Mais il reprend un imaginaire inversûˋ qui ne retient de l’Occident que certains clichûˋs fort ûˋtonnants. Tout film bollywoodien qui se respecte se doit d’inclure une scû´ne tournûˋe sur un alpage suisse. Cet imaginaire renvoie û une tradition qui existait dûˋjû au XIXe siû´cle, notamment dans des gravures reprûˋsentant le dieu Krishna et ses Gopis au bord du Lac Lûˋman. Les transferts d’images ne sont donc pas forcûˋment unidirectionnels, comme nous avons tendance û le penser, et nous obligent û repenser autrement le rapport entre les cultures.
REFERENCES
Penser l’image, ûˋd. Emmanuel Alloa, Presses du rûˋel, coll. ô¨Perceptionsô£, Dijon, 2010.

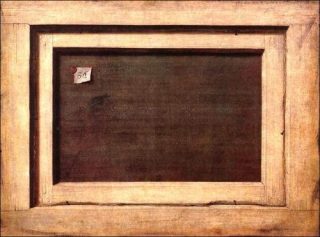

 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram