Lauréate du 61e salon de Montrouge, nous avions découvert le travail d’Anne-Charlotte Finel lors de la dernière Biennale de Lyon, où était diffusée la vidéo Entre chien et loup, ainsi qu’au 6b de Saint-Denis avec La Crue, que l’on retrouve d’ailleurs au cœur du parcours que lui consacre la galerie Edouard Manet de Gennevilliers.
Une immersion glaciale
Ces deux réalisations révèlent ainsi la «patte» de l’artiste, à savoir des images au grain affirmé, enregistrées à l’aube ou au crépuscule, faisant la part belle à l’eau et aux fluides. L’exposition «Eclaireur» se construit autour de ces leitmotivs, et nous immerge dans un univers bleu, froid, crypté et granuleux, où retentissent d’assourdissantes nappes de synthétiseur, auxquelles semblent se mêler subrepticement un larsen ou un filet de chorale. La surface de l’eau offre tout un panel de textures, tantôt liquide, tantôt écaillée, neigeuse ou opaque, selon l’éclairage et la qualité du grain que l’artiste lui prêtera.
Les vidéos tournant en boucle, les paysages suspendus entre jour et nuit, la répétition des motifs liquides, les entrelacs de sons, tous ces éléments redondants fonctionnent sur le principe de la perméabilité, et semblent participer à un rituel occulte ou à une inquiétante procession. En effet, la salle principale de l’exposition met en regard différentes boucles dont les couleurs se répondent, dont les intensités lumineuses se confondent, et dont les bandes-son réalisées par Luc Kheradmand se superposent, se noient les unes dans les autres, et finissent même par nous glacer.
Cargos de nuit
Entre inertie et mouvement répétitifs (chutes d’eau, cascades, sillons d’écume, ondulation des flots…), les bateaux et les cargos stationnent sur la mer comme des navires fantômes, des carcasses de ferraille évidées, ou nous embarquent dans une traversée des océans. Plutôt que de pouvoir assurer notre position sur les routes maritimes, nous dérivons vers un étrange état d’hypnose, quelque part entre conscience et inconscience, ce que semble d’ailleurs attester l’omniprésence de l’eau, élément onirique par excellence. La musique, quant à elle, pourrait finalement sonner comme le brouhaha d’une salle des machines, dont la mécanique résonnerait dans les fonds obscurs d’une cale rouillée.
La Verte-Planétarium et Planétarium nous introduisent dans un univers en couleurs plus expérimental, à l’instar des shows psychédéliques des années 1970, et diffusent des gros plans comme si l’on regardait à travers une loupe (un télescope), ou que l’on voyait défiler vertigineusement les flots à travers le hublot d’un paquebot. La lumière et la matière vibrent, comme une boule d’énergie qui se condenserait en cherchant à prendre corps et à se solidifier.
No man’s land
L’ensemble n’en constitue pas moins des paysages obscurs et désincarnés dont les contours et la localisation nous échappent. Cet état d’indétermination peut créer une sorte de malaise. L’absence flagrante d’humains nous jette dans les limbes d’une civilisation engloutie, vidée de toute substance, dont on ne percevrait plus que des reliques, des machines, des bunkers, ou des bâtiments bruts, inhabités.
Les paysages, contemplatifs et muets, nous mettent face à une sorte de no man’s land désespéré. S’agit-il d’une ode à la mélancolie ou à la grande dépression? Ou s’agit-il de constater, de manière froide et dépassionnée, que l’on évolue aujourd’hui dans un univers post-industriel nihiliste, déshumanisé? Une lueur ou un phare, toutefois, brillent péniblement dans la pénombre ambiante ou percent la brume qui accable les cotes. Les téléviseurs se brouillent, les images interfèrent: les oiseaux volent bas, un ciel crépusculaire s’écroule dans une flaque d’eau.
On se retrouve aspiré vers le grand vide, comme dans cet abîme concentrique et hypnotique qui conclue La Crue. Ici, la palpitation des flots et la vibration des ondes sonores s’épousent parfaitement, et les abysses dessinent la membrane d’un haut-parleur – à moins que ce ne soient les anneaux des enfers de Dante prêts à nous entraîner dans une chute sans fond.

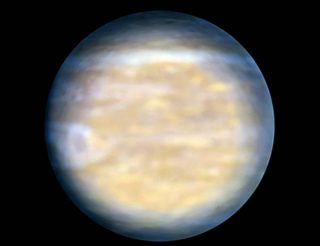



 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram