Propos recueillis par Pierre-テ益ariste Douaire
Traduction de l窶兮nglais : Betty Dahmers et Julien Pain
Photographie : Quentin Douaire
Pierre-テ益ariste Douaire. Votre pavillon Mannerism/Rococo, exposテゥ en ce moment テ la galerie Marian Goodman, est-il un hommage テ Bruce Nauman?
Dan Graham. Manierism/Roccoco n窶册st pas un hommage テ Nauman. Notre modティle テ tous les deux reste Dan Flavin.
Mannerism/Rococo ne serait-il pas mieux テ l窶册xtテゥrieur?
Mannerism/Rococo a テゥtテゥ pensテゥ pour テェtre exposテゥ prティs du nouveau tramway parisien. Nテゥanmoins je pensais qu窶冓l aurait sa place テ l窶冓ntテゥrieur d窶冰ne galerie, mテェme si effectivement il donne le meilleur de lui-mテェme テ l窶册xtテゥrieur.
Que recommandez-vous テ un spectateur ? D窶兮ller en galerie ou d窶兮ller admirer vos pavillons en extテゥrieur?
Le problティme avec mon travail c窶册st qu窶冓l ne se vend jamais. J窶兮i souvent eu des piティces refusテゥes dans des expositions faute d窶兮rgent. Les rテゥalisations ont souvent butテゥ sur cet aspect financier, mais vous pouvez trouver mes ナ砥vres aux quatre coins du monde. Il y en a une trentaine qui sont dissテゥminテゥes dans autant de pays. Je vous encourage テ aller les voir. En tant qu窶兮rtiste, il est important de rester visible. Se montrer, exposer est le meilleur moyen pour continuer テ avancer et テ aller de l窶兮vant. Je suis trティs peu visible テ New York car je n窶凉 suis pas apprテゥciテゥ. Le passage en galerie donne accティs par la suite テ des rテゥalisations en plein air. Ce que j窶兮ime dans la galerie Marian Goodman, c窶册st qu窶册lle n窶册st pas une boutique, contrairement aux autres galeries parisiennes.
Vous テェtes テ Paris pour quelques jours, テェtes-vous allテゥ テ la Porte de Versailles regarder votre dernier pavillon From Boullテゥe to Eternity?
Hier en allant m窶凉 balader j窶兮i テゥtテゥ content de voir que la place vivait. Beaucoup de gens se pressait sur le parvis. Chacun prenait des photos. Les familles s窶兮ttardaient et les enfants jouaient テ l窶冓ntテゥrieur du pavillon. C窶册st avec テゥtonnement que j窶兮i constatテゥ qu窶冰n grand nombre de touristes composaient la foule. Ordinairement on les retrouve plus du cテエtテゥ de la Tour Eiffel ou de Notre Dame. Il テゥtait midi et le rテゥsultat me plaisait. Cet hiver, lors de l窶冓nauguration du tramway, la buテゥe sur les parois vitrテゥes gテェnait le jeux des transparences.
Vous aimez que vos ナ砥vres reflティtent les changements climatiques et temporels.
Je vous recommande un trティs bon livre de T.J. Clark sur l窶卩砥vre de Nicolas Poussin, The Sight of Death. Il s窶兮ttarde sur la temporalitテゥ de son ナ砥vre, il s窶兮ttache テ dテゥcrire des instants particuliers. Mon pavillon rend compte de ces changements climatiques et des heures qui passent. Au couchテゥ du soleil il se transforme.
Quand est nテゥe l窶冓dテゥe de From Boullテゥe to Eternity?
C窶册st en 1988 que l窶冓dテゥe de ce pavillon m窶册st venue. Je travaillais テ la fois sur le parc de la Villette, et sur le Children窶冱 Pavillion avec Jeff Wall. C窶册st en voyant les enfants jouer sur la butte du terrain vague , qui allait devenir le cinテゥma de la Gテゥode, que j窶兮i pensテゥ テ Boullテゥe et テ Ledoux, deux architectes utopistes franテァais du XIXe siティcle.
Comment avez-vous abordテゥ ce chantier?
J窶兮i dessinテゥ deux projets mais celui qui avait ma prテゥfテゥrence n窶兮 pas テゥtテゥ retenu. Il prテゥsentait l窶冓nconvテゥnient d窶凖ェtre trop テゥtroit. Sa forme en entonnoir interdisait les mouvements de foule. Il contraignait la circulation et imposait un passage au compte goutte. Une seule personne pouvait y accテゥder. Chacun avait peur des consテゥquences, nous apprテゥhendions tous qu窶冓l soit cassテゥ. Mテェme excentrテゥ sur le parvis, il reste au milieu du passage. Il est situテゥ entre le parc des expositions, la station de tramway et la sortie de mテゥtro.
Avez-vous conテァu votre ナ砥vre en fonction des dテゥtテゥriorations qu窶册lle pourrait subir? du vandalisme dont elle pourrait souffrir?
Les graffitis, les griffures ne m窶册ffraient pas du tout. Par contre prendre le risque de voir disparaテョtre mon travail m窶册st insupportable. En Belgique j窶兮i beaucoup souffert de la destruction complティte d窶冰n pavillon. L窶冓nstallation a テゥtテゥ littテゥralement rasテゥe car son implantation a テゥtテゥ prテゥcipitテゥe. Les habitants n窶凖ゥtaient pas prテゥparテゥs テ la recevoir. Le quartier de la place Saint-Jean テ Anvers テゥtait テ l窶凖ゥpoque trop populaire. Encore quelques annテゥes et l窶兮cceptation de telles initiatives ne posera plus de problティmes. Le quartier va mテェme devenir branchテゥ.
Comment avez-vous pris en compte le contexte de la ville?
J窶兮vais dテゥjテ prテゥparテゥ les croquis avant de dテゥcouvrir le lieu. J窶兮vais cependant compris que la porte de Versailles テゥtait un lieu ouvert. Deux テゥlテゥments essentiels pour moi テゥtaient prテゥsents: d窶冰ne part la vue テゥtait dテゥgagテゥe テ 360ツー, et de l窶兮utre on pouvait voir les gens circuler.
Vous avez changテゥ vos plans en dテゥcouvrant le lieu?
Trティs lテゥgティrement. Initialement le pavillon devait comporter un toit. Je voulais crテゥer une salle d窶兮ttente. J窶凖ゥprouve toujours le besoin de concevoir des lieux utilitaires, mais le toit avait l窶冓nconvテゥnient de donner prise au vandalisme.
C窶册st important pour vous de travailler in situ ?
Je pars toujours du site, je travaille toujours テ partir de lui.
La porte de Versailles est une frontiティre sociale. C窶册st une ligne de dテゥmarcation qui tourne le dos テ la banlieue. Avez-vous pris en compte cet aspect ?
J窶兮i comme souvenir que la Fiac y avait ses quartiers, qu窶册lle y drainait le tout Paris, qu窶册lle テゥtait un テョlot au bout de la ville.
Mais depuis cette annテゥe la Fiac a regagnテゥ les ors du Grand Palais.
Le Grand Palais est un endroit テゥpouvantable oテケ il est impossible de respirer. Ce grand hall est la rテゥsurgence d窶冰n modティle inventテゥ et abandonnテゥ depuis le XIXe siティcle. C窶册st un lieu d窶册xposition datテゥ qui remonte テ l窶凖ゥpoque oテケ Paris テゥtait la capitale mondiale des arts. Aujourd窶冑ui c窶册st un attrape touristes, une curiositテゥ obsolティte. Pour trouver la modernitテゥ il faut se dテゥplacer aux portes de la capitale, c窶册st lテ-bas qu窶冓l faut faire de l窶兮rt.
Le cordon vert du tramway limite l窶兮ccティs des voitures au centre de Paris ?
Non, le tramway trace un nouvel axe pour Paris. C窶册st un moyen de transport bon marchテゥ, qui permet aux personnes テ「gテゥes et aux classes populaires de se dテゥplacer facilement autour de la capitale. Mais contrairement aux problティmes que vous soulevez, je suis content de venir dans le Paris moderne, celui qui s窶凖ゥloigne des images de cartes postales. Malgrテゥ toutes vos remarques je continue テ penser que le tramway, par son infrastructure, dテゥveloppe et favorise les transports entre la capitale et sa pテゥriphテゥrie. Dans sa conception et sa logique il est profitable au plus grand nombre.
Je continue pourtant テ penser que les portes de Paris sont devenues des forteresses テゥcologiques, sociales, テゥconomiques.
En 1970, New York テゥtait une ville trティs dangereuse et trティs violente. Pour le coup elle avait tout d窶冰ne forteresse. A la place de murailles elle avait adoptテゥ un systティme de tours-bureaux pour se dテゥfendre: les Atrium Buildings.
Dans un de mes articles, Corporate Atrium, j窶冓nterrogeais ces nouvelles constructions. Au dテゥbut des annテゥes 1980, la gテゥnテゥralisation de ces bテ「timents aux vitres sans tain n窶凖ゥtait pas sans テゥquivoques. Tours-miroirs, elles interdisaient au regard de pテゥnテゥtrer テ l窶冓ntテゥrieur des bテ「timents. Tours-miroirs, elles reflテゥtaient l窶册nvironnement extテゥrieur. Les cols blancs テゥtaient abritテゥs derriティre ces murs vitrテゥs, ils pouvaient voir sans テェtre vus. Le piテゥton n窶兮vait pas cette chance. Reflet pour les uns, transparence pour les autres.
Mais voyez-vous, mテェme si le siティge du pouvoir テゥconomique テゥtait protテゥgテゥ du regard de la rue, et mテェme s窶冓l occupait une position dominante, les parois rテゥflテゥchissantes prテゥsentaient aussi des avantages テゥcologiques. Elles permettaient des テゥconomies d窶凖ゥchelles. En rテゥverbテゥrant les rayons du soleil les tours テゥtaient moins chaudes que les constructions classiques. Les Atrium Buildings dテゥpendaient moins des systティmes de refroidissement, de climatisation que les autres immeubles. C窶册st テ cette テゥpoque les panneaux solaires ont fleuri sur les toits de New York. Cette qualitテゥ environnementale テゥtait aussi une des particularitテゥs de ces nouvelles tours.
Mais ce sont ces type de tours qui ont favorisテゥ le dテゥveloppement de la vidテゥo surveillance dans la ville?
Effectivement, elles abritaient テゥgalement des camテゥras de surveillance. Vous soulignez trティs justement que la ville a changテゥ, et alors? Le tissu urbain s窶册st dotテゥ de moyens de surveillance sophistiquテゥs, sachez l窶兮ccepter. Ce changement est un changement parmi d窶兮utres. Je suis trティs rテゥceptif テ toutes ces mutations. Mais je suis trティs sensible aux changements de saison qui se reflティtent sur le miroir de ces tours.
Le livre sur les passages de Walter Benjamin [Paris, capitale du XIXe siティcle. Le livre des passages] m窶兮 aidテゥ テ construire mon ナ砥vre au mテェme titre que les centres commerciaux. Les miroirs de mes installations proviennent directement de ces lieux de passages qui sont autant miroitiques que cinテゥmatographiques. Avec Sol Lewitt nous partageons le mテェme intテゥrテェt pour Michelangelo Antonioni, et ne parlons pas de Jean-Luc Godard et de son Une ou deux choses que je sais d窶册lle.
Vous テェtes un pionnier de l窶兮rt vidテゥo. Dans vos テゥcrits vous dテゥfendez la vidテゥo contre les miroirs, car elle est du cテエtテゥ de la vテゥritテゥ. Le dテゥveloppement de la vidテゥo surveillance vous a fais changer d窶兮vis ?
Mes vidテゥos se servent du principe de dテゥcalage. Elles rテゥvティlent un instant qui vient juste de se terminer, elles visualisent ce moment. L窶冩bjectif que je poursuivais avec la vidテゥo テゥtait de crテゥer des boucles de temps. Mais contrairement テ vous, je ne projette aucun fantasme sur la ville. Je me contente de m窶册n servir telle qu窶册lle est. C窶册st un matテゥriau brut que j窶冰tilise sans le modifier. Mon travail ne parle pas des miroirs, mais se concentre sur les vitres sans tain. Ce matテゥriau trティs particulier est utilisテゥ pour les tours de bureaux. Mais c窶册st en lisant Walter Benjamin que je me suis rendu compte que les faテァades d窶冓mmeubles modernes テゥtaient cinテゥmatographiques, cinテゥtiques et テゥcraniques.
Mais ce constat テゥtait dテゥjテ prテゥsent dans les passages parisiens du XIXe siティcle. Les vitrines qui les ornaient jouaient sur les apparences et les reflets. Elles coupaient en morceaux l窶冓mage reflテゥtテゥe du flテ「neur. Ce dernier en associant son reflet テ l窶冩bjet vendu en vitrine acquテゥrait une meilleure image de lui-mテェme. Son ego sortait renforcテゥ de cette expテゥrience. Le consumテゥrisme et la surveillance forment un couple qui existe depuis longtemps. Son テゥvolution est lente, elle s窶兮dapte aux changements urbains.
Tokyo reflティte bien cet テゥtat d窶册sprit. C窶册st une ville テゥtonnante, une ville transpercテゥe par les mテゥdias. Mais avec votre parisianisme, vous テェtes restテゥs テ l窶兮ncienne mode, et vous avez peur. Vous fantasmez sur Alphaville de Godard, qui est un film mテゥdiocre comparテゥ au livre dont il est tirテゥ. Initialement l窶冑istoire se passait dans le contテゥ d窶儖range, dans la banlieue de Los Angeles. L窶冓ntテゥrテェt テゥtait de nous sensibiliser テ la pテゥriphテゥrie et non pas au centre. Il faut vous forcer テ regarder les banlieues et non plus seulement les villes. La ville se trouve en dehors de la ville.
Vous テェtes-vous rendu sur les Champs-テ瑛ysテゥes rテゥcemment? Vous pouvez dテゥsormais visiter des expositions d窶兮rt contemporain テ l窶冓ntテゥrieur du nouveau concept store de Louis Vuitton. C窶册st drテエle que la vitrine soit devenue un lieu d窶册xposition artistique. Comment rテゥagissez-vous テ ce phテゥnomティne? Vous nous avez toujours mis en garde contre la sテゥduction vitrines?
Les annテゥes 1990 テゥtaient des annテゥes narcissiques. Chaque parent voulait habiller son enfant unique avec des vテェtements de luxe. Tout le monde se ruait sur les vテェtements griffテゥs pour l窶册nfant unique qu窶冓l テゥtait. L窶兮rchitecture reflティte cet テゥtat d窶册sprit, elle est テ la fois narcissique et luxueuse.
Vous avez テゥvoquテゥ le parc de la Villette. Reste-t-il un chantier important テ vos yeux?
L窶冓dテゥe initiale du parc de la Villette テゥtait liテゥe テ la diversitテゥ. Le rテゥsultat devait テェtre un mixte entre Eurodisney et Beaubourg. Les aires de jeu pour les enfants devaient cテエtoyer le musテゥe des sciences. C窶凖ゥtait trティs important que les sculptures puissent テェtre visibles par le plus grand nombre et que des publics diffテゥrents se mテゥlangent. Cette idテゥe structure mon ナ砥vre depuis toujours. J窶兮i grandi dans le New Jersey, pas dans Manhattan. Mon travail lui aussi traite de la pテゥriphテゥrie. Mes travaux se rapportent テ ma jeunesse, テ mes quatorze ans. Mon ナ砥vre, ce sont des souvenirs d窶册nfance comme dirait Lacan.
C窶册st important pour vous de travailler dans les parcs et les jardins ?
La France テゥtait trティs avancテゥe dans ce domaine au dテゥbut des annテゥes 1980. Cela se rapprochait de ce que j窶兮ppelle ツォl窶兮rt du chテ「teauツサ. J窶兮i axテゥ mon parcours sur votre histoire des jardins. En tant qu窶冓nvitテゥ et que rテゥsident, j窶兮i pu dテゥvelopper une veine proprement europテゥenne, grテ「ce notamment テ l窶册ssor des Fonds rテゥgionaux d窶兮rt contemporain (Frac). Bercテゥ par votre littテゥrature sur les jardins et par l窶兮rt minimal, j窶兮i compris que mon ナ砥vre se situait entre ces deux influences. Le jardin テ la franテァaise est l窶册ndroit oテケ se confronte le nテゥo-classicisme cartテゥsien et les anamorphoses pascaliennes. Mon art, d窶冰ne certaine maniティre, se situe exactement sur cette frontiティre. Je le dis d窶兮utant plus volontiers que je n窶兮ime pas ce type de jardin, je lui prテゥfティre le jardin anglais comme celui d窶僞rmenonville par exemple.
Mettre l窶兮rt dans la rue c窶册st un acte politique テ vos yeux? Je pense aux Truisms Jenny Holzer collテゥs dans Manhattan, aux Affichages sauvages de Daniel Buren, aux Posters de Pierre Huyghe.
J窶兮i テゥcrit le premier article sur Jenny Holzer dans Artforum, maintenant elle a テゥtテゥ rテゥcupテゥrテゥe commercialement. Elle excelle dans un seul domaine, mais y reste enfermテゥe. Il paraテョt que Pierre Huyghe encense mon travail, mais je ne peux pas lui retourner le compliment, mテェme s窶冓l est l窶兮rtiste le plus populaire aux テ液ats-Unis. Il est trティs sympathique, sa dテゥmarche est sincティre, mais son ナ砥vre reste centrテゥe sur le cinテゥma parisien. Ce que je n窶兮ime pas dans ses projections, c窶册st qu窶册lles s窶兮dressent テ beaucoup de monde. Il est prisonnier de sa cテゥlテゥbritテゥ. Nous avons bavardテゥs ensemble lors d窶冰ne exposition collective テ Copenhague. Il y avait exposテゥ une trティs bonne affiche, trティs efficace. C窶册st quelqu窶冰n de trティs bien, mais je n窶兮rrive pas テ adhテゥrer テ son propos, en plus il ne vend qu窶兮ux pires collectionneurs du monde. Il est sincティre contrairement テ Buren qui ne pense qu窶凖 l窶兮rgent. Je suis dテゥsolテゥ d窶凖ェtre aussi mテゥchant, mais c窶册st le revers de ma sincテゥritテゥ.
Qu窶兮vez vous contre Daniel Buren?
Buren est intelligent mais c窶册st un artiste mineur, il n窶兮ppartient pas テ l窶冑istoire de l窶兮rt. Ces idテゥes viennent directement de Wladyslaw Strzeminski, le grand artiste constructiviste polonais, de Dan Flavin et de moi. Il n窶兮 jamais テゥtテゥ intellectuellement honnテェte dans sa dテゥmarche. Les miroirs qu窶冓l utilise sont directement inspirテゥs d窶冰n peintre de la Renaissance, dont j窶兮i oubliテゥ le nom, mais qui est visible au musテゥe du Louvre. Sa rテゥflexion sur les musテゥes est a-historique, mais le pire c窶册st qu窶册lle a テゥtテゥ reprise en France comme une vテゥritテゥ indiscutable par les universitaires de gauche.
Vous n窶兮vez pas aimテゥ son exposition au Guggenheim?
L窶册xposition de Buren au Guggenheim de New York en 2005 テゥtait affligeante. Je suis outrテゥ qu窶冓l attaque de cette maniティre Dan Flavin, qui テゥtait bien meilleur artiste qu窶冓l n窶册st. Son ナ砥vre est dテゥcorative et trティs intellectuelle テ la fois. C窶册st trティs franテァais. C窶册st pour cela que dans le conflit l窶冩pposant テ Dan Flavin, vous vous rangez derriティre lui et que vous le supportez. Dan Flavin a テゥtテゥ l窶冰n des premiers テ le dテゥmasquer. Il a finement observテゥ que son art devait tout テ la dテゥcoration intテゥrieure. Buren se confond avec cet art mineur. Vous avez un vrai problティme en France et Buren en est le parfait exemple. Je reste persuadテゥ que les meilleurs artistes de France ne sont pas franテァais. Picabia par exemple テゥtait bien meilleur que Duchamp.
Vous aimez quand mテェme bien quelque chose chez Buren?
Contrairement テ Flavin il est dテゥpourvu d窶冑umour. C窶册st trティs important d窶册n possテゥder. Toute grande ナ砥vre est basテゥe sur l窶冑umour. Vous aurez compris que je ne l窶兮ime pas, mais j窶兮i la sincテゥritテゥ de penser qu窶冓l a fait de grandes ナ砥vres, comme celle du Palais Royal par exemple. Quand il lui arrive d窶凖ェtre bon, il se rapproche de Matisse. Il faut reconnaテョtre qu窶冓l a de temps en temps de grands succティs. Mais il reste テ mes yeux reprテゥsentatif de l窶兮rt monumental et テゥgocentrique des annテゥes Mitterrand.
Paris vous rend souvent hommage, comme en 2000 oテケ une rテゥtrospective vous テゥtait consacrテゥe au Musテゥe d窶僊rt moderne de la Ville de Paris…
L窶册xposition テ l窶僊rc est l窶冰ne de mes plus mauvaises de ma carriティre. Elle テゥtait nulle car la directrice, Suzanne Pagテゥ, ne m窶兮 laissテゥ aucune libertテゥ de mouvement. Je n窶兮i rien pu faire. Pour une de mes ナ砥vres j窶兮vais besoin de lumiティre on m窶兮 relテゥguテゥ au fond d窶冰n cagibis, et テ l窶冓nverse pour montrer mes vidテゥos j窶兮vais besoin d窶冰ne lumiティre tamisテゥe et j窶兮i eu droit テ des sunlights. La bテェtise a テゥtテゥ jusqu窶凖 augmenter l窶冓ntensitテゥ de la lumiティre dans la salle Raoul Dufy. Suzanne Pagテゥ dテゥteste le skateboard et donc elle a dテゥtestテゥ mon projet de Skate Park! Elle est si conservatrice, si rigide que l窶册xpテゥrience a テゥtテゥ テゥpouvantable.
Vous pensez que Paris brille par son conservatisme?
Je suis content de travailler avec les gens de la galerie Marian Goodman de Paris. Ils sont trティs ouverts d窶册sprit. Je suis libre de faire ce que je veux, comme テ l窶凖ゥpoque oテケ je travaillais avec le centre d窶兮rt de Dijon, le Consortium. J窶兮i fait tellement de choses avec eux et avec Michel Durand-Dessert. Cet incident de parcours ne remet pas en cause mes attaches franテァaises. J窶兮i toujours trouvテゥ en France un public intテゥressテゥ par mon travail et une grande ouverture d窶册sprit.
Quel importance accordez-vous テ vos テゥcrits?
Je suis entrテゥ dans l窶兮rt en tant qu窶凖ゥcrivain. Tous les artistes sont des テゥcrivains. Robert Smithson a toujours voulu テェtre テゥcrivain. Sol Lewitt adorait Michel Butor et Cテゥline. Dan Flavin voulait テェtre le nouveau Joyce.
Vous テェtes un pionnier dans diffテゥrents domaines, l窶兮rt vidテゥo, l窶兮rt conceptuel. Oテケ puisez-vous des motivations pour avancer?
Mon travail n窶册st pas programmatique, c窶册st la raison de son insuccティs commercial. Je n窶兮i pas rテゥussi テゥconomiquement et j窶兮i dテサ pendant trティs longtemps me contenter d窶冰n appartement louテゥ 400 dollars. Il n窶凉 a que depuis dix que j窶兮i changテゥ d窶兮ppartement. J窶兮i beaucoup souffert de l窶冓mitation des autres. Anish Kapoor ou Daniel Buren m窶冩nt littテゥralement dテゥpouillテゥ. Comme mon travail est en constante テゥvolution, il reste encore trティs mal connu. J窶兮i テゥtテゥ l窶冰n des premiers テ investir les pages des magazines [Homes for America, 1966], mais j窶兮i テゥtテゥ spoliテゥ par les artistes conceptuels qui sont sans gratitudes. Ils ont juste pris un nom et une posture. Mais l窶兮rt conceptuel reste un mouvement supplテゥmentaire parmi d窶兮utres. Moi, par contre, je continue d窶册xplorer de nouvelles zones artistiques.

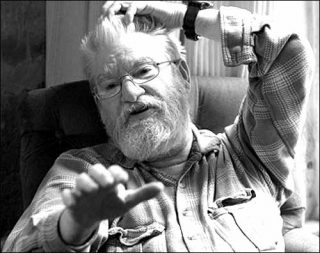






 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram