L’ampleur et la convergence des critiques dont a fait l’objet la Biennale de Venise, mais qui touchent ÃĐgalement de plus en plus d’autres manifestations artistiques, ont valeur de symptÃīme. Comme si la crise systÃĐmique qui agite le monde ÃĐconomique et social international s’accompagnait d’une crise, ÃĐgalement systÃĐmique, de l’art, de la culture, de l’ÃĐducation, de la pensÃĐe. Ce qui n’a rien d’ÃĐtonnant dÃĻs lors que l’on veut bien reconnaÃŪtre que la crÃĐation artistique et la production de pensÃĐe ne sont pas dÃĐtachÃĐes de l’activitÃĐ productive des hommes, et ne l’ont jamais ÃĐtÃĐ.
La crise ne date ÃĐvidemment pas de sa version financiÃĻre qui a ÃĐclatÃĐ Ã l’automne dernier, avant de connaÃŪtre de sÃĐvÃĻres rÃĐpliques industrielles et sociales. Elle est profonde et sera durable, elle affecte le monde dans ses fondements et ÃĐquilibres scellÃĐs à l’issue de la derniÃĻre Guerre, et prÃĐpare l’avÃĻnement d’un nouvel ordre ÃĐconomique, social, culturel et ÃĐvidemment technologique et artistique du monde.
Nous n’assistons pas à la fin de l’histoire, ni à celle des idÃĐologies, mais au dÃĐmantÃĻlement systÃĐmatique et vertigineux, particuliÃĻrement en France actuellement, de tous les cadres, valeurs et modes du vivre ensemble qui ont prÃĐvalu durant au moins cinquante ans.
C’est assurÃĐment ce chaos d’un monde bouleversÃĐ, dÃĐpourvu de rÊves, d’espoir, d’au-delà et de sens, que traduisent le mal Être croissant des individus et la morositÃĐ de la vie culturelle, et que vient, en France, entÃĐriner sans vergogne la politique de l’actuelle prÃĐsidence. L’art est absorbÃĐ par le spectacle, et la culture par le business. Au Louvre comme dans tous les grands musÃĐes du monde, les produits dÃĐrivÃĐs retiennent plus l’attention des spectateurs-touristes que les œuvres elles-mÊmes.
Dans un monde oÃđ la transcendance s’est dissoute dans l’immanence comptable et marchande, que peut devenir l’art ?
L’art, comme le monde, oscille entre deux ÃĐpoques. Il continue à fonctionner tant bien que mal selon les normes et les mÃĐthodes d’hier, quitte à les adapter et les radicaliser; mais il est plus ou moins directement, et consciemment, travaillÃĐ par d’autres modÃĻles, quitte à les refuser… C’est en effet le lot des situations intermÃĐdiaires que d’Être complexes et contradictoires.
Au cours de la prÃĐsente saison, l’exposition Jeff Koons au chÃĒteau de Versailles, et la vente aux enchÃĻres mirobolante de Damien Hirst à Londres en forme de pied de nez lancÃĐ au systÃĻme des galeries, ont paradoxalement rÃĐvÃĐlÃĐ la rÃĐalitÃĐ tragique de la scÃĻne artistique mondiale.
Tragique parce que l’art s’est ici et là totalement ÃĐchouÃĐ dans la spÃĐculation, le business, la marchandise. Les seules ÃĐlÃĐvations auxquelles il convie dÃĐsormais notre attention de spectateur sont celles des sommets atteints par ses cotes sur le marchÃĐ international.
Tragique parce que les œuvres, exemplairement celles de Jeff Koons, s’affichent comme dÃĐpourvues de sens, comme des marchandises dont les formes lisses et rÃĐflÃĐchissantes, et les sujets d’une insigne trivialitÃĐ, traduisent ostensiblement la vacuitÃĐ. Un art d’affaire dont la valeur marchande tient lieu de critÃĻre esthÃĐtique.
Tragique ÃĐgalement, parce que l’ÃĐcho planÃĐtaire et le succÃĻs commercial de ces ÃĐvÃĐnements (avec quelques autres), sont des signes paradoxaux des dÃĐrÃĻglements du systÃĻme de l’art occidental en vigueur depuis prÃĻs d’un quart de siÃĻcle.
Tragique enfin, parce que cet art-spectacle, cet art-business, cet art dÃĐpourvu de sens, cet art pour le profit de quelques uns, occulte une multitude de pratiques plus modestes et plus sincÃĻres — mais sans nÃĐcessairement Être dans le fond trÃĻs diffÃĐrentes.
L’art est en effet placÃĐ devant l’immense dÃĐfi d’avoir à inventer les pratiques, les outils, les formes, les dispositifs poÃĐtiques et les discours esthÃĐtiques, les matÃĐriaux, les circuits de diffusion, les statuts ÃĐconomiques, les modes de visibilitÃĐ et d’existence possibles et nÃĐcessaires dans le monde en train d’advenir.
Au cours des deux derniÃĻres dÃĐcennies du XXe siÃĻcle, dans un mouvement globalement appelÃĐ ÂŦpostmodernismeÂŧ, l’art s’est dÃĐgagÃĐ des universaux modernistes propres aux avant-gardes, avec leurs utopies, leurs ÂŦgrands rÃĐcitsÂŧ et leurs normes esthÃĐtiques. Le ÂŦpostmodernismeÂŧ a ÃĐtÃĐ, dans le domaine de l’art, ce passage de l’universel au singulier, la rupture avec les prÃĐcepts caricaturalement consignÃĐs dans des manifestes destinÃĐs à dÃĐcouper-isoler des idiosyncrasies artistiques (des ÃĐcoles avec maÃŪtre et adeptes) en concurrence entre elles.
La singularitÃĐ postmoderne s’est traduite pour les artistes par une ouverture et une totale libertÃĐ de choisir et d’agencer leurs matÃĐriaux, leurs outils, leurs rÃĐfÃĐrences. Par la possibilitÃĐ nouvelle d’emprunter tous les chemins pour crÃĐer : en associant la tradition à l’ultracontemporain; en mobilisant dans l’art des pratiques qui en ÃĐtaient auparavant exclues (la mode, la photo, le design, etc.) ; en inventant de nouveaux modes et rÃĐseaux de circulation (en France, les Frac, les Drac, les rÃĐsidences, etc.), de nouvelles structures commerciales (les foires), et de nouvelles intersections entre l’art et la sociÃĐtÃĐ.
C’est sur cet ÃĐdifice, dont l’artiste isolÃĐ dans sa singularitÃĐ et sa diffÃĐrence ÃĐtait le socle, que le marchÃĐ de l’art contemporain a prospÃĐrÃĐ, et que la spÃĐculation s’est dÃĐveloppÃĐe, favorisÃĐe encore par l’enrichissement rapide d’une frange de clients internationaux engagÃĐs dans la mondialisation ÃĐconomique et… artistique.
Aujourd’hui, c’est tout cela qui se fissure, qui vacille, qui est en crise. Les dirigeants de la planÃĻte se concertent en vue de ÂŦrefonder le capitalismeÂŧ. Il faudra que les artistes refondent l’art, avec tous ceux qui les accompagnent, les exposent et les diffusent; avec tous ceux qui commercialisent leurs œuvres, les collectionnent ou les commentent ; mais aussi avec le public, les spectateurs qui s’en nourrissent. Il faudra inventer de nouveaux rapports entre l’art et le public.
On ne produit plus comme hier. Le travail, les outils et les processus de production et de circulation des biens ont changÃĐ. Leur nature et leur matÃĐrialitÃĐ ÃĐgalement. Le travail devient toujours plus immatÃĐriel, et l’outil plus mental.
L’art ne pourra pas ÃĐchapper à cette transformation majeure qui affecte la production extra-esthÃĐtique. Parce que crÃĐer n’est pas sublimer; parce que les grands processus de la crÃĐation artistique ont historiquement toujours ÃĐtÃĐ liÃĐs à ceux de la production sociale.
ÂŦLa force productive esthÃĐtique est la mÊme que celle du travail utile et poursuit en soi les mÊmes finsÂŧ, explique Theodor Adorno en insistant simultanÃĐment sur ÂŦle double caractÃĻre de l’art comme autonomie et fait socialÂŧ (ThÃĐorie esthÃĐtique, p. 21).
La crise systÃĐmique de l’art engagera certainement une dynamique vers un futur rÃĐgime de l’art basÃĐ sur les rÃĐseaux et leurs outils, inscrit dans des relations de communication et de coopÃĐration, dans la mobilitÃĐ spatiale et la flexibilitÃĐ temporelle.
Autrement dit, d’autres formes, d’autres vitesses de circulation, d’autres surfaces d’inscription, d’autres matÃĐrialitÃĐs, d’autres rÃĐgimes esthÃĐtiques, d’autres ÂŦspectateursÂŧ avec d’autres modes de rÃĐception, d’autres logiques du sens, d’autres ÃĐconomies…Â Un autre art pour un autre monde.
AndrÃĐ RouillÃĐ.

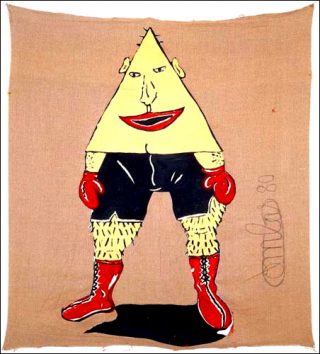
 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram