L’an dernier, au moment même où l’art brut entrait au musée avec la réouverture du LaM à Villeneuve-d’Ascq, la galerie Christian Berst emménageait à quelques pas du Centre Pompidou à Paris. Ces événements sont-ils à interpréter comme un progrès dans le lent parcours de l’art brut vers sa légitimation? La réponse n’est pas si évidente qu’il y paraît.
Céline Delavaux. J’aimerais que vous commenciez par évoquer votre rencontre avec l’art brut.
Christian Berst. Je me suis toujours intéressé à l’art, mais j’étais d’abord un grand lecteur. Post-adolescent, j’avais lu avec beaucoup de délectation les textes polémiques de Jean Dubuffet où il était question de l’art brut. Mais j’en avais une vision réductrice: je prenais ça pour du post-expressionnisme. Je ne savais pas de quoi il parlait! Cependant, le ton de Dubuffet me plaisait: ce côté «à la hussarde» qui brocardait les institutions, de la part d’un artiste qui était dans toute sa maturité. Puis, un jour, dans une librairie, par hasard, je suis tombé sur un petit bouquin, Wölfli compositeur… La couverture m’a accroché, je l’ai feuilleté et j’ai eu un choc! J’ai fait le lien et me suis replongé dans Dubuffet. Je me suis mis à chercher partout — c’était une époque d’avant Internet, je crois même avoir utilisé le minitel! J’ai commencé à me renseigner sur la collection de Lausanne, sur la Fabuloserie. Mais mon premier réflexe a été de me constituer une bibliothèque.
Ensuite, j’ai visité des expositions, qui étaient rares jusqu’en 1995, date de la première exposition à la Halle Saint-Pierre. Puis, j’ai rencontré des gens, comme Laurent Danchin avec lequel j’ai beaucoup échangé. C’était commode, il était à Paris! J’ai ensuite contacté Colin Rhodes, Roger Cardinal, John Maizels… J’ai ainsi fait «mon apprentissage». Cela m’a ouvert à un monde de l’art parallèle, à ce que Dubuffet a appelé la «Neuve Invention», d’abord par le biais des festivals d’art singulier. C’était un moment où le domaine de l’art singulier était très foisonnant, cela a changé aujourd’hui.
Quand on se prend de passion pour un domaine, on est parfois tenté de collectionner… J’ai commencé par de petites choses d’abord, sans avoir une démarche structurée de collectionneur. Au fil du temps, ça a pris de l’ampleur. Car cet intérêt pour l’art brut n’était pas superficiel: cela a remis en question beaucoup de choses, au-delà d’une réflexion sur le domaine de la création, sur la définition de l’art… Cela me mettait en éveil d’une manière bénéfique. Je continue à dire aux gens qui arrivent maintenant «en art brut»: «Vous allez trouver bien plus de questions que vous n’allez emporter de réponses avec vous, en entrant dans ce territoire! » C’est très vivifiant, puisque cela peut être appréhendé non pas du simple point de vue de l’histoire de l’art, mais aussi de la médecine, de la psychiatrie, de la psychanalyse, de la spiritualité, etc. Toutes les zones limitrophes, habitées par l’art populaire, l’art naïf, ne cessent de poser des questions. Comment les définir? On passe notre temps à les définir en négatif…
Pourquoi avoir choisi d’ouvrir une galerie? C’est un certain rapport à l’art brut…
Christian Berst. C’est un certain rapport à l’art, en effet, et à l’art brut en particulier. Mais quand on a envie de s’immerger vraiment dans une passion, qui devient lancinante, il n’y a pas 36 solutions! Je me demandais quoi faire pour en vivre, pour assouvir mes désirs croissants de collectionneur… Il s’est avéré que le pis-aller était d’organiser des expositions. C’était une idée comme ça, sans que je dessine les contours de ce projet. En revanche, j’avais un projet très précis de maison d’édition avec un ami et associé et un bureau à la Bastille, trop grand pour ce qu’on avait à y faire. Des amis m’ont poussé à monter des expositions. En 2004, avec eux, j’ai créé l’association «Objet trouvé», dont le fonctionnement, au départ, reposait sur de bonnes volontés, sur du bénévolat. Or, tenir une permanence pour recevoir du public, c’est évidemment très contraignant. Par ailleurs, très vite, je n’y ai plus trouvé mon compte, parce que lorsque l’on n’a pas assez de temps pour faire le tri dans ce domaine, on commence par l’art singulier… Or, moi, c’est l’art brut qui me faisait vraiment vibrer.
J’ai donc décidé de basculer et j’ai peu à peu quitté les éditions Le Livre d’art. Je constatais qu’il y avait un public de plus en plus nombreux et de plus en plus intéressé. Il y avait une vraie attente, une vraie faim du public. Répondre à une attente, je ne rêvais que de ça. Le seul doute que j’avais, c’était sur mes capacités de marchand! Je ne suis pas marchand, je n’ai pas l’âme d’un marchand. Je ne connaissais pas le milieu de l’art. J’ai d’ailleurs pu constater par la suite que l’engouement du public ne se traduit pas forcément en «affaires»! Mais le bon sens me permettait de penser que si l’on croit à quelque chose, c’est facile à défendre. Et je n’ai pas eu tort! Finalement, on est parfois meilleur marchand, quand on cherche moins à vendre qu’à faire part de sa flamme. Les vrais collectionneurs — je ne parle pas des spéculateurs —, c’est ça qu’ils attendent d’un marchand. Une relation telle se construit que l’on passe à un autre stade: les collectionneurs qui viennent chez moi sont aujourd’hui devenus davantage que des clients. Mais il y a eu des moments très difficiles et j’ai failli mettre la clé sous la porte.
C’est quand l’occasion s’est présentée d’un local derrière l’opéra Bastille, rue de Charenton — un véritable espace d’exposition donc — avec des capacités de stockage, que j’ai basculé. C’était un très chouette moment, car son ouverture a coïncidé avec les 20 ans de la Halle Saint-Pierre. Et tout le petit monde international de l’art brut était là . Le vernissage a été un moment emblématique. Mais je partais de loin! Il y a encore cinq ans, la question de l’argent était taboue dans le domaine de l’art brut… Mais j’avais des liens d’amitié, puisque j’étais d’abord un passionné d’art brut travaillant dans l’édition, avant de devenir marchand.
Et le déménagement dans le Marais?
Christian Berst. Ce n’est pas un simple déménagement. Il y a une charge symbolique dans cette histoire. Je m’en rends compte dans l’attitude des gens: ce recentrage est non seulement géographique mais aussi sociologique. Je suis désormais «sur la carte», dans le tissu des galeries. Auparavant, les gens qui venaient me voir étaient des afficionados. Ici, il y a des amateurs d’art tout court qui découvrent l’art brut avec ma galerie. C’est exactement ce qui me tient à cœur. Je ne veux pas être une énième galerie d’art. Ce qui me tient depuis le début, c’est spécifiquement l’art brut. Mes collectionneurs ont changé: je reçois aujourd’hui une dominante de collectionneurs d’art contemporain qui achètent aussi de l’art brut.
Vous vous rapprochez donc de plus en plus de votre enjeu: faire découvrir ce qu’est l’art brut, le faire entrer dans le circuit de l’art…
Christian Berst. C’est mon vœu le plus cher. Avec l’art brut, on est ailleurs. C’est cet ailleurs-là qui m’a rendu si opiniâtre! L’objet dont il est question est tellement différent et l’idée ouvre à d’autres perspectives. Quand je vais à la recherche d’art brut, je me glisse dans le rôle de l’orpailleur… Mais je me sens aussi investi d’une mission. En germe, il y a une capacité de résistance dans l’art brut, mais il pourrait être dévoré par le marché de l’art. C’est pourquoi, pour moi, c’est une mission. J’ai rencontré, l’année passée en Chine, M. Guo que j’aide depuis à constituer un centre de ressources et de documentation sur l’art brut. Il a écrit le premier livre sur l’art des fous en Chine. Il a agité l’administration pour pouvoir entrer dans les institutions psychiatriques et échanger avec les malades. Le fait que quelqu’un vienne d’Europe pour alimenter sa propre passion a été très important pour lui. Et il est primordial pour moi d’entretenir des relations avec les spécialistes du monde entier.
Que pouvez-vous dire de la question de l’art singulier et de ses frontières avec l’art brut? Et, à partir de là , quels sont vos choix d’exposition, vos critères de sélection?
Christian Berst. J’associe «art singulier» à «Neuve Invention», l’expression de Jean Dubuffet. Dubuffet a été le premier à faire ce constat: certaines œuvres d’art brut peuvent entretenir un certain cousinage avec d’autres, soit par des critères liés à la genèse de l’œuvre, soit par des critères intrinsèques. On retrouve là la difficulté de définir l’art brut qui ne se réduit pas à une critériologie, à une appellation d’origine contrôlée.
Il y a cinq ans, j’étais plus enclin à vouloir défendre avec une égale détermination l’art singulier et l’art brut. Or, je le suis de moins en moins. Car, si l’on y regarde de près: qu’est-ce qui distingue véritablement l’art singulier de l’art patenté, normé ou, comme le disait Dubuffet, «culturel»? L’art singulier, c’est souvent le fait de personnes qui, bien que majoritairement autodidactes, aimeraient se destiner à être artistes, ce ne sont jamais des personnes qui restent isolées et qui créent uniquement pour elles. Jamais.
Si l’on voulait faire une distinction qui ne repose que sur un critère, on pourrait parler de celui de l’intention. Des artistes patentés qui n’ont pas suivi de cursus artistique, académique, il y en a pléthore, et parmi eux les plus grands. Donc l’autodidactisme n’est pas un critère.
Or, pour certains, ça suffit… et l’art singulier, à tort et pour son tort, est devenu un label. Il faut dire les choses comme elles sont: l’art singulier est devenu un label de médiocrité. Il s’enferme aujourd’hui dans un cadre, dans la lignée d’une tendance douteuse qui dit: «Tout le monde peut créer». Tout le monde en a le droit effectivement, mais tout le monde n’est pas artiste! Cette appellation — qui existe depuis l’exposition «Les Singuliers de l’art» (musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 1978) — a décomplexé un certain nombre de gens qui avaient des pulsions créatrices. Mais ce ne sont pas obligatoirement des artistes… Et dans le champ de l’art singulier a surgi une certaine aigreur à l’égard du monde de l’art «culturel». Or, la question n’est pas celle de l’exclusion, c’est celle de la qualité… Les «artistes singuliers» s’enferment dans un rôle de victimes et ne se posent plus les bonnes questions.
Je suis un farouche opposant à l’invention de nouveaux termes pour remplacer l’art brut. En revanche, j’encouragerais les meilleurs artistes de l’art singulier à s’affranchir de cette étiquette.
L’art singulier serait donc devenu un mouvement. L’appellation a fait mouvement?
Christian Berst. Absolument. A partir du moment où l’on se sent rejeté, on recherche une famille… qui partage les mêmes aigreurs. Dans ma courte expérience avec l’art singulier, j’ai pu constater qu’il n’y a pas ou peu de marché. De plus, les collectionneurs sont habitués à acheter en direct dans le cadre des festivals d’art singulier qui ont proliféré. Car les autodidactes ont cherché à se professionnaliser et ont créé des festivals. Les collectionneurs ne sont pas prêts à payer une commission à une galerie et je les comprends! Le mouvement de l’art singulier s’est constitué de telle sorte qu’il trouve un public par lui-même. Au contraire de l’artiste brut, l’artiste singulier cherche à exposer, à vendre, à vivre de son art.
Quels sont donc les choix aujourd’hui de la galerie Christian Berst-Art brut?
Christian Berst. Le but que je poursuis, c’est de montrer de l’art brut. Ce but, je le place au firmament. Mais je m’autorise des excursions! C’était le cas avec l’exposition Josette Rispal, présentée en décembre 2010. C’est une marque de liberté farouche! Je ne veux pas m’interroger seulement en termes de marchandises, je veux continuer à m’interroger sur le sujet. Ces interrogations doivent prendre forme en acte: montrer quelqu’un que l’on ne peut pas rattacher à l’art patenté ou à l’art brut. En d’autres temps, j’aurais employé le terme d’«art singulier», si le contexte de l’art singulier n’était pas ce qu’il est devenu, connoté négativement. Il y a un phénomène de contamination qui atteint l’art brut, d’ailleurs. Il faut lutter pour éviter cette contamination, ce risque de dissolution.
Chaque nouvelle exposition m’offre de nouvelles questions qui me régénèrent. Si l’on a croisé un jour le chemin de l’art brut, c’est qu’il y a du romantisme qui sommeille en nous… Cette poursuite d’un idéal, ce spectre du génie et de la folie en arrière-plan… La part de liberté qu’il faut conserver pour pouvoir enfreindre la doxa de l’art brut elle-même, le discours de Jean Dubuffet. L’art brut était sa documentation, le substrat fécond sur lequel il pouvait construire sa propre pratique. Mais il a opéré une cristallisation. On avait l’art des fous, l’art médiumnique, mais Dubuffet a opéré une jonction, il a placé des œuvres sur le même plan.
Est-il possible de faire dialoguer art brut et art contemporain? Est-ce un de vos projets?
Christian Berst. J’ai envie de retourner la question en disant: pourquoi penser qu’il y a des choses impossibles à faire cohabiter? Cependant, dans les expositions de ce type, on sent souvent, sous-jacente, cette idée encore répandue que l’art brut ne serait pas assez costaud pour tenir tout seul. On lui adjoint donc de l’art contemporain. On a l’impression que les œuvres d’art brut sont encore sous tutelle. C’est peut-être un passage obligé. Nous sommes au gué, en train de traverser. Je ne voudrais pas que cela devienne un tic systématique que de mettre en résonance l’art brut avec l’art primitif et l’art contemporain. Je rappelle que les premiers à l’avoir fait sont les Nazis, avec l’exposition «L’Art dégénéré» en 1937…
Ce qui me gêne dans cette mise en résonance, c’est le sentiment que l’on n’est pas convaincu de la force inhérente à l’art brut. Sur un plan symbolique, avec l’ouverture du LaM, on a franchi une étape: l’institutionnalisation rassure les collectionneurs, peut permettre à des universitaires de travailler. Mais c’est peut-être aussi un enterrement de première classe! La muséification peut être un mausolée. Constater que des institutions comme le LaM se comportent comme des entomologistes, en épinglant des espèces disparues de papillons dans des boîtes, me navre. Aucune audace, aucune curiosité pour l’art brut tel qu’il est en train de se faire dans le monde entier.
D’ailleurs, si l’on compare avec le MOMA ou la Tate Modern qui, eux, font entrer l’art brut contemporain dans leurs collections, les institutions françaises sont indigentes. La notion d’art brut, qui fait maintenant totalement partie de l’histoire de l’art, est tout de même née en France! Cette frilosité est d’autant plus agaçante que, dans dix ans peut-être, d’autres conservateurs, constatant les lacunes en la matière dans nos musées, iront acquérir très chères dans les galeries des œuvres qui, aujourd’hui, s’échangent à des prix très modiques. Alors, au-delà de l’absence de vision, de stratégie novatrice de la part de nos institutions nationales, il s’agit quand même aussi de faire bon usage de l’argent public!
C’est pourquoi j’ai envie de continuer à explorer, à chercher des œuvres vivantes dans tous les coins du monde. J’ai beaucoup plus de satisfaction à découvrir de nouvelles pépites, ce qui n’est pas la vocation d’un musée. Aujourd’hui, je dirais aux historiens de l’art que c’est une faute professionnelle que de laisser l’art brut à l’état de lacune, de pan inexploré dans l’histoire de l’art. Je crois qu’il y a beaucoup de travail à faire pour éclairer la dette qu’ont l’art moderne et l’art contemporain à l’égard de l’art brut.
Quel bilan pour cette première année de la «nouvelle» galerie Christian Berst?
Christian Berst. L’audience s’est vraiment élargie, parce que la période est propice. L’art brut étant la dernière terra incognita de l’art, c’est le seul terrain qui reste à défricher. De ce fait, il n’y a pas seulement les collectionneurs ou le public, mais aussi le monde de l’art qui s’autorise enfin une incursion dans un domaine qui lui était étranger, pour lequel il avait trop d’a prioris idéologiques. Désormais, le cadre a changé pour ceux qui s’intéressent maintenant au sujet, ce qui va enrichir la réflexion et les points de vue. Nous sommes dans une période charnière. C’est très excitant d’un point de vue intellectuel et artistique. Le plus beau est à venir.
Cette deuxième «rentrée hors-les-normes» semble placée sous le signe de la découverte…
Christian Berst. Elle reflète une certaine assiduité et d’excellents réseaux en Amérique latine où j’ai tissé des liens, visité des institutions psychiatriques, où sont apparues de nouvelles personnalités qui se réapproprient le sujet. Dans le domaine de l’art brut, comme ce ne sont pas des artistes qui se signalent d’eux-mêmes, il est essentiel de pouvoir s’appuyer sur des réseaux existants pour trouver les productions là où elles se cachent. L’objectif, c’est d’avoir des relais et d’étendre le réseau à l’international.
Les terrains qui sont les nôtres sont beaucoup plus balisés: en France, il est plus difficile de faire des découvertes. Or, trouver de l’art brut, c’est aussi et surtout reposer l’éternelle question du rapport du brut au culturel. Dans les productions brutes venant de l’étranger, peut-on lire en filigrane les cultures dont elles proviennent? Y a-t-il au contraire une universalité de l’art brut qui s’exprime dans ces œuvres et celles que l’on connaît déjà en Europe? C’est le jeu entre permanence et rupture qui est intéressant. L’art brut que l’on connaît sous nos latitudes ne nous le donne plus à voir. La distance géographique permet de mettre en perspective des questions fondamentales, bien au-delà de l’exotisme.
J’espère que les prochaines éditions vont non seulement intégrer cette dimension internationale mais aussi rouvrir le dossier des différents médias que l’on peut employer dans l’expression brute: photographie, vidéo, musique… C’est sur cela précisément que je suis en train de travailler et cela donnera peut-être l’occasion de quelques surprises. Comme pour les médias employés, trop d’idées reçues ont longtemps réduit le spectre formel de l’art brut à la figuration. Or, beaucoup découvrent aujourd’hui qu’il est bien plus vaste et que, par sa diversité et sa profondeur, il s’inscrit pleinement dans le champ de l’art contemporain. Sans pouvoir y être dilué ou y perdre sa spécificité. Là réside sa force.


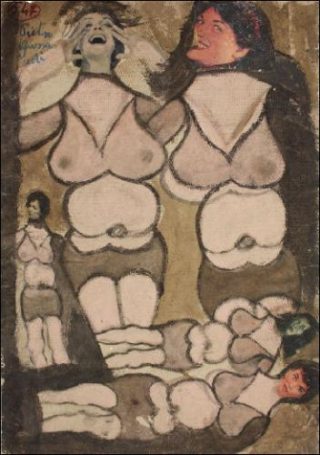

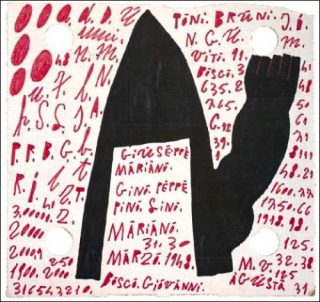

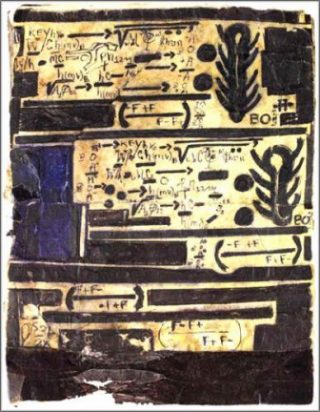

 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram