Elisa Fedeli. Vous avez fondé la revue Cassandre/Horschamp à la fin de l’année 1995. Comment a commencé cette aventure? Quel champ d’études cette revue se propose-t-elle d’explorer?
Nicolas Roméas. J’étais alors journaliste à France Culture dans l’émission de Jean Lebrun, Culture Matin. Je produisais aussi des émissions thématiques, notamment une sur le théâtre en Afrique sub-saharienne et un grand entretien avec Jean Dasté, pionnier de la décentralisation théâtrale en France. Je travaillais aussi pour Cripure, une intéressante revue gratuite. Dans le milieu journalistique — où tout le monde se connaît, se congratule mutuellement d’avoir découvert un tel et un tel — je constatais qu’il y avait un jeu de concurrence et de suivisme qui nuit à la perception de ce qu’est réellement l’outil artistique dans la société. Je voulais sortir de ce petit milieu, l’ouvrir à autre chose et faire ce que ce petit monde n’aime pas beaucoup: relier les choses entre elles, reconnecter les arts vivants, la sociologie, l’histoire et le regard porté sur l’art et la culture d’aujourd’hui. Pour moi, si l’on veut comprendre comment naissent et évoluent les révolutions artistiques, il ne suffit pas de parler entre experts de l’art. Il s’agit aussi d’entendre ce qu’ont à nous dire des sociologues, des historiens, des anthropologues, des philosophes,… On a trop souvent l’impression que les mouvements artistiques tombent tout crus du ciel, que des personnalités géniales débarquent tout à coup avec de nouvelles tendances. Mais, en réalité, de façon plus ou moins visible, tout cela est produit par la société et le choc de l’histoire.
La revue Cassandre/Horschamp milite pour la reconnaissance de l’art en tant qu’outil de société. Pour vous, quel est le rôle de l’artiste?
Nicolas Roméas. Dans la pratique de l’art, il y a quelque chose qui n’existe pas, ou peu, dans d’autres approches du monde: l’usage de l’émotion. Souvent, les savants et les journalistes spécialisés évacuent beaucoup trop rapidement l’émotion. Pour appréhender une situation humaine, on doit pourtant être capable de prendre en compte la part émotionnelle, car c’est une clef essentielle pour comprendre cette situation de l’intérieur. L’art est donc l’un des meilleurs outils, l’un des plus efficaces pour comprendre le monde. Mais, pour cela, il faut que l’on n’oublie pas qu’il est toujours relié à la société, il ne faut pas en faire une sorte d’«exception» réservée à une élite et qui ne peut être analysée que par des experts.
Il faut s’efforcer autant que possible de retrouver le lien entre les pratiques artistiques et les populations dont elles sont issues et pour qui elles sont un outil de compréhension du monde. Les pratiques artistiques sont toujours issues d’un terreau humain. D’où viendraient-elles, sinon? De la Planète Mars? On voit bien — avec par exemple Christian Boltanski ou Thomas Hirschhorn — que mettre son talent au service de la collectivité est tout à fait possible si on le veut. Tous les artistes ne le font pas. Tous n’ont pas gardé cette conscience vive que le matériau qu’ils utilisent est un matériau collectif, civilisationnel et qu’ils en sont les transmetteurs. Ce matériau n’est pas né avec eux et ne mourra pas avec eux. Il les traverse. Ce qui leur appartient c’est leur style, leur «patte», le cachet que donne à l’œuvre une personnalité particulière.
Avec la revue Cassandre/Horschamp, nous avons voulu rappeler que l’art est une pratique collective et que, pour autant, contrairement à ce que l’on entend souvent, cela ne le diminue pas! L’étiquette «socio-culturel» souvent utilisée pour qualifier ceux qui travaillent en proximité avec leurs contemporains, renvoie à une injonction de classes qui dévalorise certaines pratiques considérées comme inférieures… et qui est donc très pernicieuse. Lorsqu’on demande à un artiste d’aller travailler dans une banlieue difficile, la plupart du temps on utilise l’art dans le seul but de calmer le jeu, d’éteindre des «incendies» sociaux. Or, quand on fait cela, on assigne l’artiste à une mission vaine et fallacieuse de réparation de la «fracture sociale» qui nous éloigne de l’art. On le prive ainsi de la possibilité de faire partager l’idée que l’art dépasse tous ses usages utilitaires. C’est mettre complètement de côté la vraie puissance de l’art! La vraie puissance du geste artistique, ça ne consiste pas à occuper les gens pour que pendant ce temps, ils ne fassent pas de bêtises… La vraie puissance de l’art, c’est faire advenir jusqu’à nous une révélation si fulgurante que l’on s’en élève, qu’on en devient meilleur et que l’on ne peut plus se contenter d’être replié sur soi. La vraie puissance de l’art transforme notre regard sur le monde.
Lorsque nous avons créé la revue Cassandre/Horschamp, notre idée était avant tout de faire passer le message qu’il ne faut jamais réduire l’art à l’une de ses fonctions. Il faut faire exploser les barrières entre le politique, le pédagogique, le thérapeutique, le socio-culturel. L’art, c’est tout cela à la fois! Le rôle de l’artiste, c’est de porter tout cela de manière indistincte et unique. C’est en cela que réside sa force.
La revue Cassandre/Horschamp interroge l’usage de l’art, en particulier des arts dits «vivants».
Nicolas Roméas. L’art est fondamentalement un prétexte, non une fin en soi. On a tous vécu cette expérience intime d’être touché par un spectacle, une poésie, un tableau, une musique, et d’en être profondément bouleversé. Et on a ressenti de l’intérieur que cela ouvrait quelque chose. Mais il est très difficile d’exprimer cela de façon à ce que ce soit entendu publiquement. L’art est un des plus beaux outils et l’un des plus efficaces, pour que les êtres puissent se rencontrer en s’élevant et échanger à travers des symboles. Mais cette fonction extraordinaire est très difficile à analyser et à expliquer avec les mots de la raison ou de la science. Il faut que la parole sur l’art soit encore de l’art pour que l’on puisse rendre compte de cet effet particulier. Et s’il ne produit pas cet effet, l’art se réduit alors à une valeur de distinction sociale, comme disait Pierre Bourdieu. C’est un très mauvais usage de l’art, malheureusement très répandu, mais il faut comprendre que nous héritons cet usage des royautés. Il s’agissait surtout, avec la forme architecturale et architectonique qu’a adopté le théâtre dans ces périodes, de permettre à la cour de se contempler elle-même, beaucoup plus que de regarder les pièces. Dans le théâtre à l’italienne, le rapport frontal et la distance entre la scène et le public sont installés de telle façon qu’il ne puisse pas y avoir de véritable dialogue. Le théâtre en rond de Stratford upon Avon du temps de Shakespeare était très différent: un théâtre populaire où les gens ne cessaient d’intervenir. L’auteur et metteur en scène qu’était Shakespeare remaniait sans cesse ses textes en fonction de sa troupe et aussi des réactions du public. Il y avait quelque chose de vivant, une réaction possible de la part du public, que nous avons perdu. Je pense que c’est très important de réfléchir à cela aujourd’hui si nous voulons que les arts redeviennent vraiment vivants.
Pour ce qui est des cultures anciennes — comme avec le théâtre balinais qui a tant marqué Antonin Artaud — voire celles que l’on appelle «primitives» ou «premières», l’art agit sur le terreau d’une croyance partagée par tous. Le théâtre reprend alors une fonction qu’il a dû avoir au tout début de la tragédie grecque: le dialogue avec les dieux. On retrouve là une volonté de mettre en vie des personnages qui sont vivants dans l’esprit de chacun depuis l’enfance. On comprend que cela ne peut pas avoir lieu dans une société post-moderne au bord du déclin, comme la nôtre, où toute croyance est rejetée au profit d’un rationalisme matérialiste poussé jusqu’à l’absurde… Et ce n’est peut-être pas souhaitable.
Le moment artistique vrai, c’est un dialogue, la rencontre entre l’artiste et son public. Et comme le disait Jean Dubuffet, cette rencontre se produit beaucoup plus fréquemment dans les lieux qui ne sont pas faits pour cela. Lorsque vous êtes transformés en spectateurs — parce que vous avez acheté un billet et qu’à la fin vous savez que vous allez devoir applaudir même si vous n’avez rien compris ou pas adhéré au spectacle — l’usage des arts vivants disparaît! Vous avez le sentiment qu’un spectacle quasi immuable, dans lequel vous n’êtes pas du tout acteur, se déroule sous vos yeux. Et cette perte de dialogue se fait au détriment de tout le monde! L’auteur et l’équipe artistique auraient évidemment tout à gagner à participer à un dialogue actif et agissant à l’intérieur de leur société. Ils savent bien qu’ils ne sont pas seulement là pour produire du spectacle.
À ceux qui organisent, qui dirigent, qui gèrent, il faut faire entendre que c’est là l’essentiel. Il est tout à fait possible de faire se rencontrer le public et les artistes avant et après le spectacle, comme nous l’avons fait à Avignon pour «Hors-champ» sur l’île à la Barthelasse en 2001 pendant 10 jours avec la CCAS. Ce sont les aventures les plus magnifiques que l’on puisse vivre aujourd’hui! Toutes les compagnies françaises qui se battent pour ce genre de conception partagée — pas seulement par «chacun» mais par «tous» — sont pour moi les héros de ce siècle.
Quels seraient concrètement les outils à développer pour une démocratie culturelle?
Nicolas Roméas. On peut créer tous les outils que l’on veut, et même investir de l’argent, mais cela peut ne rien donner si le désir n’est pas ardent et si l’on n’agit pas à tous les échelons… Fondamentalement, ce qui est primordial c’est de redonner au symbolique l’importance qu’il doit avoir dans notre société. Aujourd’hui, nous avons à la tête de l’État des gens qui ne se préoccupent pas de parler le français et qui attaquent toute forme d’intelligence au profit du profit! C’est très grave, car il est important pour l’esprit des gens qu’existe une hiérarchie des valeurs commune à l’ensemble de la société qui valorise ce qui a de la valeur. On peut très bien faire des choses incroyables avec peu de moyens, ce n’est pas forcément très grave. Ce qui compte, c’est à partir de quelles valeurs on agit, ce que l’on désire partager. Dans notre histoire culturelle on a assisté à de véritables miracles chaque fois que tout le monde y a cru et que tout le monde s’y est mis. Je ne pense pas que ce soit seulement une question de budget. Certains demandent sempiternellement la multiplication du budget de la culture. Moi, je pense qu’il faut aller plus loin, dire que ce n’est pas le plus important, commençons d’abord par utiliser intelligemment nos moyens! La hauteur des budgets doit être la conséquence de la valeur que nous accordons à ce qui échappe à la rentabilité, à la marchandisation… Que les responsables des grosses structures culturelles commencent par réduire leurs salaires! Je veux être très naïf sur cette question. La culture, il faut y croire. Quand on y croit, ce ne doit jamais être pour s’y installer et gagner de l’argent ou du pouvoir, c’est un combat. Un combat permanent pour l’humain.
La vraie réponse aujourd’hui, ce serait de réinterroger et de revitaliser la notion d’Education populaire. Peut-être ce terme ne serait-il plus vraiment adéquat aujourd’hui, car on ne sait plus très bien ce qu’est le peuple. Mais c’est une histoire fabuleuse. L’Éducation populaire a été portée par les communistes à la Libération et elle est devenue une direction du ministère de l’Education Nationale, puis finalement de Jeunesse et Sports. Son idée reposait sur le fait que chacun doit avoir accès à une activité créatrice qui ne soit pas solitaire mais collective. L’Éducation populaire est une utopie absolument magnifique qui a donné quelques grands moments et qui a formé des personnalités très importantes, notamment dans le monde du théâtre. Mais elle avait évidemment besoin de plus de temps pour s’inscrire dans le tissu-même de la société et pour produire des effets durables. C’était une façon efficace de montrer que la culture fait partie de la vie de chacun, que l’on peut faire connaissance avec les autres à travers une pratique artistique et que l’on peut passer du temps à se construire en tant qu’être humain, à s’enrichir des autres, sans courir après un résultat. Cela a existé en France et nulle part ailleurs à ce point. Au lieu de le revendiquer dans l’Union Européenne et de répandre cette idée magnifique à l’extérieur comme nous devrions le faire, nous sommes en train de la détruire. C’est ce qui se passe actuellement avec la disparition des «stages de réalisation». C’est terrible!
Auparavant, il n’y a pas si longtemps, il y avait encore, à droite, des gens avec qui l’on pouvait discuter de choses élevées, des gens qui défendaient les valeurs immatérielles, spirituelles. André Malraux en fut un grand exemple. Mais Malraux n’a pas défendu l’Education populaire, ni la démocratie culturelle. Il a défendu — et c’était déjà méritoire — la notion de démocratisation culturelle, qui revient à dire que les grandes œuvres de l’esprit, conçues par quelques-uns, une «élite» de créateurs, doivent être mises à la disposition de tous. Dans celle d’Éducation populaire, la volonté va beaucoup plus loin: il y a cette idée essentielle qu’en chaque être il y a une créativité potentielle et qu’il faut la développer pour enrichir l’ensemble de la collectivité humaine. Ce n’est pas la même chose!
Cela veut dire que défendre l’art et la culture consiste à valoriser chez chacun cette capacité à créer et à apprendre. C’est toute une conception de la société. Prenez les 35 heures par exemple, c’était la possibilité, issue des combats du Front Populaire, d’utiliser une partie de son temps différemment que dans un travail mécanique: ne pas seulement être enfermés dans le schéma «Métro, boulot, dodo» mais créer un autre espace de vie qui permette de se cultiver, de devenir l’artiste que l’on a en soi. Est-ce que les 35 heures ont été «vendues» de cette manière? Pas tellement! Même à l’époque du Front Populaire, je pense qu’on ne mettait pas suffisamment l’accent sur la capacité créative des êtres. On a mis l’accent sur le temps libre et on a finalement inventé cette curieuse notion de «Loisirs». Je trouve cette notion très légère, superficielle. Moi, je n’ai pas de loisirs, j’aime bien travailler. Cela me procure de la jouissance quand les choses se réalisent et c’est bien plus agréable que de rester à ne rien faire. Dans l’idée de «Loisirs», il y a celle de repos, comme si l’activité était en soi déplaisante. Nous devons reprendre conscience que la rencontre, l’apprentissage, le partage, sont des outils indispensables à la construction de soi-même.
Il faut aller voir ce qui se passe dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les quartiers difficiles, ces pratiques de l’art auxquelles certains ont décidé d’accoler le label «socio-culturel». Il faut aller voir ce que fait par exemple Armand Gatti avec ses «loulous». Souvent, on lui reproche de produire un effet foudroyant qui révèle ce qu’est l’art à des gens qui ne le savaient pas, mais sans poursuivre la relation, sans rester ensuite avec eux pour les accompagner dans leur démarche. Que vont-ils devenir? Armand Gatti allume la lumière et il laisse la rencontre agir. Ce serait un mensonge de penser que l’on peut suivre le parcours de chacun. Ce que l’on peut faire, c’est allumer cette lumière dans le plus de lieux possibles, montrer que cela existe, donner le goût de l’art. Une fois que cette lumière est apparue, il faut laisser les êtres trouver leur chemin.
Cela fait longtemps que nous le disons: il faut prendre en compte des formes actuelles, issues des populations, comme le rap et le slam. C’est très important car, si vous voulez être dans un dialogue, il est indispensable d’entendre ce que l’autre dit. Pendant très longtemps, on a méprisé toutes les pratiques issues des banlieues. On a voulu imposer une culture «classique» à des gens qui n’en possèdent pas les codes, sans même écouter ce que eux ont à nous dire et à nous donner. Ceux qui se drapent dans ce mépris sont des ignorants! Ils ont oublié que ce qu’ils valorisent aujourd’hui vient des cultures populaires. Ceux-là vont aimer Molière, en oubliant qu’il a été formé par Scaramouche, un maître de la comédie italienne, qui venait elle-même de la Commedia dell’Arte, ce théâtre de rue par excellence! La Commedia dell’Arte fut vraiment un outil de la société italienne. Les histoires sociales, politiques, étaient jouées par des personnages caricaturaux, des situations souvent oppressantes immédiatement compréhensibles par tout le monde et dont on pouvait se libérer par le rire. Et par la réponse immédiate. Le Slam, avec ses scènes ouvertes, repose sur le même principe immémorial d’oralité.
La revue Cassandre/ Horschamp fête aujourd’hui ses 15 ans. Elle a évolué en parallèle d’un contexte. Quelles sont les tendances que vous déploriez au début et qui se sont durcies avec le temps?
Nicolas Roméas. La revue Cassandre/Horschamp a d’abord prouvé que son talent de prophétesse était assez aiguisé, car un certain nombre de choses sur lesquelles nous mettions en garde le milieu culturel s’est produit aujourd’hui. Un certain nombre de valeurs n’a pas été porté et soutenu par les responsables culturels et politiques. Une certaine paresse et un certain confort se sont installés et ont fini par faire perdre de vue l’essentiel.
Le combat pour un «service public de la culture» a été un combat extraordinaire, il faut le mener à nouveau. Ce n’est pas un hasard si c’est à la Libération que ces idéaux sont apparus avec le programme du Conseil National de la Résistance. C’est le produit d’une prise de conscience brutale, consécutive à une terrible catastrophe historique, de ce que c’est que construire une humanité, une sensibilité et un goût commun, de ce qui peut faire de nous des êtres humains et pas seulement des producteurs, des consommateurs, des clients et des travailleurs.
C’est un phénomène naturel: beaucoup de responsables se sont progressivement éloignés de la démarche des pionniers. Dans le domaine que je connais le mieux — la décentralisation théâtrale — c’était la parole de «missionnaires» du théâtre envoyés dans les régions. J’ai connu Jean Dasté, le fondateur de la Comédie de Saint-Etienne et je l’ai interviewé. Quand je lui ai demandé de me parler du Centre Dramatique National, la Comédie de Saint-Etienne des débuts, il m’a répondu qu’il n’y était presque jamais, qu’il se déplaçait de village en village dans un bus avec les comédiens, le cuisinier et leur chapiteau. Ce qu’il préférait, c’était jouer chez les gens et rester, parler, faire la fête avec eux. Il y a un livre magnifique de photographies d’Ito Josué qui raconte l’esprit de la Comédie: seul le visage des spectateurs y est présent. Cela montre bien que le plus important, ce sont les gens, ce que l’on fait avec les gens. Voilà le vrai esprit de la décentralisation théâtrale, un esprit de démocratisation, d’échange et de circulation. Il y a eu la création des centres dramatiques nationaux et peu à peu ils ont été pris en main par d’autres qui ont succédé aux pionniers. Comme dans toutes les histoires magnifiques, il y a une origine forte et peu à peu cela finit par se diluer. Les gens qui sont nommés ont du pouvoir et ils finissent par se croire propriétaires de leur théâtre, à beaucoup moins circuler et à devenir de moins en moins soucieux de l’échange avec les populations. Ne croyons pas que tout le mal vienne de l’apparent adversaire. Les choses se sont très progressivement affaiblies de l’intérieur.
Depuis les débuts de Cassandre/Horschamp, nous alertons sur ces dangers. Il faut réactiver les idéaux pionniers sans passéisme, retrouver la source du désir, rappeler les volontés qui se manifestent dans les moments de violence historique. À la Libération, le pouvoir politique a utilisé l’art et la culture pour recoudre le tissu d’un pays déchiré. Quoi de plus efficace que la culture pour rassembler les gens autour d’idéaux partagés? Là , tout à coup, l’art semble servir à quelque chose. C’était une occasion unique, extraordinaire! Mais ce que nous montrent ces moments historiques est valable pour toute époque, il ne faut jamais l’oublier.
Nous avons assisté à un délitement, une perte de mémoire progressive, et la gauche a de moins en moins parlé de culture. Nous avons eu un président de la République, François Mitterrand, bien plus intelligent que la plupart des socialistes actuels. Il savait que la culture et l’éducation sont des outils absolument fondamentaux pour construire une politique à gauche. Aujourd’hui, en dehors de la plus-value qu’elle peut apporter à telle ou telle collectivité territoriale (et donc à tel candidat), les politiques n’évoquent pratiquement plus la culture. On pourrait faire un parallèle avec l’écologie. Il y a une trentaine d’années, personne ne prenait René Dumont et ses amis au sérieux. Aujourd’hui, même les pires ultralibéraux qui ne partagent pas une seconde ces valeurs, sont obligés de parler d’environnement, de biodiversité, de climat. Ce qu’il faut comprendre, c’est que, en ce qui concerne les enjeux liés au symbolique, nous en sommes aujourd’hui au même moment historique que René Dumont à l’époque. On ne nous prend pas au sérieux. Pourquoi? Parce que l’on n’a pas encore traversé les drames terribles qui ont eu lieu dans le domaine de l’écologie et qui nous ont fait très peur, la désertification, les problèmes d’eau, de pollution, les tsunamis, les problèmes climatiques, etc. L’enjeu du symbolique n’est pas encore entré dans les esprits. Il va donc falloir que l’on subisse des drames. Les sociétés fonctionnent ainsi.
Mais cette fois, c’est l’être humain lui-même qui sera touché. Ce qui est en train de se passer dans l’Education Nationale, c’est l’avancée progressive de la barbarie. On est en train de ratiboiser un certain nombre d’apprentissages scolaires et universitaires car ils n’entrent pas dans les cases de l’utra-libéralisme. Il y a là quelque chose de très grave. Le fait de limiter le personnel et les apprentissages produira inévitablement des catastrophes culturelles. Il y a une volonté implicite de fabriquer un être humain privé de pensée, de mémoire, de transmission, un modèle productiviste de moins en moins éloigné du robot. Si l’on persiste dans cette volonté de limiter la capacité de pensée et d’imagination, c’est une conception de l’être humain qui va mourir. Celle que portait la regrettée Jacqueline de Romilly, grande hélléniste qui défendit bec et ongles les vertus des Humanités. Dans l’histoire de L’Enfant sauvage — dont François Truffaut a fait le beau film que l’on connaît — on perçoit très bien qu’il est très possible de ne pas devenir un humain. Un être humain, ça se construit avec de la mémoire, avec l’apprentissage de langages et de symboles.
Dans le dernier numéro de la revue (n°84), vous avez invité Stéphane Hessel. Vous sentez-vous proche de sa démarche?
Nicolas Roméas. Stéphane Hessel a eu l’intelligence d’écrire le petit livre Indignez-vous avec les éditions Indigènes. Voilà quelqu’un qui nous rappelle que la résistance est permanente et nécessaire quelle que soit la situation. Dans le fond, il exprime des choses simples mais qui disent très bien ce que c’est qu’être un humain. Quelqu’un qui n’est plus capable de s’indigner, ce n’est plus un être humain. C’est une frontière très claire. Nous sommes en train, dans cette société, de fabriquer des gens qui ne sont plus capables de s’indigner. Or la résistance est intrinsèque à la culture et au savoir.
Nous sommes parvenus à un moment où on a l’impression d’avoir en face de soi un véritable bulldozer, une machine industrielle à détruire. Un peu comme dans le film Brazil. Mais cette espèce de Golem est nourri de tous nos abandons, de toutes nos faiblesses, de tous nos renoncements et de toutes nos paresses. La culture est quelque chose de précieux qu’il ne faut pas laisser s’aliéner. Si l’on n’a pas cette croyance, il vaut mieux faire un autre métier. Or, énormément de gens ont investi le monde de la culture pour y faire carrière, gagner de l’argent et du pouvoir. Ceux-là ne s’intéressent pas à ce qu’est réellement la culture. Peu à peu, il y a eu un abandon de cette notion absolument indispensable pour échapper aux normes de la rentabilité: le service public de la culture.
Quels sont pour vous les enjeux d’un «service public de la culture»?
Nicolas Roméas. Pour moi, cela signifie que chaque citoyen de ce pays — indépendamment de ce qu’il aime ou n’aime pas — souhaite participer et soutenir des activités symboliques pour garantir leur existence. C’est passionnant de ne pas aimer et de dire pourquoi. Pour cela, il faut que l’espace de la culture existe et il doit exister hors du secteur marchand. Nous devrions porter ces réalités, ces idéaux, ces combats au niveau européen. Nous avons vraiment aujourd’hui une Europe catastrophique, cette Europe qui est en train de nous imposer la marchandisation de tout et la destruction des services publics par l’obligation de la «concurrence libre et non faussée». Il faut résister à cela, à ce que Copeau appelait déjà le mercantilisme dans les années 1910. Ce n’est pas nouveau mais cela devient hégémonique.
Le désastre passe aujourd’hui par l’absence de transmission et par une formation qui se réduit à l’apprentissage de la gestion. Dans les formations de type médiation, ingénierie culturelle ou management culturel, un terrible formatage d’esprit est imposé aux nouvelles générations. La gestion et l’administration doivent être au service d’une volonté, d’un désir d’art, d’un désir de partage et non l’inverse. Or, l’idée qui se cache derrière ce genre de formations, c’est que les artistes ne savent pas trop y faire eux-mêmes et que cela risque d’être dangereux financièrement. C’est une forme de contrôle de ces «incontrôlables» que sont les artistes.
Et puis, il y a la communication. Aujourd’hui — et ceci à peu près depuis les années Lang —il faut savoir «communiquer». On ne mesure pas à quel point cette injonction est dangereuse, car elle insinue dans les esprits l’idée que l’art est une activité productrice dont il faut «vendre» les produits. Évidemment, l’art véritable doit être lui-même sa propre communication. Il n’a pas besoin de communication qui se surajoute à lui, sinon ce ne serait pas de l’art. L’artiste doit être capable d’intégrer la relation à l’autre, dans sa pratique-même. C’est la base.
Dans notre société, où le chiffre est devenu le grand patron, le monde du symbole a d’avance perdu le combat s’il n’est pas défendu comme valeur essentielle. Le chiffre et le symbole sont deux systèmes de valeurs antagonistes et, je dirais, hostiles. Le symbolique ne peut survivre lorsqu’il est prisonnier de catégories quantitatives. C’est ce qui est en train de se passer avec les nouvelles méthodes d’évaluation en psychiatrie par exemple, d’où l’on fait disparaître toute vraie relation humaine. On sort de l’échange par la parole, par l’écoute. On met des étiquettes sur les gens en fonction de leurs comportements. Il y a une attaque en règle contre la psychanalyse, qui est avant tout un art de l’écoute. Ce sont des phénomènes destructeurs convergents.
Qui, parmi nos artistes, résiste à cette progressive invasion de la médiocrité et de l’égoïsme? Ariane Mnouchkine, Peter Brook à sa façon, le TRAC de Beaumes de Venise et une infinité de gens complètement inconnus un peu partout en France. Parmi les responsables du monde culturel, très peu de gens ont résisté. Catherine Trautmann, ancienne ministre de la Culture, avait eu cette idée à laquelle j’ai complètement adhéré: créer une «charte des missions du service public de la culture» pour rappeler les droits et devoirs des responsables culturels utilisateurs de fonds publics, vis-à -vis notamment des citoyens défavorisés. Mais ce n’est resté qu’une charte… Et qui l’a vraiment suivie? Cette remarquable ministre n’a pas tenu longtemps. L’establishment culturel l’a rapidement mise de côté.
Lorsque l’humanité est au bord d’une catastrophe, cela suscite nécessairement une prise de conscience puissante. Mais le risque est énorme! Pour moi, la troisième guerre mondiale est commencée. Cette guerre, c’est celle du monde du symbole contre celui du chiffre ; celui de l’imaginaire contre celui de l’efficacité apparente. Si les catastrophes ont un sens positif, c’est de nous rappeler des vérités, de nous obliger à nous confronter à l’essentiel. Le combat pour la culture doit être un grand combat national, européen et mondial.
Voir le site de la revue Cassandre/Horschamp
Signer la pétition «Impossible absence: qui lancera l’alerte?»



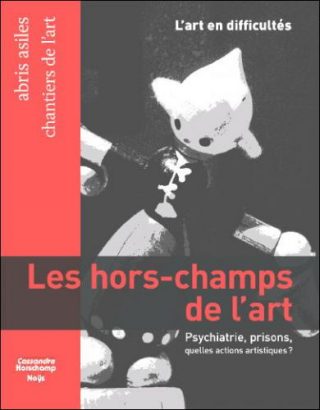
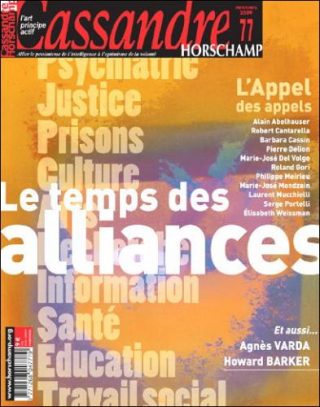


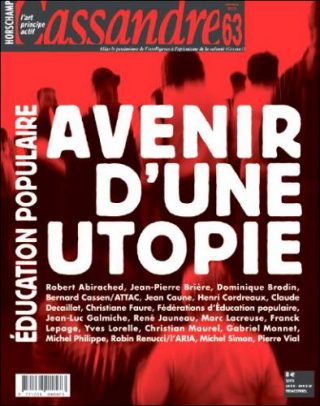
 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram