ŌĆö ├ēditeurs : Les Presses du r├®el / Janvier, Dijon
ŌĆö Collection : Art contemporain
ŌĆö Ann├®e : 2002
ŌĆö Format : 26,50 x 20,50 cm
ŌĆö Illustrations : nombreuses, en couleurs
ŌĆö Pages : 239
ŌĆö Langues : fran├¦ais, anglais
ŌĆö ISBN : 2-84066-071-7
ŌĆö Prix : 30 Ōé¼
Lire lŌĆÖarticle sur lŌĆÖexposition de lŌĆÖartiste au Cnp
Il y a photographie
par Alexis Vaillant (extrait)
Entrer dans le travail de Serralongue, cŌĆÖest mesurer notre rapport quotidien au r├®el spectacularis├® pour justement pouvoir comprendre sa venue et sa n├®cessit├®. LŌĆÖaccepter, cŌĆÖest commencer ├Ā mesurer les incidences quŌĆÖelle peut avoir sur la perception de lŌĆÖactualit├® quŌĆÖelle ┬½┬Ātraite┬Ā┬╗ et, par extension, sur les statuts de lŌĆÖinformation aujourdŌĆÖhui. Serralongue interroge en creux la position de maillon muet, pour ne pas dire aveugle, que les m├®dias font occuper aux photographes sur la cha├«ne de la m├®diatisation de lŌĆÖactualit├®. Il ouvre une br├©che dans les conditions de production de lŌĆÖinformation, br├©che quŌĆÖil est le seul ├Ā arpenter, comme dans un mirador, depuis le choix de la destination jusquŌĆÖ├Ā lŌĆÖexposition du tirage. Il ne moralise pas ces conditions de production. Il les invalide en pointant implicitement leur incapacit├® r├®currente ├Ā produire de lŌĆÖinformation visible. Regarder une image de Serralongue, cŌĆÖest arpenter ce corridor, sa vue par laquelle les ├®v├®nements sont importants et anodins ŌĆö┬Āsans quŌĆÖon puisse ├¬tre certains des raisons pour lesquelles ils le sont dŌĆÖailleurs┬ĀŌĆö se d├®clinent en ┬½┬Āhistoire, micro-utopies, r├®sistance, militantisme, r├®surgence des id├®ologies r├®volutionnaires ├Ā lŌĆÖ├©re dŌĆÖune soci├®t├® informationnelle┬Ā┬╗ [┬½┬ĀInformatique┬Ā┬╗, entretien avec Pascal Beausse, Blocnotes, n┬░16, hiver 1999] sur fond de troisi├©me ┼ōil, le seul ├Ā ├¬tre, pour le spectateur, photographique. Avec notamment Les F├¬tes (1994) qui portent ┬½┬Āsur les ├®v├®nements touristiques cr├®├®s dans les villages pour animer la saison estivale┬Ā┬╗ ou Destination Vegas (1996), issue de lŌĆÖid├®e ┬½┬Ātotalement d├®mesur├®e dŌĆÖemmener cinq mille fans dans le d├®sert┬Ā┬╗, Serralongue saisit lŌĆÖopportunit├® de pointer les mani├©res dont certaines images manquent aujourdŌĆÖhui, au point de ┬½┬Ār├®tablir une v├®rit├® par d├®faut┬Ā┬╗ [├ēric Troncy, ┬½┬ĀPoints de vue et images du monde┬Ā┬╗, Documents, n┬░12, 2000] et de nous la rendre n├®cessaire sans toutefois la formater en photo-journaliste, reporter ou artiste.
Ramener des photos
Pour la s├®rie Faits divers, Serralongue sŌĆÖest rendu ┬½┬Āl├Ā o├╣ ├¦a a fait mal ┬Ā┬╗. Nous sommes en 1994, aux pr├®misses de son travail. Et d├®j├Ā, lŌĆÖintuition de devoir ┬½┬Ā├®chapper ├Ā des questions dŌĆÖordre formel ou stylistique┬Ā┬╗ [┬½┬ĀInformatique┬Ā┬╗, op. cit.] lŌĆÖincitent ├Ā garder ses distances et ├Ā ressaisir le texte du fait divers publi├® dans Nice-Matin pour lŌĆÖapposer sur la partie inf├®rieure blanche du tirage encadr├®. Mention ainsi faite de la source qui force ├Ā la lecture, lŌĆÖimage fait son plein de sens et r├®siste d├©s lors ├Ā une appr├®hension purement stylistique en donnant, et cŌĆÖest l├Ā o├╣ la m├®thode de Serralongue se r├®v├©le capitale, non plus lŌĆÖ├®v├®nement vu mais la possibilit├® de m├®diatiser un rapport entre un photographe, un ├®v├®nement ou ses traces ou ses signes et un spectateur par le biais de la photographie. Fruit dŌĆÖune enqu├¬te sur lŌĆÖenqu├¬te, lŌĆÖop├®rateur quŌĆÖest Serralongue ne produit pas de traces. Cet espace m├®diatiquement incompr├®hensible pour les m├®dias est ren├®goci├® dans chaque image. On comprend tr├©s bien pourquoi Serralongue a voulu travailler pour des quotidiens.
Pour Corse-Matin (1997) par exemple, Serralongue int├©gre lŌĆÖ├®quipe dŌĆÖun journal et devient photo-reporter sans transposer litt├®ralement sa m├®thode et les sp├®cificit├®s de son espace de travail sur celui du journal. Si un clich├® est publi├®, il existe publi├® mais aussi comme ┼ōuvre publi├®e. Ceci ├®tant, la page du journal ne se donne pas comme une ┼ōuvre.
DŌĆÖo├╣ lŌĆÖint├®r├¬t de parutions post├®rieures ├Ā ce travail et accord├®es ├Ā dŌĆÖautres journaux, Blocnotes par exemple, l├Ā o├╣ justement il y a production de commentaire et que les images parues deviennent des documents de travail en ├®tant republi├®s. ├Ć la diff├®rence de Dan Graham qui a fait exister des projets dans des magazines [Dan Graham, ┬½┬ĀMes travaux pour les pages de magazine┬Ā┬╗, Ma position, Dijon, Les presses du r├®el, 1992], Serralongue ne poursuit pas de logique du ┬½┬Āfaire pi├©ce ailleurs┬Ā┬╗ ŌĆö┬Āce qui, dans une optique diff├®rente pourrait aussi en ├¬tre une┬ĀŌĆö il destine ce travail ┬½┬Ādu┬Ā┬╗ journal uniquement ├Ā la reproduction, comme sŌĆÖil ne dissociait pas au niveau de lŌĆÖintention la base et la r├®ception de lŌĆÖimage de son contexte global de production et de diffusion. Parce que ces commandes parues ne sont pas des ┬½┬Āinserts┬Ā┬╗, elles prolongent de biais les types de ┬½┬Ātranscription┬Ā┬╗ de lŌĆÖ├®v├®nement que Serralongue amorce┬Ā: en de├¦├Ā du pathos qui sert de proth├©se communicationnelle ├Ā lŌĆÖactualit├® et au-del├Ā du statut de base de la photo comme photo-souvenir de nŌĆÖimporte quoi.
Le fait quŌĆÖil se mouille pour obtenir les infos de premi├©re main et se mettre au service de, lŌĆÖaide aussi parfois ├Ā faire passer subtilement un ├®cart de regard que garantit son travail entre ce quŌĆÖon lui demande, et ce quŌĆÖil ┬½┬Āen┬Ā┬╗ pense. Il est m├¬me parfois le seul photographe sur ┬½┬Āces┬Ā┬╗ lieux de lŌĆÖactualit├®.
R├®flexion faite
Le travail de Serralongue constitue le cadre dŌĆÖune r├®flexion sur les emplois et les v├®rit├®s de lŌĆÖimage.
Si chaque image le d├®montre sans lŌĆÖillustrer, cŌĆÖest parce que son auteur saisit la photographie en d├®montrant quŌĆÖil y a photographie parce quŌĆÖil y a photographe et non pas lŌĆÖinverse.
(Texte publi├® avec lŌĆÖaimable autorisation des ├®ditions Les Presses du r├®el)

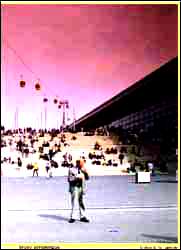

 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram