Albane Montangé. Comment vous êtes-vous rencontrées pour ce projet?
Claire Labastie. Nous nous sommes rencontrées pendant la préparation de nos doctorats d’arts plastiques au séminaire doctoral de Jean Da Silva.
Lorraine Alexandre. Depuis, certaines ont soutenu leur thèse. C’est en venant aux soutenances que nous avons appris à mieux connaître nos travaux, à mesurer leur portée respective provoquant ainsi l’envie de travailler ensemble.
Sabine Dizel. Ce projet précis a commencé il y a deux ans, le temps de le faire progresser, de trouver des financements, avec pour finalité à la fois une exposition et un catalogue. Le groupe lui-même a évolué. La dynamique du projet nous a poussées à dépasser le cadre universitaire.
Anne Gavarret. c’est très agréable d’être soutenues dans ce projet par l’université, et en même temps de se sentir entièrement libres et responsables de ce que l’on montre.
Quelle place accordez-vous à l’idée d’exposition collective?
Lorraine Alexandre. J’ai initié le projet en en discutant souvent avec Jean Da Silva qui m’a parlé de la possibilité d’obtenir un financement du Cerap (Centre d’étude et de recherche en arts plastiques, Paris 1 Panthéon-Sorbonne) dont il est co-directeur. Il pensait surtout à un colloque ou une publication, mais je préférais l’énergie d’une exposition collective surtout accompagnée d’un catalogue qui valorise tout autant nos travaux d’artistes que notre travail d’écriture. Certaines personnes autour de moi produisent de très beaux travaux et j’étais curieuse de voir ce qui pouvait naître de leur rencontre. En tant qu’artiste, j’aime les expositions collectives qui nous protègent du potentiel nombrilisme et de la solitude des expositions personnelles.
Claire Labastie. En effet, l’exposition collective est une synergie qui alimente une exigence, produite par les tensions et les liens propres aux relations humaines.
Tia Calli Borlase. C’est l’occasion pour chacune d’entre nous de partager des idées, les confronter, mettre en relation différents types de travaux qui fonctionnent bien ensemble.Â
Claire Labastie. Cette harmonie n’était pas prévisible; j’ai adoré voir naître cette cohérence tout au long du processus de mise en place de ce projet.
Tia Calli Borlase. On a travaillé très longtemps ensemble, comme l’a signalé Sabine, nous y avons passé deux ans.
Lorraine Alexandre. Oui, une durée suffisamment importante pour nous donner le temps de consolider le groupe et de penser un vrai travail de fond.
Sabine Dizel. Nous avons pu ainsi développer un travail à la fois théorique, en rédigeant les textes du catalogue, et artistique, en produisant les pièces de l’exposition. Nous pouvions ainsi confronter différentes dynamiques.
Tia Calli Borlase. Et justement, les textes servent de points d’appui pour construire nos travaux artistiques. Ce qui est intéressant aussi c’est que la cohérence de l’exposition elle-même avec l’élaboration du catalogue: tout le travail fait en amont, construction des textes et choix des œuvres, s’est concrétisé dans l’accrochage, c’est impressionnant.
Comment avez-vous pensé le choix des œuvres?
Tia Calli Borlase. Nous étions déjà reliées d’une certaine façon puisque nous travaillions toutes sur le corps.Â
Anne Gavarret. C’est plutôt une question qui traverse nos recherches, nos œuvres qu’un thème à proprement parler, et c’était évidemment ouvert aux débordements, à l’irrespect.
Lorraine Alexandre. Nous avons choisi les œuvres collectivement à partir des propositions de chacune en respectant un thème commun qui nous reliait déjà donc. Nos regards sont tous différents, mais ils sont comme des électrons tournant autour d’un même noyau dur, expérimentant les multiples facettes d’un même sujet. En faisant court, si je parle des modes de mise en scène et de réappropriation formelle du corps, Annick Naour montre l’impact de la société de consommation sur le corps vivant. Anne Gavarret va jusqu’à chercher les expressions de la perte, de la défiguration à travers les traitements numériques de l’image. Claire Labastie court après le temps et ses effluves. Plus optimiste, Tia Calli Borlase cherche les métissages entre corps animal et corps humain pendant que Sabine Dizel utilise l’intime et le nourrit de ses rêveries… J’espère que vous vous y retrouvez toutes, surtout Annick qui est à New York cette année et ne peut pas être avec nous aujourd’hui.
Comment avez-vous choisi le titre «Epidermies»?
Claire Labastie. Le titre était différent au départ.
Lorraine Alexandre. En effet, en initiant le projet de cette exposition, j’étais partie sur l’idée de corps sensible, mais je suis, entre temps, intervenue dans un colloque (Colloque «Le corps sensible», 14 et 15 Mai 2010, Université Paris-Est et Université Paris III organisé par Steven Bernas Lisaa et Crir) homonyme qui donnera lieu à une publication et qui n’avait pas de lien direct avec le Cerap qui finance notre catalogue. Il existait alors une possibilité de confusion entre les deux projets. Tout le monde s’est donc entendu pour changer de titre.
Tia Calli Borlase. Nous nous sommes toutes réunies dans un café, le temps était compté car il fallait finaliser le catalogue. Et maintenant, ce titre «Epidermies» nous appartient complètement. C’est une invention collective.
Anne Gavarret. C’était un brainstorming, je me souviens avoir dit vraiment n’importe quoi, enfin ce qui me venait à l’esprit; et l’idée des peaux d’images que j’aime bien s’est transformée en «épidermie», qui contient aussi cette idée d’une forme de dégradation et de contagion. On a vérifié que le terme n’existait pas, et on l’a mis au pluriel.
Claire Labastie. C’était une approche très amusante et vive.
Tia Calli Borlase. Nous avons ainsi relancé le projet, créé une dynamique forte et unificatrice.
Claire Labastie. Le fait d’avoir peu de temps peut l’expliquer. Nous tournions autour de plusieurs mots qui n’allaient pas, ils lésaient tous au moins l’une d’entre nous. Et puis, celui-ci a émergé et tout de suite fait l’unanimité. Nous l’avons toutes adopté, c’était immédiat, c’était un très beau moment.
Lorraine Alexandre. L’invention d’un mot nous permet de vraiment le posséder, c’est notre bien. D’ailleurs, le titre «Epidermies» a été déposé pour nous appartenir définitivement, empêcher tout emprunt déplaisant.
Sabine Dizel. Finalement, c’est un meilleur titre, bien plus original.
Tia Calli Borlase. Il a un côté post-surréaliste, il est riche.
Claire Labastie. La plupart de mes travaux partent d’un jeu de mot, alors forcément, j’adore cette idée.
Tia Calli Borlase. Il fait penser à une succession de couches insistant sur sa valeur épidermique.
Claire Labastie. Nous nous extrayons ainsi de la cérébralité à l’origine de notre rencontre au séminaire doctoral.
Tia Calli Borlase. Et c’est très ludique.
Claire Labastie. Ludique et tendu.
Sabine Dizel. Il faut bien dire qu’il y avait un enjeu.
Claire Labastie. Une tension productive et fascinante.
Lorraine Alexandre. C’est à ce moment précis que j’ai commencé à vraiment voir naître une énergie de groupe encore fragile jusque-là . Ce titre très personnel, personnel à six donc, nous a rapproché et a consolidé le groupe.
Dans quel registre situez-vous le concept d’«Epidermies»? Est-ce scientifique, sentimental, émotionnel…?
Claire Labastie. Plastique aussi…
Sabine Dizel. Plastique et esthétique, voire philosophique.
Claire Labastie. Mais sur un plan métaphorique.
Sabine Dizel. Ce titre traduit bien le mélange entre la part du sensible (dans une création parfois très spontanée) et la recherche d’une réflexion théorique plus poussée.
Tia Calli Borlase. On peut avoir une aspiration scientifique. Dans mon travail, je parle de sujets scientifiques, concrets et je les transforme complètement. J’aime commencer à partir de planches anatomiques, mais au final, c’est surtout l’émotion qui m’intéresse. Je travaille notamment en sculptant avec des sous-vêtements, mais pour les retourner, chercher à travailler les sous-vêtements de l’intérieur de la peau, sous l’épiderme.
Claire Labastie. Il faut alors parler d’hypoderme.
Tia Calli Borlase. Dans nos travaux, certaines s’intéressent au dessus de la peau, et d’autres au dessous de la peau. Chacune se réfère à une strate différente.
Anne Gavarret. Pour moi, les stratifications sont aussi celles du temps, car ce sont toutes des images d’images. Sinon, la peau, de façon métaphorique, c’est aussi l’interface du corps avec le monde, à la fois protection du dedans et contact au dehors; une enveloppe parfaitement singulière à chacune, un attribut que tout le monde possède. Le spectateur appréhende nos oeuvres à partir de sa corporéité, même s’il n’y a pas de contact véritable, comme l’a magnifiquement écrit Jacinto Lageira dans la préface du catalogue.
Sabine Dizel. Mes sténopéphotographies opèrent au ras de l’épiderme, presqu’au contact, à la distance de l’intime. L’assemblage des vignettes de peau sur de grands panneaux de taille humaine déplie ce «très proche», éclate et éloigne l’intime suspendu là à la manière d’une tapisserie.
Claire Labastie. Pour ma part, je m’intéresse plus aux peaux qui se détachent et se dépacent, des peaux nomades. C’est pour cela que les simulacres lucréciens, qui n’ont rien à voir avec ce que nous appelons simulacres, m’intéressent. Ce sont des peaux très fines qui gardent la forme des choses, et qui volent vers nos yeux. Je fais de la vidéo. Or «je vois» se dit «video» en latin. Pour ce poéte et «physicien» qui a vécu au 1er siècle avant J.C., «vidéo», c’est recevoir dans les yeux cette infinité de peaux matérielles impalpables, car très fines, qui se détachent des choses. Et bien, je joue avec des déplacements dans le temps de strates les unes par rapport aux autres, visuelles, auditives, ou psychologiques… Une strate est à un endroit, quand une autre est ailleurs alors qu’elles devraient être dans le présent ensemble: ce sont des jeux de retards qui animent mes vidéos. Retards dans tous les états, entre des composants techniques (bande son, bande image), ou des couches narratives (retards de personnages en réponse à ceux qui affectent la technique, etc.).
Lorraine Alexandre. Alors que personnellement, j’observe la surface pour voir comment elle exprime ou laisse s’exprimer notre psychisme. J’utilise les formes données au corps pour interroger les émotions et la personnalité. Je suis une sentimentale cachée sous un masque scientifique, c’est pourquoi mon travail fait de nombreuses références à la psychanalyse.
Comment vous réappropriez-vous le «sujet peau» en ayant toutes un regard différent? Ces «Epidermies» ont-elles généré une épidémie dans l’articulation de vos réponses artistiques? Par quels moyens générez-vous du sens? De l’énergie?
Tia Calli Borlase. Cela rejoint le fait d’exposer ensemble, l’énergie de groupe. C’est très positif de confronter nos différents regards, c’est très polémique, mais au bon sens du terme, au sens où cela nous aide à nous construire. C’est très riche de croiser nos regards, non seulement de poser son regard sur le travail des autres, mais de réagir aux regards qu’elles posent sur nous.
Sabine Dizel. Oui, cela nous oblige à nous remettre en question.
Claire Labastie. Dans un même temps, nous sommes souvent restées pudiques.
Tia Calli Borlase. Oui, mais finalement, nous avions déjà un retour sur notre travail avant même d’exposer.
Sabine Dizel. La confrontation des travaux plastiques finit par créer une énergie qui lui est propre. Tout l’intérêt d’une exposition de groupe est là .
Claire Labastie. Il y a aussi le plaisir de s’étonner les unes les autres, cette énergie est également dans ce plaisir-là .
Tia Calli Borlase. Et puis, dans notre société, agir collectivement, c’est une sacrée force.
Claire Labastie. Oui et c’est faire échouer un certain individualisme.
Lorraine Alexandre. Et ça évite la solitude qui découle trop souvent de cet individualisme.
Tia Calli Borlase. Et on peut donner une portée particulière à notre travail. Aujourd’hui, nous comprenons que ce concept d’exposition pourrait fonctionner pour un projet encore plus gros.
Lorraine Alexandre. L’énergie de groupe a bien ressemblé à une épidémie, faible dans un premier temps, elle est devenue irruptive, proche de la rupture. Mais, étonnamment, ce sont ces tensions déplaisantes qui ont généré une force permettant aux ego de chacune de se confronter, se tester avant de se comprendre et de s’apaiser. Finalement, cette étape était indispensable à la consolidation du groupe, elle nous a fait rebondir.
Sabine Dizel. De toute façon, s’il n’y a pas de tension, il n’y a pas d’enjeu.
Lorraine Alexandre. Aujourd’hui, le groupe est parfaitement soudé, nous nous connaissons vraiment et avons pris conscience de la complémentarité de nos six personnalités si distinctes.
Vous présentez une majorité de travaux photographiques? Comment pensez-vous ce médium et sa confrontation à la peau?
Tia Calli Borlase. Mes photos sont tirées sur toile avec son grain épais. J’ai enfin trouvé un épiderme pour mes photographies. Je fais ainsi le lien avec mes travaux picturaux antérieurs. La toile donne de la profondeur et rejoint mon idée d’aller sous la peau. Mes inspirations photographiques sont des peintres comme le Caravage et, de façon générale, la peinture des XVIe et XVIIe siècles. C’est pourquoi, je ne considère pas vraiment mes photos comme des photos, mais plutôt comme des peintures.
Sabine Dizel. Mes recherches portent sur le medium photographique autour duquel je mène des expérimentations, principalement à l’aide de sténopés. La distance de la prise de vue apparaît souvent comme «manquée»: une distance sinon inconvenante, du moins inhabituelle eu égard aux critères techniques en vigueur. L’appareillage est ici situé trop près du sujet pour faire le point, pour en obtenir une image nette: à la distance de l’intime, du contact épidermique. Cependant, dans un mouvement de recul, toutes ces images du «très proche» sont rassemblées et cousues en un manteau. ce dernier permet, dans une boutade, de se vêtir de sa propre peau.
Lorraine Alexandre. Quand j’ai commencé mes études, je faisais de la photo depuis déjà longtemps, mais je me voyais plutôt dessinatrice. La photographie m’a rattrapée tout doucement et a imposé l’évidence que je ne m’exprime vraiment qu’à travers elle. Et même lorsque j’utilise d’autres techniques, je les rends dépendantes de la photographie. Par exemple, dans cette exposition, je présente des travaux affleurants pour lesquels je dessine ou écris sur la peau avant d’en faire une photo. Mes photos sont ainsi stratifiées selon différents médiums dont le corps, ou plus précisément la peau, font dès lors partie intégrante. J’aime, entre autres, l’ambiguïté qui en émerge: les dessins sont-ils sur la peau ou sur la photo ? Certains spectateurs viennent très près de mes travaux pour répondre à cette question, ils jouent alors le jeu que j’ai conçu pour eux, les invitant à voir la peau de près, rappelant ainsi sa valeur intime.
Anne Gavarret. Dans l’usage que j’en fais, la photographie et le film métaphorisent de façon assez limpide cette difficulté de saisir le réel, cette impossibilité d’être au monde, finalement. C’est en cela que les images d’images que je fais, qui perdent chaque fois quelque chose, me semblent éloquentes.
Cette exposition est-elle réservée à ce lieu (Aponia, centre d’art contemporain, Villiers-sur-Marne, 94) ou pensez-vous la reformuler dans d’autres expositions et pourquoi?
Lorraine Alexandre. A la fin de la préparation, à l’approche du vernissage, j’ai été prise d’un double sentiment. J’étais très heureuse du résultat encore plus beau que je ne l’espérais, mais aussi très frustrée de voir la fin de l’aventure se profiler. J’ai donc commencé à réfléchir à la possibilité d’en faire une exposition itinérante.
Tia Calli Borlase. Comme c’est une exposition-concept, une construction collective, elle n’est pas réservée à un lieu et pourrait intéresser d’autres personnes capables de nous aider à faire évoluer cette idée. Nous pensons notamment aux galeries, aux fondations, aux lieux d’art… C’est une question assez ouverte, assez attirante.







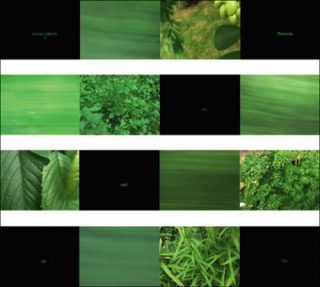
 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram