Celine Piettre. Votre parcours professionnel est pour le moins original: vous avez d’abord été directrice d’un fond régional d’art contemporain avant de vous consacrer à la recherche en design. Quelle est la raison de cette réorientation? Quelles en sont les principales étapes?
Alexandra Midal. J’ai débuté ma carrière dans l’art contemporain comme directrice d’une grosse galerie allemande à Paris, la galerie Rüdiger Schöttle. Puis, au bout de quatre ans, j’ai intégré l’équipe du Frac Haute-Normandie où j’ai commencé à monter des expositions en design. A ce moment là , par un heureux concours de circonstances, l’Ecole d’architecture de l’Université de Princeton, aux Etats-Unis, m’a invitée à entreprendre une thèse de doctorat en design. Et comme je doutais de la solidité de ma vocation de directrice de Frac, j’ai saisi ma chance… et suis retournée sur les bancs de l’école…
Pourquoi cette curiosité pour le design, née au sein même du milieu de l’art contemporain?
Alexandra Midal. Mon intérêt pour le design est né progressivement, au contact de designers, bien évidemment, mais aussi de l’artiste Dan Graham, dont j’avais été l’assistante pendant quelques années. Nous discutions souvent des liens qui unissaient (ou pas) l’art et le design et des clichés qui hantaient ces relations. Il a eu une influence majeure sur ma façon de voir les choses…
Par ailleurs, au fil des expositions que j’organisais sur le sujet, je me rendais compte que la discipline, bien qu’attractive du point de vue du public, était comme orpheline, très peu étudiée, très peu théorisée pour elle-même. Mon intérêt pour le design a donc été lié, dès le début, à cette prise de conscience de la nécessité de faire du design une discipline autonome et pas une sous-discipline bâtarde de l’architecture ou de l’histoire de l’art. Et c’est ce que l’université de Princeton m’offrait : un cadre, un champ libre pour tenter de comprendre la spécificité du design, pour penser réellement les conditions d’autonomie de la discipline… et aussi l’occasion de répondre à certaines de mes interrogations sur la mise en espace du design et sa transmission: comment l’exposer? Comment l’enseigner?
Quel est votre première rencontre décisive avec l’objet de design?
Alexandra Midal. J’ai toujours beaucoup chiné, fréquenté les brocantes, les puces. J’attache une importance à l’objet en soi, dans son rapport au quotidien, à la vie des gens… et pour ce qu’il représente au-delà de sa matérialité et de sa fonction première. Lors d’une visite au Musée de design de Londres, j’ai eu un déclic devant une sélection de chaises représentant les principaux jalons de l’histoire du design. Je me suis dit que ces objets provoquaient quelque chose de l’ordre de la spatialité, quelque chose que l’on pouvait comparer à la présence de l’oeuvre d’art. N’en déplaise à ceux qui pensent que le design est uniquement fonctionnel…
Mais alors, si ce n’est pas la fonction, la dimension utilitaire, qu’est-ce qui distingue l’art du design?
Alexandra Midal. Cette question est typique du milieu de l’art ! Pourquoi une telle récurrence? Je pense que cela vient de l’histoire même du design, qui a justement été fondée par un historien de l’art et de l’architecture, Nikolaus Pevsner, auteur du célèbre ouvrage, non traduit en français, Pionneers of the Modern Mouvement. En tant que moderniste convaincu, Nikolaus Pevsner défend l’esthétique de la fonctionnalité qui dit, en gros, que ce qui fonctionne est forcément beau. Nikolaus Pevsner va donc décrire et penser le design en insistant sur la fonction. Et cette idée va servir de base au champ de l’art pour opérer une distinction entre l’art et le design, d’un côté l’usage, de l’autre cette propension expansionniste de l’œuvre d’art, qui peut investir tous les territoires et tous les mediums…
Cependant, contrairement à la thèse de Nikolaus Pevsner, le design s’est toujours défini à la fois dans la fonction et hors de la fonction. Ce qui détermine la singularité de la discipline n’est pas la question de l’objet utile. Ce serait trop simple. Le design est avant tout une idéologie, une manière de penser. Et, à l’origine de son histoire, une manière de pensée anti-capitaliste !
Pourtant le design est perçu aujourd’hui, pour beaucoup d’acteurs du milieu de l’art, comme «le suppôt du capitalisme», pour reprendre une expression que vous utilisez dans votre Introduction à l’histoire d’une discipline?
Alexandra Midal. Oui, c’est un malentendu historique ! La question de l’économie et de l’industrie appartient aussi au champ de l’art. Le cinéma en est la preuve !
L’exposition dont vous assurez en ce moment le commissariat au Lieu du design, Things Uncommon, présente le travail du jeune britannique Noam Toran. Certaines des œuvres exposées proviennent de la collection du Fonds régional d’art contemporain d’ÃŽle de France. Est-ce qu’on peut en déduire une proximité avec les arts plastiques ? Noam Toran se considère t-il comme un artiste ou un designer?
Alexandra Midal. Encore une question étonnante ! Noam Toran est diplômé de la section design du Royal College of Art, à Londres, où il enseigne le design industriel. Il se perçoit bien évidemment comme un designer, même s’il a des affinités avec l’art… et qu’il incarne, c’est vrai, une rupture dans le champ du design, dans la lignée du travail d’Anthony Dunne et Fiona Raby, ses professeurs, les inventeurs d’un design que l’on pourrait qualifier d’hypothétique. Ce courant est encore très confidentiel, en tout cas en France…
Comment avez-vous choisi les pièces présentées au Lieu du design? L’exposition a-t-elle l’ambition d’une rétrospective?
Alexandra Midal. A l’origine de cette exposition, il y a l’œuvre Desire Management, acquise par le Frac ÃŽle-de-France. Cette pièce comprend un film et trois prototypes d’objets en état de marche – trois props, pour reprendre le terme de Matthew Barney, qui fait référence à des accessoires de plateau de cinéma. Ces props sont des objets hypothétiques, fictionnels. Leur usage reste plus ou moins énigmatique, et reflète les désirs, les affects de leurs utilisateurs potentiels…
Pour la première exposition monographique de Noam Toran, je tenais aussi à présenter son projet de fin d’études, le film Object for Lonely Men, qu’il a conçu en 2001 mais qui n’a rien d’un travail de jeunesse. Au contraire, il contient déjà tout l’univers du designer, sa relation fusionnelle au cinéma, son ironie.
L’idée n’était pas de tout présenter, évidemment, seulement un condensé de sa jeune carrière. Je ne voulais pas que les visiteurs perçoivent Noma Toran comme un réalisateur de cinéma frustré mais comme un raconteur d’histoires, un story teller. Mon ambition était de montrer que les objets faisaient partie du modèle narratif et fictionnel au même titre que les films et le cinéma. Dans l’exposition au Lieu du design, on va donc trouver des œuvres représentatives du parcours de Noam Toran, comme les pointes émergentes d’un iceberg…
Quelle pourrait-être la traduction française du titre de l’exposition: Things Uncommon?
Alexandra Midal. En anglais, l’adjectif uncommon signifie à la fois rare et peu commun, dans le sens de surprenant. C’est assez difficile de le traduire en français sans trahir sa véritable signification. Nous voulions aussi éviter d’étiqueter le travail de Noam Toran, de le ranger dans la case art ou design. Ces objets, ces « choses », sont des catalyseurs d’imaginaire et des espaces hypothétiques. Le titre, comme l’exposition, invitent à faire une expérience. L’idée première de ne pas vouloir catégoriser les objets que l’on présente, c’est déjà rentrer dans le travail de Noam Toran….
Au sujet des œuvres de Noam Toran, vous parlez d’objets ou d’espaces d’hypothèses. Qu’est-ce que recouvre exactement ce terme «d’hypothèse»?
Alexandra Midal. La notion d’hypothèse renvoie à une indétermination. On ne sait pas si les objets fonctionnent réellement, s’ils sont vrais, s’il faut croire aux histoires qu’ils nous racontent. Les objets hypothétiques contestent l’idée d’une obligation de résultat à laquelle serait soumis le designer dans une production classique.
Pourriez-vous nous en dire plus sur cet étrange aspirateur à forte connotation érotique que l’on rencontre dans le film et l’installation Desire Management?
Alexandra Midal. On découvre ce fameux aspirateur dans le film puis dans les espaces d’exposition, sous la forme d’un objets. Ici, sa fonction première, ménagère, est déviée, dérivée. On est dans une anomalie d’usage. Le tuyau de l’aspirateur, fixé sur un chevalet métallique, opère des mouvements de bas en haut, contre le corps de son utilisateur. A partir de là on peut imaginer que l’homme cherche la jouissance ou qu’il s’agit d’une histoire vraie… On est dans le registre du fantasme. Nous sommes confrontés à un intime exposé, de l’ordre de l’affectif, du fétichisme.
Et c’est précisément ce qui m’intéresse dans le champ du design et dans le travail de Noam Toran, la dimension psychologique de l’objet, mais dans le sens du terme anglo-saxon, psycho, dans le sens hitchcockien. Pour moi, les espaces (l’architecture, les objets) dépassent la seule question de la fonctionnalité. Ce sont les lieux de la libido, de l’affect, de l’émotion, des pulsions criminelles. Les objets de Noam Toran ont cette dimension et évoquent très justement ce type de sensation.
Au delà de sa dimension psychologique, le travail de Noam Toran a-t-il une portée sociologique? Peut-on y voir une critique de la consommation, de notre rapport au matériel, ou du modernisme, comme dans les films de Tati par exemple?
Alexandra Midal. Certains designers se sont penchés sur la question et le font très bien, comme Enzo Mari, mais ce n’est pas l’enjeu du travail de Noam Toran. Il serait plutôt du côté du prestigiateur : celui qui fait des prestiges. Le terme est créé par le premier magicien moderne de l’histoire, Jean-Eugène Robert Houdin. D’après lui, il ne suffisait pas d’être un bon prestidigitateur — littéralement d’être habile avec ses doigts — mais il fallait savoir faire des prestiges, mystifier, couper le souffle. C’est ce que fait Noam Toran (qui déteste pourtant la magie !), il est le bonimenteur au sens noble du mot, il raconte des histoires.
L’Exposition présente douze objets plutôt mystérieux, les Mac Guffins, réalisés en résine synthétique noire, un matériau fréquemment utilisé en design pour le prototypage rapide…
Alexandra Midal. La Librairie des MacGuffins est une série d’objets, accompagnés d’un petit texte, qui génèrent la narration par eux-mêmes. Le terme renvoie au genre cinématographique. Il a était inventé par Hitchcock. A l’origine, ce sont des objets qui permettent à l’intrigue cinématographique de se dérouler, la valise d’argent dans Marnie ou le Faucon maltais dans le film du même nom, par exemple. Ici, avec Noam Toran, on est confronté à des MacGuffin de la deuxième génération, ils ne vont plus servir à développer l’intrigue mais vont fonctionner comme des catalyseurs d’imaginaire, en circuit autonome. Les MacGuffins sont des embryons d’histoire dont on ne connaît pas forcément la fin. Le mystère reste entier. Après, c’est dans votre tête que ça se passe, le cinéma est mental.
Un exemple de MacGuffin?
Alexandra Midal. J’aime beaucoup Koons Balloon Mould. Le texte raconte l’histoire de Rodney et Sue, un couple de futurs retraités qui travaillent dans une usine de plastique et craignent une diminution de leur niveau de vie. En lisant une revue d’art, Sue a une idée géniale qui pourrait améliorer considérablement leurs fins de mois : fabriquer une machine capable de reproduire les célèbres ballons en forme de chien de l’artiste Jeff Koons !
Jeff Koonz a une certaine réputation dans le monde de l’art, c’est un ancien trader, il est très bien coté sur le marché. Est-ce une façon de critiquer l’industrie de l’art?
Alexandra Midal. Non, je ne crois pas… Noam Toran est avant tout un cinéphile, amateur de films noirs, et il se trouve que dans ce type de cinéma, il y a deux manières de gagner de l’argent : la fausse monnaie et le trafic d’œuvres d’art.
D’autres MacGuffins font référence à des personnages historiques: le couple Rosenberg par exemple… Pourquoi?
Alexandra Midal. Là encore, parce que la période est liée à celle des films noirs… C’est vraiment une référence très importante pour Noam Toran. Il s’intéresse aussi à la question de la propagande qui est une façon de raconter une histoire pour mettre en avant une idéologie… Le design, comme le cinéma, sont des formes d’idéologies. L’exposition de Noam Toran crée des outils de propagande sur un mode fictionnel.
Le cinéma est donc une source d’inspiration majeure pour Noam Toran…
Alexandra Midal. Oui, il regarde énormément de films, en particulier des films de genre (polar, horreur, espionnage) mais il aime aussi les films de Buster Keaton, de Peter Weir et même un certain cinéma indépendant. Son premier film Object for Lonely Men rend explicitement hommage au film de Godard, A bout de souffle.
Y-a-t-il une forme de nostalgie dans ces références?
Alexandra Midal. Non, il faut y voir plutôt un mode de communication par l’intermédiaire d’œuvres qui travaillent sur des genres reconnaissables par tous, sur l’idée d’un code, sur le stéréotype. C’est Dan Graham qui disait « tout le monde adore les clichés ! ». Noam Toran joue avec les codes, se plaît à les mystifier… Et surtout voue un amour très profond au cinéma.
Dans son dernier film, conçu en 2010, If We Never Meet Again, Noam Toran s’amuse justement avec les codes du film d’espionnage, autour de ces deux personnages qui s’échangent une valise sur le bord d’une route… et se mettent soudain à pleurer!
Alexandra Midal. La valise est un MacGuffin, ici mis en scène. On est dans le re-enactment. La scène se rejoue, à chaque fois énigmatique. On est à la fois dans la parodie et dans le témoignage, dans le jeu, le plaisir de faire plaisir et dans la frustration de ne pas savoir. Je pense personnellement que cette pièce marque la fin d’un cycle sur la relecture, commencé avec le premier film. En évidant la fiction, la narration, le sens même du film, son dénouement, en le montrant juste comme un système, le système marche encore ! Ce que Noam Toran montre ici, c’est qu’il y a quelque chose qui se dit dans la forme et qui se passe de contenu. Le suspens se génère lui-même. Comme le MacGuffin, c’est une intrigue à lui seul.
aAlexandra Midal
— Portrait, 2010.
Noam Toran
— Desire Management, 2006. Film et installation. Collection Frac ÃŽle de France.
— If We Never Meet Again, 2010. Film shot on HD screened on two monitor.
— Bad Engineers, Mac Guffin Library, 2008. Prototype en résine Polymère noire.
— Koons Balloon Mould, Mac Guffin Library, 2008. Prototype en résine Polymère noire.
— Object for Lonely Men, 2001. Vidéo DVCAM. Collection Moma
.
Informations pratiques
Exposition «Noam Toran, Things Uncommon», du 24 juin au 21 août 2010, au Lieu du design (74, rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris, entrée libre).






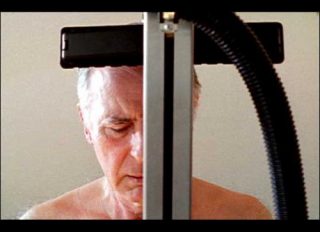

 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram