Interview
Par Caroline Lebrun
Caroline Lebrun. Votre première exposition personnelle « Glooscap, la ville » a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e ici en 1992. Pouvez-vous nous expliquer comment s’Ă©tait produite votre rencontre avec la galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois ?
Alain Bublex. Comme souvent, notre rencontre est le rĂ©sultat d’un concours de circonstances. Avant d’ĂŞtre artiste, j’Ă©tais designer. Parallèlement Ă cette activitĂ©, je travaillais avec un ami sur le dessin d’une ville imaginaire. C’Ă©tait une sorte de passe-temps complexe et exigent qui constituait, selon les cas, un sujet de conversation ou de plaisanterie avec notre entourage. Ces discussions nous ont progressivement rapprochĂ©s du monde de l’art contemporain tout en nous faisant prendre conscience des enjeux de notre projet.
Au dĂ©part, vous n’aviez pas de projet artistique ?
Au dĂ©part, nous n’avions pas le projet de devenir des artistes. Nous n’avions pas dĂ©cidĂ© que ce que nous faisions alors prendrait place dans une galerie ou dans un centre d’art. Ce destin du travail a Ă©tĂ© une consĂ©quence de ce qui Ă©tait entrepris plutĂ´t qu’un objectif.
Vous-même aviez fait les Beaux-Arts ?
Un bref passage de dix-huit mois ! Rien de ce que l’on y disait ne me parlait et mes prĂ©occupations n’y trouvaient aucun Ă©cho.
Par rapport Ă votre mĂ©tier de designer, qu’est ce qui vous attirait en devenant artiste ?
Une sorte de libertĂ© de mouvement et aussi un rapport plus direct et immĂ©diat avec le public. En tant que designer, mes projets passaient Ă travers de multiples filtres avant de sortir du milieu confinĂ© de l’entreprise. La force de proposition d’un designer s’exprime en premier lieu pour son chef de service ! Elle est ensuite rĂ©percutĂ©e de bureaux d’Ă©tudes en services d’analyse du marchĂ© et perd, progressivement, de son impact, Ă force de rebonds. La plupart des objets que nous connaissons et que nous utilisons sont le fruit de cette Ă©rosion. J’ai le sentiment d’Ă©chapper un peu Ă cela dĂ©sormais et je tiens surtout Ă ma libertĂ© de mouvement. Le monde industriel est, aujourd’hui, extrĂŞmement spĂ©cialisĂ©, semblable Ă une autoroute, rapide, efficace, mais avec un choix de possibilitĂ©s assez faible. Il ne laisse pas place Ă des positions indĂ©terminĂ©es. Par contraste, le monde de l’art me paraĂ®t plus ouvert. On peut y suivre des trajectoires très diffĂ©rentes, mĂŞme si cela n’est pas toujours confortable.
Cette première exposition vous a-t-elle confortĂ©e dans l’idĂ©e de continuer ?
En tout cas, c’est ce que j’ai fait !
Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le projet Glooscap ? Quelle est l’origine de son nom ?
Glooscap est la description d’une ville imaginaire qui a pour caractĂ©ristique de n’ĂŞtre pas utopique (…), elle ne met Ă jour aucune solution. Elle est simplement une copie de toutes les villes existantes avec leurs qualitĂ©s et leurs dĂ©fauts cumulĂ©s. Son nom est celui d’un dieu qui, selon la lĂ©gende indienne, — puisqu’elle se trouve en AmĂ©rique du Nord — aurait formĂ© le paysage sur lequel la ville s’Ă©tend. La première exposition proposait des archives de cette ville Ă travers une sĂ©rie de documents qui tendaient Ă rĂ©ifier son histoire, une histoire qui s’inspire du pays et du site rĂ©el sur lequel elle se trouve. Elle montrait comment, Ă partir de l’arrivĂ©e des Français au Canada, avait pu se crĂ©er Ă cet endroit un comptoir colonial, puis les quartiers qui allaient former une petite ville industrielle avant de devenir une des grandes mĂ©tropoles du XXème siècle.
Le projet retraçait ainsi toute l’Ă©volution de la ville depuis sa crĂ©ation ?
Oui, tous les documents Ă©taient très rĂ©alistes, en relation cohĂ©rente les uns avec les autres. On pouvait facilement reconstituer l’histoire et avoir une idĂ©e juste de la morphologie de la ville actuelle en parcourant l’exposition. On a souvent rapprochĂ© ce travail d’autres recherches menĂ©es en mĂŞme temps par des artistes qualifiĂ©s alors de « fictionalistes ». Pour moi, ce travail Ă©tait d’abord en relation avec l’urbanisme et l’architecture. J’ai Ă©tĂ© surpris de remarquer que, pour exister dans le monde de l’art, il fallait nĂ©cessairement ĂŞtre liĂ© Ă une « catĂ©gorie » existante.
S’agissait-il d’une sorte de « ville virtuelle » avant l’heure ?
Non, ce n’Ă©tait pas avant l’heure car le jeu Sim City sortait la mĂŞme annĂ©e. Mais il n’y a aucun point commun avec ce jeu basĂ© sur la gestion d’une ville. La confusion a Ă©tĂ© rĂ©currente. Pourtant Glooscap n’est pas une ville virtuelle. Le projet parle d’urbanisme et d’histoire et non pas de fiction, de construction ou de jeu de rĂ´le.
Quels rapports votre travail entretient-il avec l’utopie ?
Ils sont nombreux bien sĂ»r ! Et Glooscap, en tant que premier projet, l’indique clairement. Comme je le disais prĂ©cĂ©demment, cette ville imaginaire n’a rien d’utopique. Elle est quelconque et ressemble Ă toutes les grandes villes de la fin du XXème siècle. NĂ©anmoins, les documents qui la font exister (dessin, plans, photographies…) sont les mĂŞmes que ceux utilisĂ©s par les architectes comme Tony Garnier qui dessinèrent les villes utopiques qui allaient fonder la rĂ©flexion moderne en architecture. Cette relation technique me paraissait rĂ©vĂ©latrice : si au dĂ©but du XXème siècle une ville imaginaire Ă©tait nĂ©cessairement projetĂ©e comme solution, Ă la fois sanitaire et sociale, pour la sociĂ©tĂ© industrielle, il semblait devenu impossible de croire encore aux solutions Ă la fin de ce mĂŞme siècle. En dessinant le plan en relief Ă l’origine de cette ville imaginaire, il ressortait que cette relation Ă l’histoire Ă©tait au cœur des enjeux du projet, bien plus que la fiction.
Continuez-vous Ă travailler sur ce projet et sur le thème de l’utopie ?
Oui, j’y suis revenu rĂ©cemment. Glooscap Ă©tait, en grande partie, un travail de fiction, une œuvre littĂ©raire. Quelques annĂ©es plus tard, après avoir travaillĂ© sur diffĂ©rents projets concernant, par exemple, l’automobile, l’alimentation ou la photographie, j’ai Ă©prouvĂ© le besoin de me pencher Ă nouveau sur ces questions de ville, d’architecture, d’urbanisme et d’utopie afin de clarifier mes positions. A partir de 1999, j’ai regroupĂ© diffĂ©rentes interventions sous le terme gĂ©nĂ©ral des Projets en chantier. La plupart sont en relation Ă©troite avec l’architecture, comme Plug-in City (2000) qui fait explicitement rĂ©fĂ©rence au projet Ă©ponyme de Peter Cook.
Avec les Projets en chantier, je voulais revenir un instant Ă la racine du mot utopie. Nous l’employons communĂ©ment pour dĂ©crire des propositions particulièrement, imaginatives ou anticonformistes, et pour indiquer, souligner, que celles-ci nous paraissent irrĂ©alisables. Ce n’est pas le sens originel du mot.
Une utopie est un modèle thĂ©orique, une construction intellectuelle qui n’a d’autre objet que de fournir matière Ă rĂ©flexion. Cette condition primordiale signifie qu’un projet utopique est conçu, volontairement, sans aucun lien avec la rĂ©alitĂ©. Il ne peut ĂŞtre que pure fiction et perd son statut d’utopie dès qu’il pose la question de sa rĂ©alisation. Par consĂ©quent, sont exclus de l’utopie la plupart des propositions de l’architecture d’avant garde du XXème siècle et bon nombre d’autres propositions Ă©manant du champ social ou politique. Il est important pour moi de poser sur ces projets un regard diffĂ©rent : ils ne sont pas utopiques car leurs auteurs ne les livrent pas comme des modèles de rĂ©flexion abstraite mais comme des modèles concrets vouĂ©s Ă la construction et ce, en dĂ©pit d’une faisabilitĂ© technique parfois des plus douteuse.
C’est prĂ©cisĂ©ment ce point qui m’intĂ©resse : l’Ă©cart perceptible entre le projet des auteurs et le statut dans lequel nous maintenons arbitrairement ces propositions. Nous qualifions d’utopiques des idĂ©es sĂ©duisantes dont nous pressentons les qualitĂ©s et la gĂ©nĂ©rositĂ© mais que nous nous jugeons, par avance, incapables de mettre en pratique. L’usage que nous faisons aujourd’hui du mot utopie semble dĂ©limiter, ou plutĂ´t dĂ©finir, bien plus qu’un idĂ©al projetĂ© dans l’imaginaire : le sentiment de notre incapacitĂ© ou de notre impuissance. Il masque une forme de regret, mĂŞme si nous lui opposons beaucoup de justifications « dĂ©culpabilisantes ». PlutĂ´t que le jugement portĂ© sur l’intĂ©rĂŞt ou la place des utopies dans notre sociĂ©tĂ©, c’est la dĂ©rive de ce mot dans notre vocabulaire qui me paraĂ®t Ă la fois rĂ©vĂ©latrice et intĂ©ressante.
Vous parliez également de travaux sur la photographie. Que souhaitez-vous expliquer à ce sujet ?
Je ne souhaite rien expliquer ! En travaillant sur une sĂ©rie de projet d’appareils photographiques (sans doute une rĂ©miniscence de mon passĂ© de designer !), j’ai constatĂ©, un jour, qu’en pensant dessiner des objets j’en dessinais, en fait, l’usage. Je ne reprĂ©sentais pas des appareils photos mais ma pratique de la photographie. Finalement le dessin est devenu une sorte de schĂ©ma aboutissant, en toute logique, au projet d’un appareil photo qui ne prend pas de photos. Un objet apparemment absurde mais qui, pourtant, faisait Ă©cho Ă une des caractĂ©ristiques essentielles de la pratique de la photographie. J’ai par la suite tentĂ© de poursuivre cette Ă©tude avec grand groupe industriel du secteur, Samsung, qui a effectivement produit une maquette de cet objet. L’idĂ©e n’Ă©tait pas de parvenir Ă une Ă©ventuelle commercialisation, mais plutĂ´t d’entraĂ®ner un industriel dans l’Ă©tude d’un objet qui ne servait apparemment Ă rien.
Dans votre travail, vous ĂŞtes effectivement plus intĂ©ressĂ© par le processus que par le rĂ©sultat lui-mĂŞme ? Qu’est-ce qui vous attire dans le processus ?
Cette remarque ne concerne pas uniquement mon travail ! Je suis, en gĂ©nĂ©ral, plus intĂ©ressĂ© par les processus que par les rĂ©sultats. Je peine toujours Ă Ă©valuer les choses (objets ou Ă©vĂ©nements) en eux-mĂŞmes, j’ai besoin du contexte, de l’histoire, de savoir ce qui les prĂ©cĂ©dait, de comprendre les intentions et les objectifs de leurs auteurs, en fait de me construire une sorte de panorama des raisons qui font qu’une chose existe, pour me dĂ©terminer.
Vous préférez construire que bâtir ?
Beaucoup de mes projets font rĂ©fĂ©rence Ă cet Ă©tat d’inachèvement que reprĂ©sente le prototype. Il me semble toujours important de m’attarder Ă ce stade oĂą l’objet n’est pas encore une Ă©vidence mais toujours un sujet de controverse. L’intĂ©rĂŞt d’un projet rĂ©side dans cette constante nĂ©gociation entre tous les acteurs et le rĂ©el.
Pensez-vous que l’art contemporain offre un bon « chantier » Ă vos projets ?
C’est, en tout cas, l’espace dans lequel ceux-ci s’inscrivent aujourd’hui le plus naturellement.
Comment construisez-vous vos projets, sur quoi travaillez-vous en ce moment ?
« Unbuilt », ma dernière exposition Ă Paris avait pour sous titre : « Tous les Bouvards n’ont pas la chance de trouver leurs PĂ©cuchet ». Je m’intĂ©ressais Ă la figure de l’inventeur, qui semble souvent avoir raison, seul contre tous. Je m’attachais Ă l’ambiguĂŻ;tĂ© du regard que nous portons sur cette position inconfortable en Ă©tant partagĂ©s entre : l’admiration Ă posteriori ; l’estime dans laquelle nous tenons ces prĂ©curseurs quand leurs Ă©lucubrations se sont rĂ©vĂ©lĂ©es fondĂ©es et notre incapacitĂ© Ă les reconnaĂ®tre au prĂ©sent, tant leurs thĂ©ories et leurs postures nous paraissent toujours ridicules et hors de propos.
Il m’est difficile de dire comment je travaille, je n’ai pas de mĂ©thode prĂ©cise. Je crois que mes projets viennent le plus souvent de la mise en relation de savoirs qui n’ont, Ă priori, pas de relation entre eux. Ces rapprochements sont le plus souvent le fruit du hasard, ils m’apparaissent comme des Ă©vidences, sans doute parce que je m’intĂ©resse de manière Ă©gale Ă des choses qui n’ont rien Ă voir entre elles !
Préférez-vous inventer ou réinventer ?
Je pense plutĂ´t Ă une autre position possible qui consisterait Ă Ă©chapper continuellement au statut d’auteur, Ă travailler au dĂ©veloppement de projets initiĂ©s par d’autres, Ă dĂ©fendre des hypothèses Ă©mises avant que je ne m’y intĂ©resse. D’une certaine manière, Ă disparaĂ®tre un peu. Ou au moins Ă me placer au second plan dans la chaĂ®ne de l’invention. Un retrait qui, Ă l’image de Glooscap, met simplement en relation un ensemble d’Ă©vĂ©nements et d’Ă©lĂ©ments dont je ne suis pas l’inventeur.




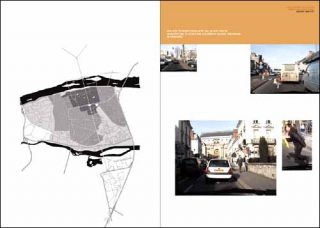





 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram