Dans cette maison de villégiature située au coeur d’un quartier populaire, la visite est familiale, à la fois à l’écart du bruit de la ville et ancrée dans son tissu social. Car née d’un jeu, l’exposition n’en est pas moins politique. Le support en est l’affiche, et les photographies sont prêtées par une agence emblématique du photojournalisme. La règle était simple : à chacun des graphistes a été attribué au hasard un cliché. A eux d’en faire une image de 90,5 par 128 cm.
  Â
Le Pavillon parvient à loger 80 tirages et 80 affiches : les uns sont posés sur des tables associées en rhizome, les autres suspendues dans l’espace. Pris au jeu du recoupement, les visiteurs cherchent les binômes. Ils se penchent sur les tables, lèvent la tête et trouvent l’image engendrée, qui accompagne l’imagination ou en choque l’attente. On fouille, on examine, au contraire de l’attitude paresseuse du passant.
La commande n’a pas de but, sinon une recherche fondamentale. Nul n’est besoin d’en compliquer l’affaire : il peut s’agir, tout simplement, de la sympathie souriante de deux images muettes. Pascal Coltrat associe au cliché de deux japonais jouant à lancer de petits planeurs, celui d’une jeune femme en tailleur rouge sortant d’un avion accidenté.
Car où se construit l’identité d’une image graphique, si ce n’est à travers la communication qui agit entre ses éléments ? Château Rouge intègre ainsi la photographie de Léa Crespi à un dispositif musical : il décline les faces d’un 33 tours à partir du profil d’une jeune femme nue en marche, crâne rasé. Son étrangeté est mêlée à la séduction d’un objet de divertissement, et l’image est prise dans le faisceau des activités du disque.
Quoique désintéressé, le plaisir du faire est rarement gratuit. Le plus souvent, il concerne même une réalité sociale plus préoccupante. La Sorcière n°30 de S&P Stanikas est la photographie d’une vulve offerte qu’Annabel Olivier a recouvert d’un travail typographique d’abord harmonieux, et dissonant — après un examen rapproché : une multitude de petits noms donnés au sexe féminin forment des cercles concentriques autour d’un clitoris « pré-découpé » en rouge, et dont part une phrase sur l’excision.
Il est des montages un brin scolaires dans lesquels on regrette l’insertion de citations qui voudraient créer le drame en place de l’image. C’est un écueil qu’évitent les artistes dont le cliché de départ est désarmant de simplicité, évident de scandale. Celui de Loïc le Loët est le portrait du père d’une victime palestinienne à Gaza : la dignité d’un homme debout. Les graphistes 21 x 29,7 l’ont habillé des lignes cartographiques des territoires occupés. Sa silhouette est bordée de frontières, son individualité contournée.
Quant Ă Vincent Perrottet, il qualifie la photographie des Ă©poux Reynes par Dominique Delpoux de « dĂ©finitive et intouchable ». Mais derrière la calme fiertĂ© de ces anciens mineurs, il entend le bruit de leurs vies passĂ©es au travail. C’est par un code graphique strict qu’il parvient Ă dĂ©terminer des formes automatiques et surprenantes : ils insuffle mouvement et discontinuitĂ© au protocole du portrait.Â
  Â
La méthodologie reste propre à chacun, mais le point commun à tous est l’élaboration d’un langage qui fait parler l’image. Celui d’Orange Juice Design la fait précisément crier, comme une alarme. Une sourde inquiétude baigne la photographie de base d’Olivier Mirguet : un de ces téléphones publics isolés d’où l’on passe un coup de fil que personne ne doit entendre. Un graphisme de type signalétique en fait la cible de logos indexant le crime, la drogue ou les délits sexuels.
Enfin, dans le contexte de banlieue représenté par Denis Darzacq avec L’Entrée n°4 de Bobigny, le langage est une question de survie. Michaël Worthington l’a compris : il infiltre le cliché au moyen d’éléments décoratifs qui transpirent des failles de l’urbain. « Ces petits monstres, dit-il, ont même dévoré la typographie. Ils vont s’entre-dévorer, et alors les mots reprendront vie ».
Â

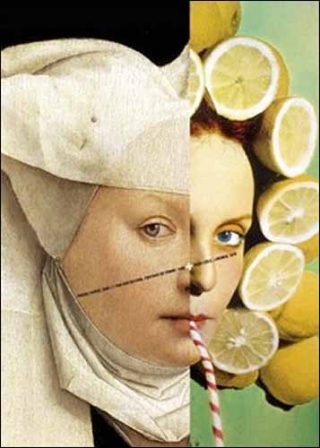

 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram